 Login |
MeToo |
Wax |
14-18 |
Photos |
Comics |
Games |
Term |
Rally |
Users
Login |
MeToo |
Wax |
14-18 |
Photos |
Comics |
Games |
Term |
Rally |
Users
|
|
home A MA MERE. .... C'est à toi, Mère, que je dédie cet ouvrage, rigoureusement véridique.... .... C'est pour toi, Mère, que, pendant de longues heures, j'ai travaillé, jusqu'à ce que le sommeil vint clore ma paupière.... .... Puisses-tu, à la lecture de ce récit d'aventures ..... ô aventures bien modestes, en vérité ! ....... trouver autant d'émotion que j'en ai eu, moi-même, en l'écrivant ! ..... .... Mais, je ne crois pas me tromper, en pensant que ce livre t'intéressera, non pas tant par les aventures elles-mêmes, mais plutôt, par la nature de la personne à qui elles sont arrivées, puisqu'il s'agit de moi, de ton fils ! .... Paris, le 1er janvier 1922 (signature) Chapitre premier. L'engagement. La guerre, depuis dix-huit mois, déjà, faisait parler d'elle. Les journaux étaient emplis par les communiqués, citations, faits d'armes glorieux, de quoi, en un mot, bouleverser le cerveau le plus solide et le moins patriote de la France entière. La mode était à la guerre : je me tournais vers la guerre. Je voulais faire comme les autres. Etre habillé de bleu horizon, porter des rubans multicolores sur la poitrine et des brisques sur le bras, me semblait le seul rêve digne d'un homme. Je n'avais pas encore dix-sept ans, j'étais déjà saisi par l'unique pensée d'aller me battre; je fis mes préparatifs un bon moment à l'avance. Visites au bureau de recrutement, à la mairie, au commissariat de police furent faites au moins quinze jours avant que je puisse signer mon engagement. Le 26 janvier 1916, je fus enfin autorisé, à mon grand contentement, à aller passer la visite au conseil de révision.  Mon coeur battait, et combien ! Quand j'entendis le : "Apte, service armé" du major, quel soupir ! Je croyais n'être pas pris. J'avais dix-sept ans moins huit jours, je pesais cinquante kilos à peine, et je mesurais un mètre cinquante-sept ! Enfin, j'étais bon pour le service armé ! Je ne devais signer mon engagement que le trois février, puisque c'était à cette date que j'avais mes dix-sept ans. Dire avec quelle impatience, je vis s'écouler les huit jours, rien ne saurait le décrire ! Enfin, le trois arriva. A dix heures du matin, je me présentais à la mairie. J'avais demandé le 164 R.I. à Verdun, comme étant le plus près du front et j'avais choisi l'infanterie, car ne sachant pas monter à cheval, je ne voulais, par suite, aller dans la cavalerie, et, d'autre part, il me semblait que je n'aurais pas aimé suffisamment le bruit du canon pour l'entendre dans mes oreilles, étant dans l'artillerie. A dix heures quinze, tout était fini, j'étais soldat. Je crois que je me redressais en sortant et que je considérais les jeunes gens un peu plus petits que moi, avec beaucoup de dédain. Mon regard semblait leur dire : "Pourquoi n'êtes-vous pas soldats ?" L'après-midi même, j'allais à la sous-intendance me faire délivrer mes ordres de transport, et le soir même, j'étais en route pour Verdun. 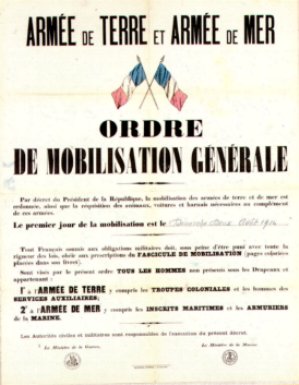 Près de quarante-huit heures de voyage, dans des compartiments emplis à déborder de poilus de retour au front, chantant, fumant, crachant. Je commençais à en avoir assez le cinq en arrivant à Verdun. Il était onze heures, lorsque je me présentais à la Place, à la citadelle. On me renvoya de là à la caserne Miribel. Tous les coins de rues, obligation de sortir mes papiers. L'état de siège existait à Verdun, et d'autant plus sévère que la ville était bombardée de temps en temps. Je suivis mélancoliquement le Faubourg-Pavé, au bout duquel se trouve la caserne Miribel. Toutes ces maisons, closes, dont quelques-unes détruites, me donnaient le cafard. Enfin, j'arrivais à Miribel. La grande grille était fermée. Je dus passer par le petit portillon. Le sergent de garde m'arrêta : "Eh, là-bas ! Où allez-vous ?" Je demandais (oh, fort timidement) le bureau où je pourrais connaître mon affectation. Le sergent m'envoya au bureau de la 37e compagnie classe 17, laquelle venait, en effet, d'être incorporée trois semaines plus tôt. J'entrai, sitôt arrivé, au bureau de la 37, en relation avec mon futur chef, le capitaine Godefroy, un grand et brave homme, en même temps qu'un homme brave. Après avoir ma feuille de route, et décliné mes nom, prénoms et qualité et répondu à diverses questions, je fus avisé que j'étais affecté à la quatrième section du 3e groupe. La 37e compagnie -compagnie d'instruction- était partagée en six groupes (comprenant chacun une centaine d'hommes) divisés eux-même en quatre sections. Le premier groupe était composé des hommes les plus forts, le deuxième un peu moins forts, le troisième moyens, et ainsi de suite, de plus en plus faibles. Un planton me conduisit jusqu'à la chambre de ma section. Le caporal m'indiqua un lit et je suivis ensuite le planton, qui m'emmenait au magasin. En cinq minutes, je fus muni de tout le fourniment réglementaire, depuis le complet numéro un jusqu'au sac à brosses en passant par les godillots et la gamelle. Une chose qui me vexa, c'est que nous n'avions pas l'uniforme bleu-horizon; nous étions tous habillés uniformément, de la vieille tenue rouge et bleue avec le képi temps de paix. C'était un samedi après-midi. La chambrée, de même que ses voisines, était toute affairée, car, de même que tous les samedis, il y avait revue. J'étais perdu dans ce fouillis comme un pauvre malheureux et j'y serais resté si mon voisin de lit n'était venu à mon secours. C'était un ancien (à mes yeux, puisqu'il avait vingt jours de service) il eut vite fait de me tirer d'affaire. En un rien de temps, il m'eut fait mon paquetage et plié mes couvertures. Il était temps. Un cri : "Fixe!" Tout le monde se découvre et se plante, chacun devant son lit, raide comme un piquet. Je fais comme tout le monde. J'allais faire connaissance avec mon lieutenant, chef de groupe : un jeune homme (classe 1914) portant lorgnon, gentil garçon, grand, mince, élancé, fines moustaches. En un mot, un beau gars, le lieutenant Rougier ! Il fit le tour de la chambre, inspectant chacun. Arrivé devant moi : "Tiens, un nouveau. De quelle section venez-vous ? - Je suis engagé, mon Lieutenant, répondis-je. - Ah ! Pourquoi vous êtes-vous engagé ? - Pour être soldat, comme tout le monde, mon Lieutenant !" Je crois que s'il avait continué à m'interroger, je n'aurais plus su quoi dire. J'avais peur, non pas de lui, mais des yeux des autres poilus, braqués sur moi. Oui, ces yeux m'intimidaient. Ils semblaient me dire : "Espèce d'imbécile ! Tu ne pouvais pas rester chez toi ?" Je n'osais regarder personne, tant je sentais poindre de méchanceté dans ces regards ! Enfin, la revue finie, chacun de se précipiter sur moi ! "Tu parles d'un c... ! - T'avais rien à bouffer chez toi ... ? - Tu la crevais ... ! - Si encore tu me libérais en venant faire le c... !" Et mille autres amabilités du même genre. J'en aurai pleuré. Pauvre sot. Ce n'était que le commencement. Je n'avais pas encore 24 heures de service : je n'avais rien vu. Le soir, je fus couché un des premiers. Le lendemain matin, il n'y avait presque rien à faire : nettoyage des chambres le matin, c'était tout. Après avoir terminé de ranger mon paquetage, je m'en fus avec mon voisin de lit, un nommé Détré, jusqu'à la cantine, seule promenade qui nous fut permise, car le quartier était rigoureusement consigné. Défense expresse de sortir en ville. L'après-midi, il faisait un temps splendide. Nous fûmes visités par les taubes. Un coup de clairon nous donnait l'alarme : tout le monde devait descendre dans les couloirs du rez-de-chaussée, et ne plus bouger. A un autre coup de clairon, l'alerte terminée, on pouvait rentrer. Trois fois dans l'après-midi, il en fut ainsi. Mais les taubes s'en retournaient comme ils venaient, sans rien lâcher, se contentant de prendre des photographies. A l'est, au nord et au sud, le canon grondait. Les lignes, en effet, n'étaient qu'à une quinzaine de kilomètres de Verdun : on entendait parfaitement le bruit de la canonnade, quoique le secteur soit assez calme. Le soir arriva enfin, et je me couchai fatigué de ma journée.  Le lendemain matin, 7 février, je me réveillais en sursaut, en entendant un vacarme infernal dans la chambre. Le clairon venait de sonner le réveil. Voyant tout le monde levé, d'un bond, je fus en bas du lit et je ne fus pas long à m'habiller. Je devais aller le matin à la visite d'incorporation, sorte de deuxième conseil de révision. En quelques minutes, pesée, toise, mensuration de la poitrine, exercices de vision, tout fut passé. J'étais admis à sur les contrôles de la 164 R.I. Je rejoignis ma section pour la soupe. Questions à n'en plus finir naturellement. Après la soupe, je commençais mon entraînement militaire. J'étais habillé, comme mes camarades, d'un pantalon de coutil blanc, et d'un bourgeron, blanc également, képi numéro 2, équipement sans arme. Nous descendîmes au signal donné par trois coups de sifflet et nous nous rassemblâmes dans la cour. Je me mis modestement à la gauche, et notre après-midi se passa en gymnastique. Nous remontâmes dans notre chambre vers quatre heures et demie et ce fut la soupe. Ensuite, je partis vers la cantine, seul plaisir qui me fut permis, puisque je ne sais pas jouer aux cartes, et, d'autre part, j'avais trop le cafard pour rester dans la chambre. Qu'y aurais-je fait ? Le lendemain, nous partîmes, sitôt la soupe de dix heures, mangée. Nous devions monter sur la côte Saint-Michel, sorte de grand butte, qui se trouve devant Verdun, face à l'est. Nous passâmes devant le cimetière militaire du Faubourg-Pavé qui commençait à se garnir, puis de là vers la caserne Marceau, et, enfin, nous arrivâmes en haut sur la butte. Malheureusement, le temps était trop couvert. Autrement, nous aurions dû voir les lignes. Notre déception dura peu. Après une courte pause, pendant laquelle les boules de neige allèrent leur train, nous redescendîmes vers Miribel. Après avoir mangé la soupe, nous nous couchâmes, satisfaits de notre journée. Le lendemain matin, mercredi 9 février, un poilu s'était fait porter malade. Nous apprîmes par notre sergent, qu'il avait les oreillons. Aussitôt, l'exercice fut interrompu, pour la section. Nous fîmes nos ballots et nous partîmes nous loger dans un petit bâtiment, l'infirmerie de la caserne Radet en dehors de Miribel. Nous devions y être en observation, en cas de contagion. Nous nous installâmes là, une huitaine par chambre; nous étions très bien et ne regrettions nullement les chambrées de la caserne. L'après-midi, nous devions passer à la vaccination anti-thyphoïdique. Nous nous mettions nus jusqu'à la ceinture, car la piqûre se faisait derrière l'omoplate gauche à l'aide d'une seringue Pravaz. Je ne voyais pas mon tour s'avancer sans appréhension. En effet, je constatais que tous les poilus qui passaient, faisaient une singulière grimace. Dès ce moment je fus bien convaincu, que ce devait être une souffrance terrible, d'autant plus terrible, que l'aide, avant de passer, tout en badigeonnant l'endroit à piquer, à la teinture d'iode, nous murmurait : "Surtout ne bougez pas. Si l'aiguille cassait dans votre peau, ce serait une sale affaire !" Enfin, mon tour arriva. Badigeonnage, puis en avant pour la piqûre. Instinctivement, je serrais les dents. Je sentis le major me prendre la peau entre deux doigts, une légère piqûre et ce fut tout. Ce n'était pas bien terrible, et je regrettais sincèrement mon moment d'émotion. Nous nous rhabillâmes, et, en ordre, nous retournâmes à l'infirmerie. Lorsqu'on venait d'être piqué, on avait droit, d'autorité, à 24 heures de repos. Le lendemain, donc, nous restâmes dans nos chambres, ayant comme seule nourriture, de la soupe et des légumes, le tout submergé par l'eau et le café qui nous servaient de boissons. En effet, on ne devait pas manger de viande, ni boire d'alcool, sous peine de fièvre. Notre journée se passa donc à fumer, lire, écrire et jouer aux cartes, car je commençais à ce moment-là, à m'initier aux mystères de la manille aux enchères. Le soir vint vite, et je ne fus pas des derniers à vouloir me coucher. J'allais m'introduire dans les draps, lorsque mes pieds rencontrèrent une résistance. Mes voisins de lit avaient profité de ce que j'étais parti aux cabinets pour rouler les draps et les attacher avec une ficelle. Je ne dis rien et mes pieds, ayant réussi à passer de chaque côté du noeud, je dormis tout aussi bien. Mais je me promis à moi-même, que ce ne serait pas perdu. Je fus un des premiers levés, le lendemain matin. Dès le réveil, j'étais debout, ne gardant plus comme souvenir de ma piqûre, qu'une légère ankylose du bras, car le sérum, agissant dans l'épaule, immobilisait le bras gauche toute la journée pendant laquelle il faisait son effet. Je partis chercher le jus. Il fallait aller à la cuisine de la compagnie à Miribel. En passant près du parc aux voitures, je me munis d'une corde, que je cachais sous mon matelas, sitôt rentré dans ma chambre. La journée, nous fîmes un peu d'exercice avec notre sergent comme chef de section, car même aux heures de travail nous restions isolés des autres sections. Le soir, je m'arrangeais à me coucher le dernier. J'avais auparavant, préparé ma corde. J'avais repéré celui que je croyais être l'auteur de ma farce, et je me disposais à lui en jouer une autre de ma façon. Nos lits comprenaient une sorte de sommier métallique plat, composé de cinq lamelles d'acier, le tout monté sur deux tréteaux en fer, et se tenant par de petites têtes de métal qui s'adaptaient aux trous correspondants aménagés dans le sommier. Le tréteau de la tête du lit était plus haut que celui du pied donnant ainsi une certaine inclinaison au sommier. J'attachais solidement ma corde au tréteau du pied, et comme le lit me faisait face de l'autre côté de la chambre, je n'eus qu'à faire passer ma corde sous la table et en amener le bout près de mon lit. Cela fait, je me couchais tranquillement, après avoir soufflé ma lampe à pétrole qui nous éclairait. ...J'attendis une dizaine de minutes, puis prenant le bout de la corde, je tirais un bon coup et je jetais le bout à la volée, dans la chambre, de manière que le poilu ne puisse voir d'où l'on avait tiré. Il est facile de prévoir ce qui devait arriver. Le tréteau, tiré violemment, céda sous la violence du choc. Le sommier n'étant plus maintenu, de par son inclinaison, partit en avant, entraînant le matelas, la paillasse et le poilu qui, juché si haut, commença par aller choir par terre. Mais il arriva une chose que je n'avais pas prévue. La chambre était carrelée. Le sommier glissant sur les carreaux polis, vint donner dans un des tréteaux de la table, l'emmenant du même coup dans son voyage. Le verre de la lampe vint se briser à terre, en faisant un vacarme effroyable, réveillant du même coup, non seulement les poilus de la chambre, mais ceux de la chambre voisine. Deux minutes ne s'étaient pas écoulées, que le caporal, qui couchait dans une pièce à côté, apparaissait en chemise, une lampe à la main. Il voulut connaître le nom du coupable. Seuls des rires étouffés, sous les draps et sous les couvertures, lui répondirent. A bout de patience, il sortit en grommelant des menaces : "Nous verrons cela demain", bougonnait-il. Le poilu n'eut que la peine de refaire patiemment son lit, dans l'obscurité (l'extinction des feux étant sonnée, toute lumière était interdite). Il était en colère, et j'étais bien vengé. Le bleu commençait à se débrouiller. Le 12, pour la première fois, nous sortîmes nos fusils, afin d'apprendre à former les faisceaux. Il faisait un beau froid sec. La neige gelée craquait sous nos pas. Nous montions par la caserne Marceau, que nous dépassâmes quelque peu. Là, avant la pause, théorie du sergent et commencement de l'étude du mouvement décomposé. Au bout d'une heure d'exercice, nous savions former et rompre les faisceaux, réglementairement. Il me parut bien lourd le fusil. Je n'avais jamais porté une arme aussi longtemps, et il me semblait que je ne pourrais pas faire beaucoup de kilomètres, avec cet outil, et le sac en plus. Pauvre vieux !! Pauvre innocent !! Le lendemain matin, étant un dimanche, 13 février, nous nous promettions de dormir comme des bienheureux, jusqu'à neuf heures, au moins, lorsqu'à huit heures, à peine, le sergent s'amène en coup de vent : "Montez vos sacs en tenue de départ. Préparez vos baluchons, et en vitesse." Nous avions été avertis, en effet, par des théories, qu'en cas de départ, nous faisions un ballot, avec tous nos effets numéro un, ne portant sur nous que les effets numéro deux (effets de drap et de treillis). Lorsque mon sac fut monté, j'eus un soubresaut d'épouvante, en le pesant et en voyant mes musettes garnies, que j'avais pendues au pied du lit. Jamais nous n'avions porté le sac. Jamais je ne pourrais mettre ça sur mon dos. Et, pourtant, lorsque tout le monde fut prêt, et que le sergent cria : "Rassemblement !", il fallut bien installer les musettes et le sac sur le dos !!  Les premières minutes, le tout ne me parut pas trop lourd, la charge étant bien équilibrée. Mais en arrivant dans la cour de la caserne, où s'effectuait le rassemblement de la compagnie, je ne fus pas fâché de poser sac à terre. Il était dix heures : ce fut la distribution de la soupe, puis des vivres d'embarquement, car nous devions prendre le train, pour une destination inconnue. Ensuite, étant tranquilles, nous discutâmes vivement, sur le motif de notre départ, sur la destination, sur le temps de trajet que nous aurions à accomplir. Enfin, un tas de tuyaux circulèrent. On allait du côté de Dijon, puis du côté de Châlons. Enfin, un infirmier nous annonça que nous allions à Wassy, dans la Haute-Marne. Nous partions avec la classe 17 du 166, qui se trouvait à la caserne Radet. Enfin, vers trois heures, un cri retentit, des ordres circulèrent. Nous partions. Nous mîmes nos sacs à dos, et en route ! Le départ eut lieu au pas cadencé. Bon sang de bon sang, que c'était lourd ! Au bout de deux kilomètres, je marchais cassé en deux. Heureusement que nous étions près de la gare. Nous allions embarquer à la gare de marchandises. Un train composé, uniquement, de wagons à bestiaux (sauf une voiture de première classe, réservée aux officiers) nous attendait. Une demi-heure pour l'embarquement, une heure d'attente, et en route. Il était près de six heures lorsque nous partîmes. Il faisait déjà nuit. Nous étions 44 dans notre wagon, plus les sacs et les fusils, et, par dessus tout, les musettes et l'équipement, pendus après des clous. A chaque cahot du train, le tout nous cognait dans la tête. Il est vrai que nous étions tellement serrés, que nous n'avions guère de place pour bouger. Mais cela avait un autre avantage : celui de nous tenir chaud, car il ne faut pas oublier que nous étions au 13 février et qu'il y avait de la neige au dehors. Enfin, après bien des gueulements et des cigarettes fumées, les habitants du wagon s'endormirent... Quand on se réveilla, le train était arrêté. Il faisait nuit. Nous étions transis de froid, et de plus, défense de bouger. Un poilu se risqua à ouvrir la porte, afin de regarder au dehors. Il nous rendit compte qu'il croyait bien que nous nous trouvions sur une voie de garage, à proximité d'une gare car, un peu plus loin, brillaient des lumières. Le jour vient lentement. Enfin, à sept heures, un ordre passa que l'on ait à envoyer deux poilus par wagon pour aller chercher le jus. Bonne surprise. Encore meilleure, lorsqu'il arriva bouillant et copieusement arrosé de gniole. Il nous fallait bien cela pour nous réchauffer. Un peu de pas gymnastique sur le quai, une cigarette, et nous étions d'aplomb. On nous annonça alors, qu'il fallait descendre notre fourbi, et nous équiper. Par un employé du chemin de fer qui passait là, bien à point, nous sûmes que nous étions à Wassy. Ainsi donc, le tuyau de l'infirmier était bon. Rassemblement, la clique en tête, face au pays. Des ordres et en route, au pas cadencé. Dix minutes après, nous nous arrêtions dans la grande rue de Wassy, au-dessous de l'église. On forma les faisceaux et la pause. On nous apprit que nous allions loger chez l'habitant et qu'il fallait avoir de la tenue, en un mot, un petit speech, ô pas trop long, juste suffisamment pour qu'il ne devienne pas rasoir. On nous distribua les billets de logement, à raison de un lit pour deux hommes, et je partis avec mon congénère, vers la maison dont j'avais l'adresse. Un premier échec nous attendait. Il y avait un malade dans la maison. Je n'insistais pas et retournais à la mairie où l'on me donna un nouveau billet. Nouvelle maison : nouveau déboire. La famille était trop nombreuse et logée trop à l'étroit, pour pouvoir recevoir des soldats. Comme nous discutions sur le pas de la porte, la voisine nous interpella : "Alors, vous ne trouvez pas de logement, mes pauvres petits ? - Mais non, Madame, voici la deuxième maison à la mairie nous envoie, et deux maisons où l'on ne peut pas nous recevoir. Il nous faut retourner chercher un troisième billet de logement. - Eh bien, écoutez, allez-y, et si vous ne pouvez pas être logés, là où vous irez, venez ici il y a la chambre de mon fils qui est libre, puisque il est soldat, vous la prendrez. - Merci beaucoup, Madame. Mais nous allons tenter la chance une troisième fois, et nous userons de votre offre, si nous ne trouvons pas." Là-dessus, nous partîmes, mon camarade et moi, ragaillardis par cette offre aimable. Nous étions sûrs d'être logés. Pour la troisième fois, nous fîmes irruption à la mairie où l'employé nous remit un billet de logement, après avoir pris nos déclarations en ce qui concernait les habitants de la dernière maison où nous nous étions rendus. La maison dont il venait de nous donner l'adresse se trouvait dans la rue de la Madeleine, précisément la rue d'où nous venions. Nous arrivons à la maison indiquée. Une femme encadrée de deux petits moutards et un troisième sur les bras vint nous ouvrir. Explications, sursaut de la bonne femme : "Oh : Mes pauvres petits ! Où voulez-vous que je vous loge ? J'ai quatre enfants, dont trois en bas âge et je n'ai pas suffisamment de place pour vous loger. Tout ce que je peux vous offrir, c'est le grenier." Nous n'aurions pas eu autre chose, que nous aurions accepté de bon coeur. Mais nous préférions coucher dans un bon lit que sur la paille. Aussi, nous refusâmes catégoriquement son hospitalité, et nous repartîmes vers la maison où on nous avait demandés. Là, on nous fit entrer dans la salle à manger. Il y avait déjà deux caporaux installés. Croyant la place prise, nous voulûmes battre en retraite, mais la vieille femme qui nous avait interpellés, ne l'entendit pas de cette oreille : "Vous n'avez rien trouvé, mes pauvres gars. Eh bien, ça ne fait rien. Ces messieurs vont coucher ici, en bas, et vous deux, vous coucherez dans la chambre du haut." Nous acceptâmes volontiers l'offre qui nous était faite, et nous voulûmes repartir chercher nos affaires : "Mais non ça ne presse pas, nous dit notre hôtesse. Je suis en train de faire le café. Quand vous aurez déjeuné, vous irez !" Force nous fut d'attendre. Nous en étions d'autant plus heureux que nous ne demandions pas mieux. J'avais l'estomac dans les talons. C'est que n'avoir pas mangé depuis la veille à midi, à dix-sept ans, ça se sent. Nous nous restaurâmes donc avec du café au lait, bien chaud, du pain et du beurre, et nous partîmes chercher nos affaires. Après l'installation, ce fut la soupe. Nous mangions, toute la section réunie, dans la boutique déserte d'un tailleur. Pendant le repas, ce fut un échange de réflexions sur la bonne réception que nous avait faite les gens du pays: "Oh, moi, disait l'un, je suis bien, j'ai une chambre superbe, et un pajot, je ne te dis que ça ! - Eh bien, et moi, disait un second, je suis chez le bistro, y m'a payé la gniole en arrivant ! - Moi, disait un autre, je suis chez le boulanger, qu'est-ce que je vais bouffer comme petits pains chauds, le matin !" Etc. Etc... Cela n'arrêtait pas. Chacun était mieux que le voisin, ce qui prouvait que tout le monde était content de son sort. L'après-midi, nous avions quartier libre. Promenade de visite dans le pays. Relations avec les marchands de cartes postales et la soupe du soir fut vite arrivée. Après la soupe, nous partîmes, mon camarade et moi, chez notre hôtesse, avec l'intention de nous coucher. Dans la salle à manger, se trouvaient déjà les deux caporaux, causant avec la vieille dame et sa fille, dont le mari était soldat. La maison voisine était habitée par la tante de cette jeune femme, et son fils; ils logeaient deux soldats, eux aussi. Après quelques minutes de causerie, ces derniers vinrent tous dans notre maison. La tante se mit à la fabrication de gaufres, pendant que la jeune femme faisait le thé. Pendant ce temps, nous jouions aux cartes ou aux dames, ou nous causions tout en fumant. Quand le thé fut prêt, on s'assemble tous autour de la table et la causerie devint générale, jusqu'au moment, où quelqu'un regardant sa montre, s'aperçut qu'il était minuit passé. Il était temps d'aller se coucher. On se sépara, contents les uns des autres, et nous plongeâmes dans un bon lit, où nous nous endormîmes d'un bon sommeil réparateur, car la nuit précédente, nous n'avions pas dormi bien tranquillement, et il fallait être frais et dispos pour la période d'instruction intensive qui se préparait. Les centres d'instruction. Le lendemain matin, 15 février, à six heures et demie, le clairon sonnait le réveil, dans les rues de Wassy. Nous nous levâmes tranquillement, et nous descendîmes avec notre fusil et notre équipement, sans oublier notre quart, car la section se rassemblait devant la maison où nous mangions la soupe, après avoir pris le jus, qui était apporté dans cette maison. A partir de ce jour, nous primes le fusil pour tous les exercices, car nous commencions à apprendre les premiers mouvements avec l'arme. L'exercice du matin comprenait une heure d'exercice avec l'arme et une heure de gymnastique, jeux et course. L'après-midi, marche ou exercice au loin, tandis que le matin, nous restions dans la promenade de Wassy. Au point de vue rapports avec les habitants, nous étions très bien vus, surtout ceux du 164. Nous étions les premières troupes cantonnées dans le pays, et de plus de jeunes soldats, car la classe dix-sept fut, de toute la guerre, celle qui fut appelée le plus tôt. De plus, nous étions propres, toujours astiqués, brossés et cirés. C'était un ordre, tandis qu'au contraire, la classe 17 du 166, qui était là avec nous, n'était pas du tout astiquée, et habillée d'une manière beaucoup plus disparate que nous. Ils étaient peut-être aussi propres, mais ça se voyait moins. Par contre, à l'exercice, la différence était sensible. Notre manoeuvre était beaucoup mieux réussie et plus nerveuse. En un mot, on avait un chic d'ensemble, surtout, qu'ils n'avaient pas. Toutes les journées, ce fut pareil : exercice le matin, et l'après-midi. Le soir, après la soupe, nous rentrions chez notre hôtesse, et, chaque soir, c'était la répétition de la veille : causerie, jeux, tabac, thé et gaufrettes. Cette existence dura plusieurs jours. Le lundi, suivant notre arrivée, c'est-à-dire, le 21 février, nous fûmes vaccinés pour la seconde fois. Mais je ne sais pas d'où cela vint, le major me fit bien plus mal que la première fois. Comme nous avions 24 heures de repos d'office, sur la proposition que m'avait faite mon hôtesse, je demandais au sergent l'autorisation de ne venir que le lendemain, que pour la soupe, autorisation qui me fut accordée. Je me sentais de la fièvre. Le sérum travaillait. Le soir même, je ne pouvais plus remuer le bras gauche, tellement l'épaule me faisait mal. J'eus un mal de galérien, à retirer ma veste, mais j'y réussis néanmoins, et je me couchais avec plaisir, car la fièvre me tourmentait. J'avais le lit pour moi seul, mon camarade étant parti coucher ailleurs. Je ne l'avais pas regretté, car cela me faisait plus de place. Je passais une bonne nuit, et le lendemain matin, je me trouvais si bien dans le lit, que je fis mentalement, le sacrifice de mon jus, afin de ne pas avoir à me lever. Je me trouvais dans l'engourdissement du demi-réveil, lorsque la vieille dame, vint frapper à ma porte, et entra : "Dites-moi, que préférez-vous le matin, du café noir, ou du café au lait ? - Je vous remercie, Madame, mais ne vous dérangez pas pour moi. - Je ne vous demande pas de me dire si ça me dérange. Répondez plutôt à ma question : café noir ou café au lait ? - Oh ! Ca ne fait rien ! Ce que vous voudrez !" Elle n'attendit même pas les paroles de remerciements que je lui adressais, et s'en fut. Cinq minutes plus tard, elle m'apportait sur une assiette, un grand bol de café au lait bouillant, flanqué de deux respectables tartines de pain beurré. "Tenez, avalez-moi ça ! Cela vous fera du bien !" Je la remerciais avec effusion, et elle partit tout heureuse du plaisir qu'elle savait m'avoir causé. Inutile de dire que j'engloutis parfaitement bien le tout et je me rendormis bien tranquillement jusqu'à dix heures. J'avais juste le temps de m'habiller et de courir à la soupe. Après le repas, je retournais à la maison, où je passais mon après-midi à confectionner, à l'aide d'un moule, des cigarettes pour le mari de la jeune femme. Un intermède pour la soupe du soir et nous nous retrouvâmes tous en famille pour prendre le thé, en lisant les journaux qui annonçaient le déclenchement de la formidable offensive boche sur Verdun, le 21 février 1916. Nous commentions cet évènement en le rapprochant de notre fuite de Verdun, et alors nous apparut la cause de notre départ. Le lendemain, nous apprîmes exactement ce qui s'était passé. Le 12, un groupe de boches étaient venus se rendre, dans nos lignes, déclarant qu'il ne voulait pas se faire tuer, ce qui ne manquerait pas, car une formidable bataille pour Verdun, se préparait du côté boche. C'est alors que le commandement prit ses dispositions, pour la défense, et que dans la nuit du 12 au 13, des ordres arrivèrent, pour nous faire évacuer. Mais non n'en fûmes avertis que le matin du 13, puisque le déménagement ne devait s'opérer que dans la journée. Et voilà donc la raison toute simple, qui nous avait fait partir de Verdun. Cela avait donné lieu à beaucoup de commentaires mais personne n'avait pensé à la vraie raison. Ce jour-là, l'après-midi, il n'y eut pas d'exercice. Nous devions occuper des locaux déserts qui avaient été aménagés, et dans lesquels on avait installé des paillasses et des sacs de couchage. Je quittai donc mon bon lit, non sans regret. Au rapport, on demanda des soldats ayant quelque instruction, pour suivre un cours d'élève-aspirant, après concours. Ma foi, je voulus me risquer, et je me fis inscrire. Ce fut tout à ce sujet, car il fallait attendre que notre candidature soit examinée par le capitaine Godefroy, commandant la 37e, et par le commandant Vuillaume, chef de bataillon du 166e, commandant d'armes de Wassy. Au bout de quatre ou cinq jours, on alla voir le commandant qui nous interrogea sur notre instruction générale, nos idées. En un mot, sur toutes les questions, pouvant lui permettre de se faire une opinion. Cet interrogatoire nous prit toute la matinée. L'après-midi, pour la troisième fois, nous dûmes passer à la vaccination. Cela nous fit un jour de repos complet pour le lendemain. Au rapport du premier mars, on nous lut les noms des hommes qui étaient admis à passer le concours des candidats-élèves-aspirants.  A la 37e, nous devions être groupés en une section spéciale, afin de nous permettre d'étudier à loisir. Mais, comme il n'y avait pas de locaux disponibles pour nous loger, nous reçûmes des billets de logement. On m'en remit un pour le pharmacien de Wassy. J'y allais avec un camarade qui devait coucher avec moi. Je croyais être aussi bien qu'à la première maison. Mais, quelle déception ! Tout d'abord, comme logement, une petite chambre, faite à l'aide de cloisons dans le grenier de la maison. Pas de cheminées. Comme meubles, un lit et une table de nuit. L'air entrait là, comme chez lui et il n'y faisait pas chaud. C'était l'ancienne chambre de la bonne du pharmacien. Comme elle était partie, la place se trouvait libre. Le soir, lorsque nous rentrâmes à la pharmacie pour aller nous coucher, un bonsoir fur échangé en passant et ce fut tout. Le lit, à peine assez large pour deux personnes, nous obligeait à dormir tous deux sur chacun des bords. Enfin, après une mauvaise nuit, nous partîmes bien vite prendre le jus chaud, car nous étions gelées et nous avions mal dormi. Nous allions à l'exercice à part, encadrés comme les autres sections. Le soir, nous avions une salle de l'école de Wassy à notre disposition pour y étudier à notre aise. Ma foi, j'y restais assez tard, car je me souciais peu de rentrer de bonne heure dans notre chambre froide et nue, quoique, une fois couchés, nous avions un peu plus chaud, car nous y avions amené nos couvertures, et de cette manière on pouvait tenir. Le 3, nous passâmes un petit examen pratique : gymnastique, maniement d'arme, etc. devant le commandant Vuillaume et le capitaine Godefroy. Sur vingt-et-un que nous étions d'inscrits douze seulement restèrent, pour la proposition qui devait partir au ministère de la guerre. Puis nous reprîmes l'exercice. Cela dura plusieurs jours, coupés seulement le 6 par une quatrième et dernière vaccination et une journée de repos, le 7. Le 8 mars, nous eûmes repos pour la préparation du départ. Il fallut monter les sacs et faire les ballots individuels. Nous partions le lendemain pour Laval, où se trouvait notre nouvelle garnison. Le soir, ce fut la visite d'adieu à Wassy, et le jeudi 9 mars, nous quittions Wassy à destination de Laval. J'avais écrit la veille à mes parents, comptant bien passer par Noisy-le-Sec, mais loin de là. L'itinéraire fut celui employé en général par les trains de troupe : Wassy, Brienne, Neufchâteau, Troyes, Sens, Montargis, Orléans, Chartres, Nogent-le-Rotrou, Le Mans et Laval. Nous arrivâmes le 10 dans cette dernière ville, à trois heures et demie de l'après-midi, après un voyage relativement rapide. Nous traversâmes la ville au pas cadencé, pour nous rendre au quartier. Mais quelle trotte ! La caserne Schneider, où nous allions, se trouve bien à trois kilomètres de la gare. Nous primes une bonne suée, surtout en montant la rue d'Ernée, en haut de laquelle se trouve cette caserne. Le soir, le quartier resta consigné, car c'était le premier jour que nous étions là, et nous n'avions pas encore fini l'installation et de plus nous avions encore à recevoir pas d'instructions avant d'être lâchés. Nous continuâmes l'exercice, comme à Wassy, matin et soir jusqu'au samedi 18 mars. En effet, la date de l'examen pour devenir élève-aspirant étant fixée au 20 mars et devant se passer à La Flèche pour tous les régiments de la région, il fallait que nous y soyons avant cette date. La journée de samedi fut occupée à préparer les sacs et les ballots, car nous devions partir de très bonne heure le dimanche matin. A trois heures, un homme de garde venait nous réveiller et à quatre heures nous partions. A huit heures et demie, nous arrivions au Mans, à la Suze à dix heures et à la Flèche à trois heures. Le restant de la journée se passa en installation et en ultime révision, car l'examen commençait le lendemain matin 20. A neuf heures moins le quart, nous arrivions devant le Prytanée où avait lieu le concours. Jusqu'à onze heures, nous séchâmes sur la composition française (la bravoure , tel était le sujet). De deux à quatre, c'était l'histoire de France. En sortant, nous échangions des commentaires qui allaient bon train. La soirée se passa dans la visite de La Flèche. Le lendemain matin ainsi que la veille, nous fûmes rassemblés devant le Prytanée, afin d'y entrer en ordre, et ce fut la composition d'arithmétique, de neuf à onze. A onze heures la soupe, et à deux heures, dernière phase de l'examen : la géographie. A quatre heures tout était fini. Nous rentrions au cantonnement, n'ayant plus qu'à attendre le résultat, tout en allant à l'exercice afin de n'en pas perdre l'habitude. Le 16 avril, j'eus enfin ma première permission de 24 heures pour Paris. C'était le quatrième dimanche que nous passions à La Flèche. Les trois premiers je n'avais pu en obtenir. Aussi, cette permission me fit-elle grand plaisir. J'y retournais d'ailleurs le dimanche suivant pour Pâques, ce devait être mon dernier jour de fête passé à La Flèche. En effet, le peloton était dissous le 27. Je n'étais pas reçu : je devais donc rentrer au 164e. Nous regagnions Laval, le 28 et le premier mai, nous partions pour la permission obligatoire de huit jours qui avait été accordé, pour Pâques, à toute la classe dix-sept. Le 8 mai, j'étais rentré au corps, après un bon repos, et à partir de cette date, commença la vie d'exercice monotone et fatigante. Le 24 mai, nous allâmes à une prise d'armes pour remises de décorations : la première à laquelle nous assistions. La troupe était représentée par la classe 17 du 164e, du 124e, du 54e, et du 18e chasseurs cyclistes. La légion d'honneur fut remise à un lieutenant de chez nous : Naboudet, commandant le deuxième groupe et la médaille militaire à quelques poilus du régiment ou en séjour dans les hôpitaux. L'exercice, les manoeuvres, le tir... tout cela continua de plus belle, jusqu'au jour où ayant attrapé mal à la gorge j'entrais à l'infirmerie. J'y restais bien sagement jusqu'au 13 juillet. A cette date, nous quittâmes Laval pour Evron, situé à trente-cinq kilomètres de là et où devait se tenir notre centre d'instruction. Le samedi 15 juillet, eut lieu le départ de la classe dix-sept, pour le bataillon de marche : premier pas fait dans la direction du front. Lorsque j'appris ce départ, c'est-à-dire la veille, j'allais trouver le capitaine Godefro en lui demandant de me faire partir avec ce renfort, mais il ne voulut rien savoir. Comme on ne prenait que les plus bas matricules, force me fut de rester là, puisque j'étais arrivé dans les derniers, j'avais forcément un matricule plus élevé que les autres. C'était la première cérémonie du genre. Les poilus partaient pour Laval, se faire habiller de bleu-horizon, et de là, point de direction : Rouvres, près Mirecourt, dans les Vosges. Avant leur départ, toute la compagnie fut rassemblée sur la place de la mairie d'Evron, formation en carré, les partants formant un des côtés du carré. Après avoir commandé le garde à vous, le capitaine leur adressa la parole : "N'oubliez pas que vous appartenez au 164e, et quelque soit l'écusson que vous portiez, souvenez-vous que vous devez toujours et partout soutenir le bon renom du 164e. Nous irons d'ailleurs bientôt vous rejoindre et ce sera au cri de : 32-106-4, en avant ! que nous repousserons les boches, jusqu'à nos frontières. Gardez-donc toujours le souvenir de vos chefs et montrez là-bas, la même discipline et le même entrain que vous avez montré jusqu'à présent. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas pouvoir vous y accompagner moi-même. Mais lorsque la vaillante 32e sera reformée, vous me trouverez toujours à votre tête pour vous conduire sur la route du devoir !! - Clairon au 164." Alors, éclata le refrain du régiment : 164e, tout nouveau, Honneur à lui, Face à l'ennemi.  Puis ce fut le défilé devant les partants présentant les armes; nous primes la direction de la gare, devant l'entrée de laquelle, nous formâmes une double haie. Quand le train s'ébranla, ce furent de cris à n'en plus finir de : vive le capitaine ! Vive le lieutenant Rougier ! Tous, les hommes autant que les officiers, étaient très émus, surtout le capitaine Godefroy qui était très aimé des poilus à qui il le rendait bien, car il était très bon pour tous. Ce fut la première séparation d'un tronçon de la compagnie : cent-vingt-cinq hommes de moins. L'exercice à grande échelle, reprit de plus belle. Mais nous avions, néanmoins quelques distractions, notamment les bains à l'étang de Mésanger, près d'Evron. La première fois que nous y allâmes, il y avait une barque, au milieu, montée par trois ou quatre hommes, dont deux armés de gaffes, qui fouillaient au fond de l'eau. A un moment où ils s'approchèrent du bord, nous apprîmes qu'ils recherchaient le corps d'un instituteur qui s'y était noyé la veille, quoique très bon nageur. Il est vrai qu'il y avait tellement d'herbes ! Mais cela ne nous refroidit pas et nous primes, néanmoins, un bon bain, avec promesse d'y retourner le plus souvent possible. A ce sujet, nous fumes attrapés deux jours plus tard, car un ordre parut, interdisant aux isolés, d'aller se baigner sans autorisation, ni surveillance. Il est vrai qu'il y en eut beaucoup qui passèrent outre, mais quelques punitions bien appliquées leur firent abandonner toute idée de baignade. Bientôt, les permissions agricoles commencèrent pour les cultivateurs. Des départs eurent lieu tous les jours. D'en voir filer comme ça, ça nous donna bien le cafard, surtout aux parisiens, à qui cet espoir n'était pas permis. Enfin, le premier août, nous partions à notre tour, mais non pas en permission ! Nous étions envoyés en équipes de quatre ou cinq, dans de petits pays de la Mayenne. Je fus désigné, avec quelques autres pour Laigné, un petit pays placé entre Mayenne et Craon. Nous partîmes d'Evron, le premier. Nous devions, d'abord aller à Laval, où nous arriverions vers sept heures du soir, passer la nuit dans la caserne Schneider, et repartir, le lendemain matin, à quatre heures quarante pour Ampoigné, la gare qui desservait Laigné. Tout se passa le mieux du monde. Nous arrivâmes vers neuf heures à Laigné, où nous allâmes voir le maire qui devait nous répartir entre différentes fermes. Je fus envoyé à la ferme de Chassebourg, chez Madame Reillon, à quinze cent mètres de Laigné. En arrivant, je leur tins un petit discours de ma façon, que j'avais préparé, afin d'empêcher toute surprise de leur part. "Je ne suis pas cultivateur, mais, ma foi, si je peux vous être utile, je ne demande pas mieux que de rester. Avec un peu de bonne volonté, je pourrais peut-être vous rendre quelques services. Mais, vous savez, ne me demandez pas des renseignements sur la culture, car je n'y connais rien du tout." Je pense qu'ils furent favorablement impressionnés par ce petit speech, car ils m'assurèrent que dans une ferme, on pouvait mettre à contribution, toutes les bonnes volontés, et qu'avec un peu de courage, on satisfaisait à tout. Aussi, le lendemain, je commençais mon métier de cultivateur. La moisson battait son plein, je n'eus pas la peine de chômer, je me mis à ramasser les gerbes de blé, et au bout de deux jours, je savais les attacher... Mon père, ayant son congé à ce moment, et ma mère chômant un peu, ils vinrent me rejoindre au bout de huit jours, pour passer avec moi les derniers temps de ma permission. Ils se logèrent à Laigné, chez une aubergiste, Madame Leduc; dans la journée ils faisaient un tour à droite ou à gauche, visitant les alentours; faisaient une courte apparition au champ où nous travaillions, et le soir venu, j'allais les rejoindre à Laigné, pour dîner avec eux. Cette existence dura huit jours. Au bout de ce laps de temps, nous quittâmes ensemble Laigné, moi me dirigeant vers Evron et mes parents vers Paris. ...La vie de caserne recommença pour tout le monde, jusqu'au trois septembre. Ce jour-là, nous apprîmes qu'un second départ de renforts allait avoir lieu. Je courus, encore une fois, au capitaine, et, cette fois, je fus inscrit en tête de liste... Le bataillon de marche. Nous partîmes d'Evron, le 6 septembre, à destination de Laval, où nous devions être habillés et équipés, suivant les lois de la guerre moderne, ce qui fut fait, le 7, dans l'après-midi. Après plusieurs journées d'attente abominable, pendant lesquelles nous n'avions que la ressource de l'exercice, les bruits de départ arrivèrent le 16, et, effectivement nous partîmes le 17 septembre, au matin, furtivement, comme des voleurs, sans musique et par des chemins détournés. 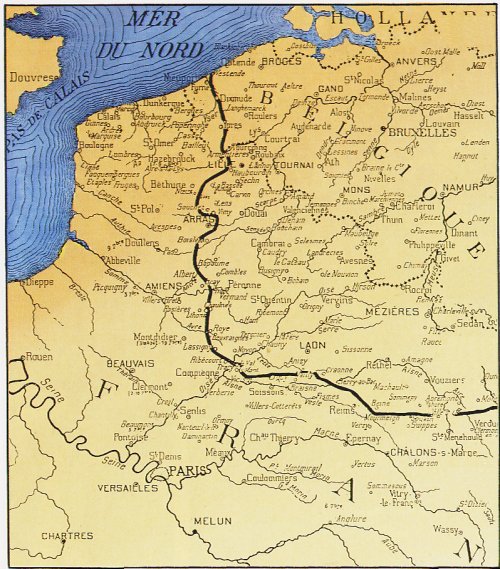 Nous passâmes la nuit, à Juvisy, d'où nous démarrions, vers quatre heures du matin, le 18. Nous arrivâmes à Troyes, vers quatre heures du soir, le 19, et enfin à Oëlleville, près Mirecourt, but de notre destination, le 20 septembre au matin. Nous étions descendus à Frenelle-la-Grande, et nous dûmes faire, après 53 heures de voyage en chemin de fer, sept kilomètres à pied, pour gagner Oëlleville. Nous eûmes repos la journée du lendemain, 21, afin de nous permettre de nous installer. A partir de ce jour nous avions définitivement quittés le 164 pour appartenir au neuvième bataillon de marche du 155 R.I. 33e compagnie. Ce fut ensuite l'exercice qui reprit, car quoique étant dans la zone des armées, ce n'était pas encore le front... et loin de là !!! Quelques jours plus tard, je fus désigné pour suivre un cours de mitrailleur. Pendant huit jours, il nous fallut faire matin et soir, l'aller et le retour, Oëlleville-Frenelle, pays où se tenait le cours. J'en sortis avec la mention très apte; ça m'avait intéressé et j'y avais pris goût. Cependant il était une chose que je ne perdais pas de vue, c'est que je n'étais pas allé en permission depuis le huit mai, alors que les autres avaient eu quatre jours, avant leur départ au 155, seulement mon départ n'avait pas été prévu, et je n'avais pas pu bénéficier de ce tour de permission, et d'autre part les équipes agricoles ne comptaient pas, puisqu'on n'avait pas été chez soi. J'attendis donc impatiemment qu'on en parle. Le mois d'octobre passa ainsi en exercices et en fréquents déménagements : le 8, nous quittions Oëlleville pour transporter nos pénates à Boulaincourt, d'où nous partions, le 23 pour nous transférer à Baudricourt. Vers la fin du mois, j'eus une petite crise de courbatures fébriles, qui me fit entrer à l'infirmerie... J'en sortis le dix novembre au matin, avec deux jours, exempt de service : le 10 et le 11. Or, comme comble de chance, au rapport du 10, on nous lit que les permissions reprenaient le lendemain et qu'il en partirait une dizaine par compagnie. Moi, j'en fus très heureux, étant sûr de partir, puisque cela faisait six mois que je n'y étais pas allé. Le soir, à l'appel, le caporal de semaine, en passant dans le grenier, dans lequel on couchait, appelle deux ou trois noms de poilus qui partaient en permission. Il omet mon nom. Je le lui crie, en lui demandant ce que ça voulait dire. Il me répond qu'il n'en sait rien. Mais moi, je veux savoir. Je suis des premiers, je dois partir. Le lendemain matin, étant exempt de service, je n'eus pas à me préoccuper du départ à l'exercice. Je me postais à la porte du sous-lieutenant Hoffmann, qui commandait la 33, en l'absence du capitaine Thomas, permissionnaire, afin de lui demander des explications. Il me répondit qu'étant exempt de service, il ne pouvait me prendre ni pour l'exercice, ni pour les corvées, il ne me prenait pas non plus pour les permissions !! Enfin, après un bon moment de discussion, où je réussis, je crois, à lui faire comprendre que ça faisait six mois passés, que je n'avais pas eu de permission, il me répondit de me débrouiller à me faire supprimer mes deux jours d'exemption de service, et qu'ensuite on verrait. A neuf heures, j'allais à l'infirmerie et je répétais au major, la discussion que j'avais eu avec Hoffmann. Il prit le carnet de visite et à la place de deux jours exempt de service il mit un jour, ce qui me rendait libre pour le 11. Mais ce n'était pas tout, il me fallait établir mon titre de permission. J'allais au bureau, où le sergent-major me répondit qu'il ne pouvait rien faire sans ordre du lieutenant Hoffmann, parti à ce moment à Rouvres auprès du chef de bataillon. Il fallait que j'attende qu'il rentre. Enfin, à midi moins le quart, il fut de retour. Mon titre fut établi. J'avais alors à passer la visite. J'allais trouver tranquillement le major, dans sa salle à manger. On peut être sûr qu'il se contenta de signer ma permission, sans rien regarder, de peur de voir son appétit coupé net. Un cycliste prit alors mon titre de permission pour le porter à Rouvres au chef de bataillon qui avait déjà les autres en sa possessions. Lorsque je fus, enfin sûr de partir, il était une heure. Je n'avais pas même pris le temps de manger, et on filait à quatre heures. Je réussis à être prêt, malgré tout, à l'heure fixée, et le dimanche 12 novembre, je débarquais à Paris, pour ma première permission de détente, dite du front, de sept jours. Inutile de dire qu'elle passa comme en un rêve, et je m'en retournais, le 20 avec un cafard inouï. Le restant du mois de novembre, ainsi que décembre passèrent d'une façon tout à fait monotone. Exercices dans la neige, théories, revues d'armes, etc... Le premier janvier, nous fêtâmes la nouvelle année 1917, à trois ou quatre. Nous fîmes une petite bombe, ô bien modeste, avec le peu de chose dont nous disposions. Le 23 janvier, nous déménagions encore une fois, pour aller à Dombasle, de l'autre côté de Rouvres, sur la route Mirecourt-Neufchâteau. C'est de ce pays que je partis pour mon deuxième tour de permission, le premier février 1917. Encore sept jours de tranquillité ! Les derniers, car la période dure allait commencer. Le 13, je repartis de Paris. Après un voyage mouvementé, comprenant de nombreux changements de train (Revigny, Bar-le-Duc, Gondrecourt, Neufchâteau) j'arrivais le 15, à Baudricourt où la compagnie était revenue, depuis le 8 février. J'y arrivais juste pour apprendre qu'un renfort était parti le matin pour le 41e d'infanterie. J'étais désigné pour en faire partie, mais au dernier moment, on m'avait remplacé. Il est vrai que je ne reculais pas de beaucoup, car on en formait un autre à destination du dépôt divisionnaire du 355, et j'étais le premier à être inscrit sur cette nouvelle liste. Je quittais le neuvième bataillon de marche du 155e, le samedi 17 février 1917, sans remords, ni regret, je dirais même la joie au coeur, car je préférais de beaucoup me diriger vers le front et ses dangers, que rester à l'arrière à faire un exercice que je détestais par-dessus tout... Je devais être servi... et bien servi !!! ... Chapitre premier. Le dépôt divisionnaire. Le 19 février, à cinq heures du matin, nous arrivions en gare de Lizy-sur-Ourcq, à 23 kilomètres de Meaux. Après avoir posé sacs à terre et procédé au rassemblement du détachement, nous nous mettons en route vers Cocherel, petit pays situé à six kilomètres de Lizy et où se trouve le dépôt divisionnaire de la 127e division d'infanterie. Tout le renfort est affecté à la 20e compagnie du 355e, commandée par le capitaine Larrière. Nous avions avec nous dans ce petit pays, les compagnies divisionnaires des 25e et 29e chasseurs, 294e et 172e régiments d'infanterie. En me promenant dans le pays, je fus renseigné par un chasseur, sur le moyen d'aller à Paris, le dimanche. Je me promis d'exploiter son tuyau, dès le premier samedi une fois que j'aurais vu ce qu'était la discipline et les appels à la compagnie. A ce dernier point de vue, il n'y avait rien à craindre. Le sergent passait, matin et soir. Le caporal, sans même s'occuper des poilus, répondait : manque personne, et c'était fini. Il n'était plus question d'un appel nominatif comme au bataillon de marche ou aux compagnies d'instruction. Cela sentait déjà un peu plus le front. Le samedi 24 février, je partis à six heures du soir, sitôt la soupe mangée, vers Lizy-sur-Ourcq, où je devais prendre le train. Le chasseur m'avait expliqué que le train pour Paris passait en gare à sept heures quarante et qu'il arrivait à Paris à dix heures. C'était donc épatant. A l'heure dite, après avoir pris un billet pour Paris-Est, je m'embarquais. J'avais d'abord l'intention de descendre tranquillement à la gare de l'Est en donnant mon billet pour sortir; puis je réfléchis, j'avais tellement entendu dire de mal sur cette gare, que je résolus de trouver un moyen de sortir d'une autre façon. Ce moyen me fut fourni par le train lui-même ! Voici comment : nous marchions bon train depuis Meaux, seul arrêt entre Lizy et Paris, et nous avions passé les fortifications, lorsque le train s'arrêta brusquement sous le pont de la Chapelle. En me penchant à la portière, je remarquai qu'un talus montait le long de l'arche du pont et contre la maison; il me semblait qu'on pouvait sauter du haut du talus, sur le parapet du pont. Je voulus risquer la chance. Je descendis en vitesse du train, et je me dirigeais vers le talus, en traversant les voies, pendant que le train entrait en gare. Je grimpais en haut du talus, mais je m'aperçus, alors, que le parapet du pont était beaucoup plus haut que je ne croyais. En effet, il y a, au moins, trois mètres de différence, entre le niveau du talus et le sommet du mur. J'essayais de sauter, mais mes doigts avaient beau se crisper sur la pierre, je retombais, n'ayant pas de prise. Trois fois j'essayais sans succès. Il aurait fallu être deux, l'un faisant la courte échelle à l'autre. Je cherchais une autre combinaison : avisant un tuyau de plomb, je le plaçais dans le coin du mur, et réussissant à poser un pied dessus, je pus me mettre à cheval sur le mur et sauter dans la rue. Je n'eus plus ensuite qu'à marcher bon pas, et j'arrivai chez nous à dix heures trente. Ma mère était au cinéma. Mon père, pas encore couché. Je restais à lui tenir compagnie, jusqu'à l'arrivée de ma mère. Exclamations, cris d'épatement. Enfin, tout le monde alla se coucher. Le lendemain, nous partîmes faire un tour, l'après-midi, et le soir, à dix heures, je repartais à la gare de l'Est. Mais le train que j'avais pris n'allait pas plus loin que Meaux et là, je n'avais pas de train avant huit heures du matin. Je me renseignais auprès d'un employé. Il me conseilla d'attendre, jusqu'à une heure du matin, le passage d'un train de marchandises, mais ce n'était pas sûr qu'il s'arrêterait là. Aussi ne voulant pas risquer une chance aussi aléatoire, je pris le parti le plus simple : celui de faire mes 23 kilomètres à pied. J'arrivais à trois heures 45, ayant fait une moyenne de six kilomètres à l'heure. Je me couchais en rentrant, car j'étais bien fatigué. A sept heures, au réveil, j'étais présent, et un copain me rendit compte qu'il ne s'était rien passé... La semaine se passa en stage de mitrailleuse. La samedi soir, je voulus repartir. Dans les jours précédents, j'avais causé avec un copain de Patin, Jennin, qui voulut venir avec moi le samedi suivant. Ma foi, je ne refusais pas, d'abord parce qu'on aurait moins de mal à sauter le pont à nous deux. Ainsi fut fait... Tout se passa comme le dimanche précédent, sauf qu'en arrivant à Meaux, nous attendîmes le train de marchandises, qui, sans s'arrêter, ralentit néanmoins suffisamment pour que nous puissions sauter dans un wagon. Une demi-heure après, nous arrivions à Lizy où le train en s'arrêtant, nous permit de descendre tranquillement. Il est vrai que dans le cas contraire, nous n'aurions pas été plus embarrassés, car nous aurions sauté, purement et simplement. A trois heures trente, nous arrivions à Cocherel, où nous nous couchions, non sans avoir réveillé un copain, afin de s'assurer que tout s'était bien passé. Sur sa réponse affirmative, nous nous endormîmes du sommeil du juste. Dans le courant de la semaine suivante, des bruits de départ vers le régiment, circulèrent de plus en plus fort.  Aussi, le samedi, sans nous troubler, reprîmes-nous en choeur le chemin de Paris. Cela ne me plaisait pas de partir ce jour-là : j'avais de tristes pressentiments. Déjà, en arrivant à Lizy, nous eûmes une première déception : le train de Paris ne passait plus qu'à neuf heures quarante. Il nous fallut donc attendre, non sans impatience, cette heure tant désirée. A onze heures trente, nous étions à Paris. Le lendemain matin, comme le dimanche précédent, je devais trouver Jennin, devant la gare de l'Est pour prendre nos billets de retour de suite, afin de ne pas être embêté le soir, au moment de partir. Deuxième ennui : je ne le trouvais pas. Je pris mon billet et rentrais à la maison. Nous passâmes, ma mère et moi, l'après-midi au cinéma, avec des amis. Le soir, à neuf heures, Jennin venait me chercher chez nous. Il me dit qu'il était pourtant bien venu, le matin à la gare de l'Est, mais qu'il ne m'avait pas vu.  Pour rentrer à Cocherel, tout se passa comme le dimanche précédent. Je poussais un soupir de soulagement en me couchant : je me croyais débarrassé des soucis. Ah bien, oui !! Le lundi matin, à sept heures, le sergent de semaine, en venant pour l'appel, nous réclame tous deux, en demandant si nous étions rentrés. Sur notre réponse affirmative, il nous dit d'aller trouver le capitaine Larrière, à huit heures. Nous comprimes de suite, que nous étions pris. Ma foi, nous en primes notre parti, et décidâmes de dire la vérité au capitaine. A l'heure dite, nous nous présentions à son bureau : "Ah ! Vous voilà, vous ! Où étiez-vous hier ?" Comme il avait l'air de s'adresser à moi plus particulièrement, je pris la parole : "A Paris, mon capitaine ! - Ce n'est pas vrai !!" Ma foi, cette réponse me fit sauter, d'abord parce qu'il mettait ma parole en doute, et ensuite parce que je ne voyais du tout où nous aurions pu aller ailleurs qu'à Paris, dans notre famille : "Je vous demande pardon, mon capitaine, nous sommes allés chez nos parents, à Paris. - Ce n'est pas vrai, ne mentez pas. Où êtes-vous allés ? - Mais à Paris, mon capitaine !" Nous n'avions même pas eu le temps de voir les camarades avant de venir le trouver et nous ne savions absolument rien de ce qui s'était passé la veille. Aussi étions-nous bien étonnés de ses réflexions. Mais une idée me vint : en rentrant, le matin, à la gare de Lizy, comme il n'y avait personne, nous ne rendions pas nos billets, et le samedi soir, puisque nous sautions le pont, nous n'avions pas la peine de les donner non plus. Quand à moi, je ne les avais pas encore jetés, et je les avais dans mon porte-monnaie, que je sortis : "Tenez, mon capitaine, je peux vous prouver que nous sommes bien allés à Paris, c'est que j'ai encore mes billets et je peux vous les montrer : les voici. Comme ils sont datés, vous pouvez voir qu'ils sont bien d'hier !" Je croyais le convaincre du premier coup. Eh bien, je fus trompé, et comment ... ! "Vous me prenez pour une andouille, si vous croyez que je ne connais pas tous vos trucs. Des billets, ça se trouve, vous avez trouvé ceux-ci et vous me les apportez, mais ça ne prend pas !" Je ne savais plus quoi dire, et je me demandais où il voulait en venir. Jennin qui avait aussi ses billets, sortit aussi ses billets, également. Mais, en voulant prendre ceux de la veille, il fit voir les deux billets du dimanche précédent qu'il avait conservé. Cela fortifia le capitaine dans son idée fixe, que nous n'étions pas allés à Paris, et que nous avions trouvé ces billets. Puis la conversation, plutôt, prit une autre tournure. "Lequel de vous deux a été acheter du lard, samedi ?" Nous nous regardons étonnés, Jennin et moi. Nous n'avions pas acheté de lard de la semaine, et nous le lui dîmes : "Je vous demande pardon, répliqua-t-il. Je sais ce que je dis. Vous êtes allés acheter du lard, samedi, je veux savoir pourquoi faire ? - Nous n'avons pas acheté de lard, mon capitaine. - Je vous dis que si !! - Je vous dis que non, mon capitaine !!" Je sentais la colère m'échauffer les oreilles, et j'étais près de devenir insolent. Heureusement, il fit diversion : "Restez-là, je reviens de suite." Nous attendîmes patiemment. Cinq minutes après, il était de retour, rapportant mon calot. Il était donc allé à notre cantonnement. J'avais deux bonnets de police : un que je portais pour tout aller, et l'autre (celui qu'il avait à la main) pour les permissions : "A qui est ce bonnet de police ? - A moi, mon capitaine. - C'est vous qui êtes allé chercher le lard ! - Mais non, mon capitaine. Je vous dis que nous n'avons pas acheté de lard. D'ailleurs, nous n'avons pas acheté d'oeufs depuis dix ou douze jours. Qu'aurions-nous fait du lard ? - Vous savez bien ce que je veux dire ! N'allez pas chercher des détours, et avouez tout, de suite, ça vaudrait beaucoup mieux. D'ailleurs, avec votre tête peu sympathique, vous êtes parfaitement capable d'avoir fait ce dont je vous soupçonne !" Là, je fus d'autant plus assis, que je ne m'y attendais pas ... ! "Mon capitaine, je vous répète que je suis allé à Paris et si, même vous voulez que je vous dise qui j'y ai vu, et l'adresse des personnes que j'ai rencontrées, vous pourrez leur écrire ! - On ne vous en demande pas si long, et, de plus, tâchez d'être poli ... ! - Avec ça, que vous l'êtes ! murmurais-je entre mes dents. - Qu'avez-vous à ronchonner comme ça ? Cela ne vous plait peut-être pas ! - Non, pas plus que ça, lui répondis-je carrément, car il commençait à m'agacer singulièrement. - On ne fait pas de bêtises, quand on ne veut pas les payer !" Là-dessus, il nous fit mettre à la tôle. C'était une misérable cabane, percée de partout. Apercevant un copain, nous l'appelâmes ! "Qu'est-ce qu'il a donc le capitaine, ce matin ? lui demandons-nous. - C'est cette histoire de vol de poules, à la bonne femme à côté, et c'est vous qui êtes accusés. - Hein ? Raconte-nous ça. - Eh bien, voilà, hier, la bonne gemme a porté plainte qu'on lui avait volé cinq ou six poules. Alors la section a été consignée, et on a fait l'appel de suite. Naturellement, vous n'étiez pas là. Il y a eu trois appels dans la journée, et un contre-appel, la nuit. Vous n'étiez pas là. Le capitaine croit donc que c'est vous qui avez pris les poules !" Ainsi donc tout s'expliquait ! Et ses questions baroques, et son air soupçonneux ! Pourtant, en allant chercher mon bonnet de police dans ma musette, il avait dû y trouver du pâté, du boudin, enfin diverses chose que j'avais rapportées de Paris, et les papiers les enveloppant, portaient la marque de Potin. Par la fenêtre, nous vîmes défiler, un par un, tous les poilus de la section. Décidément, c'était bien une enquête, et serrée. Nous sûmes plus tard, qu'il leur avait demandé des renseignements sur notre compte. J'attendais un prochain interrogatoire, afin de lui dire ma façon de penser et sans prendre de gants. Mais ce devait être tout. Il nous annonça que nous avions huit jours de prison pour absence illégale de 24 heures, et ce fut tout. En sortant de la tôle, nous regagnions le même cantonnement que précédemment. Pour aller aux feuillées, il fallait passer devant la porte de l'écurie de la bonne femme. Celle-ci s'y trouvait justement comme je passais. En me voyant, elle sortit précipitamment, et m'apostropha : "Comment, vous êtes déjà sorti de prison ! Espèce de voleur ! On aurait bien du vous y garder ! Je vous ai vu étrangler mes poules !" Du coup, la colère m'empoigna, d'autant plus qu'à côté, il y avait des poilus sur le pas de la porte de leur cantonnement et cette scène les amusait, surtout, dès l'instant que j'étais en cause, moi, un engagé, un vendu ! Je m'approchais de la femme, et lui mettant les mains sur les épaules, je la regardais bien dans le blanc des yeux : "Je vous avertis, Madame, que si vous avez le malheur de répéter, seulement une fois, ce que vous venez de dire, je ne regarderais pas si vous êtes une femme, je commencerais par vous allonger une raclée, et ensuite nous irons voir qui de droit, tous les deux. A bon entendeur, salut, et tenez-vous bien pour prévenue ... !" Sur ce, je la lâchais. Elle rentra dans son écurie, et je paris aux feuillées. Une demi-heure plus tard, je vis l'aspirant, notre chef de section, qui logeait chez elle : "Pardon, mon aspirant, la femme chez qui vous logez vient de m'insulter publiquement et à tort. Je l'ai prévenue charitablement, que si elle recommençait, je lui flanquerais une tripotée. Néanmoins, je vous serais reconnaissant, de bien vouloir lui dire d'avoir à cesser ses tracasseries, sinon je me plaindrais." Il me promit de le faire, et, en effet, il dut tenir parole car la femme ne me dit plus rien quand je passais. Le soir, j'allais avec Jennin, chez des personnes, chez qui nous avions l'habitude d'aller tous les jours avant d'avoir été en tôle. Nous leur racontâmes tout, sans omettre la dernière scène. Nous le pouvions, car c'étaient de braves gens, qui pouvaient nous comprendre : "Comment, nous dirent-ils, votre capitaine a ajouté foi aux racontars de cette vieille folle. Mais on ne lui a, seulement, peut-être rien pris du tout ! C'est une hystérique qui a fait une noce à tout casser, avec les officiers boches, pendant le peu de temps qu'ils sont restés ici. Ah, ben vrai, mes pauvres petits ! Un triste sire, votre capitaine ! s'il ne se renseigne pas mieux que ça !" Ma foi, alors, rien ne nous étonnait plus. Mais c'est égal nous avions passé un fichu quart d'heure. J'avais hâte, à présent de quitter le pays. Heureusement il n'y en eut pas pour longtemps. En effet, nous étions sortis de prison, le 19 mars, et le 22, nous déménagions. Tout le dépôt divisionnaire partait. Chasseurs, infanterie, artillerie, tout le monde fichait le camp. Le premier jour de marche, nous fîmes une étape de trente kilomètres, pour gagner Neuilly-Saint-Front, où nous devions passer la nuit. Le deuxième jour, 23 mars, nous gagnons Chacrise, où nous arrivons vers quatre heures de l'après-midi. Dès l'arrivée, nous avons la surprise d'une forte détonation, à côté de notre cantonnement : bombe ou obus qui a explosé. Nous apprenons que le régiment se trouve devant le fort de Condé, dans l'Aisne, et qu'il y subit des pertes assez sensibles. On nous annonce notamment la mort d'un des chefs de bataillon : le commandant Keiser. Nous sommes toujours sur le qui-vive, attendant un ordre de renfort qui ne vient pas. Mais il faut d'abord que le régiment descende au repos et certainement nous irons le rejoindre. En attendant, pour passer le temps, nous faisons de l'exercice, comme à Cocherel, comme à Beaudricourt, comme à Laval, et comme dans bien d'autres coins. Le 26 mars nouveau déménagement : nous nous rendons à Ambrief, pas bien loin de Chacrise, et il est probable que c'est de là que rejoindrons le régiment, car il est attendu. En effet, le 29 mars, l'ordre arriva. Nous partions le lendemain pour Septmonts, où le régiment venait d'arriver. Ce pays se trouvait à sept kilomètres de Ambrief, et nous ne fûmes pas longtemps à y parvenir. On nous fit arrêter dans une grande prairie, à l'entrée de Septmonts. Nous formons les faisceaux et nous attendons. Un moment après, les fourriers de toutes les compagnies du régiment arrivaient et la répartition du troupeau commençait. Une vingtaine par compagnie, et chaque détachement suivit son gradé. Après quelques tâtonnements, je fus versé à la 21e compagnie, avec laquelle je devais faire mes débuts au feu. J'aurais bien voulu que le capitaine Larrière vint avec nous, et surtout avec moi à la 21e compagnie, afin de pouvoir m'expliquer avec lui, dans un endroit où la discipline aurait été moins forte, et où en un mot, j'aurais pu lui faire comprendre qu'il avait eu tort. Mais sans doute, cette fois, ne voulut-il pas démentir son nom, car il resta à ... Larrière ... ! Le feu. La blessure. Je fus conduit avec mes camarades, par le fourrier de la 21, au-dessus de Septmonts, dans une grande ferme que la compagnie occupait en commun avec la sixième compagnie de mitrailleuses. Je fis alors connaissance avec les Anciens de la quatrième escouade de la première section, dont le chef était le sous-lieutenant Noël. Le commandant de la compagnie était le capitaine Flamand. Le lendemain même de notre arrivée, nous étions poissés pour une fichue corvée : dégradation militaire de trois poilus de la division, qui avaient déserté quelque temps auparavant. Je dois avouer que cela me fit quelque chose. C'était la première fois que je voyais pareille exécution. Nous restons six jours à Septmonts, à faire un petit exercice, ô bien doux, ma foi, par rapport à celui que nous étions accoutumés à faire jusqu'alors. Il est vrai que jusqu'à ce moment on n'avait jamais approché de si près de la ligne de feu. L'après-midi du 6, se passa au montage des sacs, car nous devions déménager le soir même. Une attaque est imminente, parait-il, et nous devons approcher afin d'en prendre notre part. Une petite marche de nuit et nous arrivons à Brenelle, petit pays des environs de Soissons, vers les deux heures du matin. A ce moment, j'ai un bel exemple d'insouciance, ou plus exactement d'imprudence de soldat. Un poilu, en arrivant dans le pays veut fumer sa pipe. Au lieu de se cacher, il allume son briquet, au beau milieu de la route. Cris, hurlements : "T'es fou ! Tu vas nous faire repérer !!" Le type éteint sa lumière. Deux minutes plus tard, je vois tous les poilus se coller contre les murs des maisons, tous comme un seul homme, tandis que moi et quelques bleus dans mon genre, restons au milieu de la chaussée. Deux craquements en l'air, un peu en avant de nous. Ce sont des fusants. Je les vois éclater, en me demandant quelle garantie, les poilus peuvent trouver à se blottir ainsi contre le mur. Enfin, la marche reprend et cinq minutes plus tard, nous sommes dans notre maison. Le pays n'est pas trop bombardé, nous pouvons y loger. Au jour, nous sommes réveillés par un fracas abominable; la maison en a tremblé. Nous descendons au rez-de-chaussée, et de là, dans la rue, afin de nous rendre compte de ce qui se passait. Un poilu m'explique et me montre l'endroit. Le pays est bâti à flanc de coteau. Dans le ravin, se trouve une pièce de 270 de marine. On voit très distinctement les artilleurs aller et venir. Le coup part. "Oh, j'ai vu l'obus !" crie un des jeunes poilus. Tout le monde rigole, car cela parait invraisemblable. Mais en regardant bien et en prenant des points de repère, on s'aperçoit vite qu'il a raison. On peut, en effet, suivre la trajectoire de l'obus, et même, en montant sur la crête, quoique cela soit défendu en plein jour, on peut assister à l'éclatement du morceau, là-bas, bien loin, sur les lignes boches. Le temps passa bien lentement dans ce pays. Le huit avril, en montant sur la crête, j'étais suivi par un poilu de la première escouade de chez nous. Un moment après, il m'interpellait : "Dis donc, Cambounet, tu ne t'appelles pas André ? - Si, pourquoi ? - Ton père n'est pas originaire du Tarn ? - Mais si, de Saint-Avit, pourquoi ? Tu en es, toi ? - Tu ne te rappelles pas de Lamy, d'Antouls ? La ferme qui a brûlé, une fois que vous étiez au pays ?" Ma foi, si, je me souvenais. Ainsi, je retrouvais donc là, un garçon du Tarn qui connaissait très bien mes parents. Nous nous mimes à causer un bon moment du Tarn, de la famille, du métier militaire, enfin d'un tas de choses intéressantes. A bavarder, l'après-midi passa vite. Le soir, sitôt après la soupe, départ pour le travail en lignes. Nous partons avec l'équipement et le fusil ! Nous traversons Pont-Arcy, et c'est la première fois qu'il m'est donné d'admirer les ruines accumulées par la guerre moderne. Des maisons déchiquetées, des entonnoirs énormes au milieu des routes, des poteaux télégraphiques sciés en deux; une église dont il ne reste plus que deux pans de murs, des barricades en travers des rues, voilà ce dont se compose Pont-Arcy.  Nous traversions l'Aisne sur une passerelle interminable et, comme la rivière a débordé, nous devons patauger dans une mare liquide, profonde d'une vingtaine de centimètres. Enfin, nous arrivons aux lignes. Nous nous engageons dans un boyau, après avoir pris des pelles et des pioches à l'entrée. Par endroits, ce boyau est éboulé, il s'agit de le rafistoler. En dix minutes, le travail est fait. Nous n'attendons plus alors que l'ordre de départ. Nous avons hâte d'aller nous coucher. La nuit est silencieuse. De temps en temps, une fusée blanche, monte et redescend lentement, éclairant la plaine immense d'une lueur blafarde. Enfin, l'ordre passe de se préparer au départ, puis en route. Nous rendons nos outils au passage, et nous regagnons Brenelle, bien fatigués, car notre promenade se marque par trente kilomètres en chiffres ronds. J'apprends le lendemain, que je suis affecté à la section comme agent de liaison entre le capitaine Flamand et le sous-lieutenant Noël. Cela ne me plait, ni ne me déplait. Faire ça ou autre chose, du moment que je monte en ligne, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Le 13, j'ai eu une petite distraction. Un avion de bombardement, en détresse est venu atterrir au-dessus de Brenelle. J'ai été le voir de près. Il y a dix casiers, comme un panier à bouteilles, et des agrafes sous le fuselage, pouvant tenir trois autres projectiles, soit au total, treize à envoyer. Mais il m'a fallu bientôt déguerpir, car les boches ayant repéré le truc, envoyaient quelques obus... ...On commence à parler de plus en plus de l'attaque. Ce serait pour après-demain.  En tout cas, il y a une préparation d'artillerie formidable. On nous fait des théories, sur cette attaque. Pour la première fois, on doit essayer un système de tir de barrage roulant, marchant devant les poilus. Cela doit être épatant ! Tant mieux, si les boches sont tués avant qu'on arrive, on aura moins de mal. Nous sommes dont tout feu, tout flamme. Nous ne doutons pas un seul instant du succès de l'attaque projetée. Le 14 avril, se passa en écritures, car nous devons monter en ligne, le soir même. Je dois avouer que je suis un peu nerveux, il y a de quoi, car enfin, ça va être mon baptême, et s'envoyer, comme début, une attaque avec tout le déploiement d'artillerie, de grenades, de lance-flammes et autres enfin plus terribles les uns que les autres, ça fait réfléchir ! Et, en moi-même je me demande comment je vais me comporter : aurais-je peur ? Vais-je me sauver ? Je n'en sais rien, naturellement, et, intimement, je me promets de faire de mon mieux. Dans la soirée, un ordre arrive, relatant que l'attaque est reculée de 24 heures. Quelques-uns d'entre nous ont un jour de plus à vivre. Ainsi donc, notre dimanche se passera encore tranquille. Ce sera pour le lundi 16 Avril. Puis assez tard, nouvel ordre, nous déménageons pour laisser la place dans le pays, à un autre régiment qui sera en réserve pour l'attaque. La pièce de 270 tape toujours, à intervalles réguliers. Dès que la nuit est tombée, nous nous rassemblons. Nous montons sur le plateau, au-dessus de Brenelle, et allons huit cents mètres plus loin, dans des sapes, à flanc de coteau. Me voici dans mon premier logement de poilu. De l'autre côté du ravin, il y a une batterie de petits 95 de montagne, qui tire sans relâche également, et on entend les ordres des officiers et des sous-officiers : "Feu à volonté ! A 3.200 mètres ! Tambour 7 !" Puis les pointeurs qui répondent : "Première pièce, prête ! - Deuxième pièce, prête ! - Troisième pièce, prête ! - Quatrième pièce, prête !" Un dernier ordre : "Commencez le feu !" Une pièce tire, puis une autre, puis deux. Et ensuite, c'est un roulement ininterrompu qui dure dix ou quinze minutes. Un nouvel ordre : "Cessez le feu !" Un silence complet. De nouveaux ordres : "Feu de dix obus par pièce. A 3.500 mètres. Tambour 7 !" Mêmes réponses des pointeurs, et le sacramentel : "Commencez le feu !" A ce moment, on dirait que les quatre pièces deviennent enragées, c'est à celle qui ira le plus vite. Et en un rien de temps tout s'arrête... J'en ai entendu assez; je rentre dans la sape et me couche. C'est une cagna toute en longueur, et à peine plus large que la hauteur d'un homme. Nous couchons tête-bêche, car il a fallu que toute la compagnie tienne dans cette cagna. Nous sommes bien serrés, mais cela vaut mieux, car il fait un temps abominable et froid, et brumeux. Nous nous réveillons le lendemain, transis. Nous courons chercher le jus et nous nous installons aussitôt à faire une manille à quatre : Lamy, le pays de mon père, un grand diable de méridional, brancardier de la compagnie, un autre copain et moi. Vers onze heures, comme j'avais quelques sous, l'idée me vint d'aller à Braine, un patelin assez important, à deux kilomètres de là, chercher quelque chose à manger, afin de faire un bon repas avant de monter en ligne. Je descendis du pays et en arrivant sur la route de Soissons à Braine, qui passe en bas de Brenelle, je sautais derrière un camion faisant partie d'un convoi qui se dirigeait dans le même sens que moi. Cinq minutes après, j'étais arrivé. Le pays était quelque peu bombardé, par obus explosifs et incendiaires. Mais il y avait encore des civils et naturellement des boutiquiers pour les ravitailler. Je me dirigeais vers une charcuterie, où je me fis servir un bon morceau de saucisse et du pâté. De là, chez le boulanger, afin d'avoir du pain frais, puis je remontais. Je passais à la roulante, demander un petit morceau de lard et je retournais vers la sape. De ce côté du plateau nous ne pouvions pas être vus par les boches. Je cherchais un peu de bois sec et je me mis en devoir d'allumer du feu. Je fis ma cuisine dans mon assiette en fer et je déjeunais, ma foi, d'un fort bon appétit. La vision de mes futurs émotions, n'avait pas encore réussi à me resserrer l'estomac. L'après-midi se passa en jeux de cartes. A cinq heures, la soupe. Puis le montage des sacs. Avant de partir, nous touchons tout l'attirail complet. J'hérite, pour ma part, de deux grenades incendiaires, de trois grenades offensives ainsi que d'un pistolet lance-fusées. La veille, avaient été distribués aux grenadiers, les pistolets automatiques, accompagnés d'une boite de cartouches, et un couteau de tranchée, à la lame solidement emmanchée. Nous étions prêts, il ne nous restait plus qu'une nuit à passer... Nous partons vers dix heures du soir, en colonne par un, le long d'une piste qui se dirige vers l'Aisne. Il fait une nuit très obscure. En approchant, nous voyons de plus en plus distinctement, les fusées boches. Même à un moment, la colonne ne s'étant pas couchée assez vite à l'annonce d'une fusée, quelques obus arrivent et viennent éclater en arrière de la compagnie, à droite et à gauche de la piste. Mon baptême ! Nous continuons à avancer tranquillement, méthodiquement, lorsque nous sommes coupés par un ravitaillement d'artillerie. Il fait tellement noir, que personne ne s'en est aperçu. Nous n'entendons même pas les chuchotements : "Faites passer que ça ne suit pas !" Nous franchissons sur des passerelles, des boyaux, des tranchées. Les passerelles ne sont pas larges. Un cri, ce n'est rien, un poilu qui vient de tomber dans le fond. Il geint. Il s'est cassé une jambe. Oh, le veinard ! Au moment d'une attaque ! On commente l'évènement en enviant ce poilu... et on marche toujours. Enfin on arrive. Nous occupons la tranchée de Chavonne. Je vais poser mon sac dans la cagna du capitaine, simple encoche faite dans la paroi de la tranchée et recouverte d'une épaisseur de rondins de sapin.  Il faut que je donne un plan du terrain pour la clarté des détails. L'Aisne, la tranchée de Chavonne qui lui est perpendiculaire. En face de nous, à 900 mètres, se dresse une crête : le Mont Sapin. Nous l'appelons ainsi, parce qu'elle est couronnée par un bois. Entre la tranchée et la crête, un ravin qui remonte vers la droite. Dans ce ravin et au bord de l'Aisne : Chavonne. La tranchée suit vers la droite, le même tracé que la crête, et est à sa hauteur, à 11 ou 1200 mètres de l'endroit où nous sommes. Nous arrivons vers trois heures et demie. On signale au capitaine, que les brèches dans nos réseaux ne sont pas bien faites. Deux hommes vont les agrandir. Moi, je commence mon service, la gorge serrée (dois-je le dire ?) non pas, absolument de peur, mais plutôt d'émotion, en face de cet inconnu ! Je vais deux fois au P.C. du bataillon, porter des comptes-rendus. Je fais des tours et des détours dans les boyaux, ne m'y reconnaissant plus. Je reviens deux fois aux même endroits. Je patauge dans une boue épaisse. Enfin, je réussis quand même ! Vers cinq heures trente, le capitaine sort pour aller voir la compagnie de gauche, qui est adossée à l'Aisne. Le lieutenant prend le commandement de la compagnie. L'attaque est fixée pour six heures. "Encore deux minutes, les enfants !" Nous sommes massés sur la banquette de tir. Un camarade est à ma droite, tenant son fusil de la main gauche. La paroi de la tranchée est maintenue par un clayonnage. Nous allions nous avancer vers l'escalier pratiqué dans la paroi, lorsqu'une détonation claque à mon oreille, et je sens celle-ci comme brûlée. Je regarde : c'est ce camarade qui ne s'était pas aperçu qu'une branche du clayonnage était passée dans le pontet de son arme. En voulant se déplacer, le coup était parti. Cela m'a donné froid.  Enfin, le signal arrive, nous franchissons le parapet. Mon coeur, au moment de monter, bat plus vite, mais voyant alors la tranquillité du lieu, je me rassure vite. En effet, pas un coup de canon, pas un coup de mitrailleuse. Nous nous engageons dans le réseau au pas gymnastique, afin d'y rester le moins possible. Au moment d'en sortir, je me sens agrippé par le pied, et, la tête en avant, je plonge dans un grand entonnoir de 380. Mon pied s'était pris dans un fil de fer non coupé, et j'étais descendu jusqu'au fond de l'entonnoir. Je me préparais à regrimper afin de rejoindre la compagnie, lorsqu'au dessus de ma tête, j'entendis comme un bruissement d'abeilles, pendant qu'en avant à 3 ou 400 mètres de là, se faisait entendre un tacata tacata, que je reconnus pour être le bruit de la mitrailleuse. L'attaque était éventée : les boches tiraient. Cela venait, je le sus ensuite, d'un fusilier-mitrailleur, qui, ayant vu des ombres, le long des tranchées boches, s'était mis à tirer avant même d'être sorti des fils de fer. Le malheureux fut tué trois mètres plus loin : il fut une des premières victimes de sa faute. Ignorant du danger, comme je l'étais, je n'avais qu'une idée en tête : rejoindre ma compagnie. Mais des anciens se trouvaient dans le trou, avec moi. Ils me firent les imiter, enlever mon sac, grimper doucement au bord du trou, mettre le fusil en position, et examiner la plaine. Je ne vis tout d'abord rien. Puis je distinguai des hommes courant affolés, d'autres allongés dans la plaine. A gauche devant Chavonne, des boches qui se démenaient. Je ne pus résister à la tentation. J'en épaulais du coup mon fusil, visais soigneusement, et vlan ! Le type disparut. L'avais-je touché, ou était-il descendu dans un boyau ? Je ne sais. Le sifflement des balles allemandes continuait, mêlé maintenant à celui des balles françaises. Nos mitrailleuses tiraient par-dessus nos têtes. Je compris alors, quoique nouveau au front, que c'était à recommencer. Des blessés passaient. L'artillerie allemande tiraillait quelque peu dans la plaine. Nous vîmes soudain arriver dans notre trou un bolide, sous la forme d'un homme qui nous fit le récit suivant. Ils étaient quatre, couchés dans la plaine, côte à côte, serrés l'un contre l'autre. Un obus était arrivé, éclatant sous le premier et le réduisant en miettes. Le second, un miracle, n'avait rien, et lui, numéro trois avait reçu un éclat dans l'oeil. Quand au numéro quatre, il ne savait ce qu'il était devenu. Quand à l'attaque, ç'avait été rapide. Pendant que je dégringolais, les premières vagues arrivaient et dépassaient la première ligne boche, mais là se heurtaient à une résistance à laquelle personne ne s'attendait. Une contre-attaque se déclenchait immédiate, terrible, et les nôtres étaient obligés de se replier, non sans laisser des plumes. Le tout n'avait pas demandé plus de cinq minutes. Un moment, je fus attiré par une lueur sur la gauche. C'était un poilu du génie, portant un appareil lance-flammes, qui brûlait vif. C'était terrible : une torche vivante. Enfin l'après-midi passa doucement. Vers le soir, comme il faisait un peu sombre, on sortit un par un de notre trou et nous regagnâmes notre tranchée de départ. Je me dirigeais vers la cagna du capitaine, me demandant ce qui m'attendait. Ma foi, il n'y eut rien, puisque tout le monde avait fait comme moi. Toute la nuit, les boches, connaissant nos positions, ne cessèrent de bombarder les environs de la tranchée. La cagna, construite avec des troncs d'arbre, tremblait. Ah ! Il était joli, mon baptême, mitraillé le jour, canonné la nuit, mais ça allait déjà mieux. Jusqu'à présent, je n'avais pas fait grand chose comme agent de liaison, mais ça allait venir. A l'appel, nous vîmes ce qu'il restait. Nous étions montés cent quarante. Nous restions soixante-cinq. Il en manquait donc soixante-cinq : tués, blessés ou disparus. Je restais seul comme agent de liaison. Le lendemain, je devais m'apercevoir que ce n'était pas toujours drôle. J'avais passé la nuit à bavarder avec un sergent : ex-maréchal-des-logis de spahis, passé au 355 sur sa demande, et neveu du chef de bataillon. Il s'appelait Moussard. Le lendemain matin, à cinq heures, on repartait. Mais cette fois c'était plus calme. Les boches avaient du évacuer leur première ligne dans la nuit. Nous l'occupâmes. Dans cette tranchée, étaient couchés de nombreux cadavres français et boches qui attestaient de la violence de la lutte, si courte, pourtant. Il fallait trouver un P.C. pour le capitaine. Avisant une sape, j'y descendis avec des copains. Le fond était plein d'eau, mais ayant trouvé deux seaux, un grand et un petit, nous entreprîmes de l'assécher. Un camarade était dans le fond et remplissait les seaux. Moi, je faisais l'aller et le retour, pour vider l'eau par-dessus le parapet.  Comme j'allais redescendre, je l'entendis qui me criait : "Tu peux jeter le seau !" Aussitôt, je jetais les deux seaux par-dessus le parapet, puis je descendis dans la sape. Mais là, explications. Il m'avait dit de jeter le petit seau, et moi, j'avais compris les deux. Il me dit d'aller rechercher le grand seau... et il était sur le parapet. Enfin, après une petite lutte intérieure d'un instant, je me décidais, et je sautais sur le parapet à l'endroit où je savais avoir jeté les seaux. En effet, je les vis, mais ô putréfaction, ils étaient tombés sur un groupe de trois boches, qui étaient étendus là. Je n'étais pas encore aguerri, je fus horrifié. Je sautais sur mon seau, et je fis un bond pour revenir à ma sape. Il me fallut bien deux ou trois minutes pour me remettre. Enfin, nous finîmes notre travail. Nous devions repartir de l'avant, à seize heures, mais voilà que vers quatorze heures, le sergent Moussard arrive tout essoufflé : "Mon capitaine, il y a des français sur la crête ! Ils nous font signe d'avancer !" Le capitaine ne fait qu'un bond du fond de sa sape. Il lorgne les silhouettes à la jumelle et reconnaît que ce sont bien des français. L'ordre est donné de partir en avant. Je vais communiquer l'ordre aux sections et nous démarrons. En arrière de la première ligne, nous trouvons encore des cadavres de chez nous. Nous arrivons sur la crête et nous commençons à redescendre de l'autre côté, en suivant des chemins de caille-bottis. En bas, se trouvent des cagnas boches : villa Héléna, villa Margarita, etc... et, en effet, ce sont plutôt des villas que des abris de soldats. Je glane des cartes, une lampe électrique, cigares, jeux de cartes, etc... Je deviens peu à peu un musée. Un peu plus loin, il y a encore du feu. Les boches sont partis d'ici brusquement. Nous devons notre avance à la manoeuvre de la compagnie de droite, qui, mieux placée que nous, a réussi à avancer, obligeant les allemands qui se trouvaient en face de nous, à la retraite. Enfin, nous arrivons dans la plaine, déployés en lignes de sections. Comme manoeuvre, c'est joli. Nous avons fait environ 1500 mètres comme cela, lorsque le capitaine m'appelle : "Tu vas retourner à Chavonne, chercher mon cuistot et mon ordonnance qui sont restés là-bas. Tu nous retrouveras à Rouges-Maisons, et fais vite !" Je reprends donc la direction de l'arrière, bien fatigué, car pendant la progression, je n'avais pas cessé, depuis le départ de courir d'une section à l'autre. En arrivant au pied de la crête, je croise le médecin-chef du 355. Il m'interpelle : "Qui es-tu, petit ? Et où vas-tu? - Agent de liaison, 21e compagnie, je vais à Chavonne ! - Ah bien, voudrais-tu aller jusqu'au pont sur l'Aisne ? Dans la cave d'une maison se trouvent l'aide-major X.., et son infirmerie. Tu le ramèneras avec toi. J'aurai, peut-être, besoin de lui, bientôt. La maison est à droite du pont. Tu la trouveras facilement, car elle est marquée par de vieux tonneaux !" Je pars et file en vitesse, mais au lieu de prendre le chemin par lequel nous descendus tout à l'heure, l'idée me vient de contourner la crête et de suivre l'Aisne. Aussitôt pensée que fait. Je vais rejoindre l'Aisne et me mets en devoir de la suivre. Mais, en approchant de Chavonne, je tombe en plein dans les défenses boches. J'y laisse à moitié ma capote, mais je passe. Arrivé près du pont, je m'oriente. Enfin, voilà les tonneaux. Je fais le tour de la maison, et je vois des brancardiers, causant avec un major. Je salue, et : "Aide-major X.. ? lui demandai-je immédiatement. - Oui. - Bien, vous devez venir avec moi, ordre du médecin-chef. - Entendu." Et voilà. Ils se mirent tous à leur besogne; cinq minutes après, nous partions. Point de direction : l'ancienne sape du capitaine, où je comptais retrouver mes deux poilus, mais personne. Nous gravissons la côte, doucement, très doucement, car moi je suis fatigué, et eux sont chargés... Je les vois soudain s'aplatir tous par terre. Je me demandais interloqué, ce qu'ils faisaient, lorsque j'entends un sifflement auquel je n'avais pas prêté attention, puis un second, puis un troisième, et coup sur coup, trois détonations. Puis plus rien. C'était une salve de messieurs les boches. Nous repartons un peu plus vite et nous reprenons le chemin que nous avions déjà parcouru, la compagnie et moi. J'étais épuisé. Je n'avais pas mangé depuis le 15, à dix-sept heures, heure à laquelle la soupe avait été distribuée. Jusque là, les nerfs m'avaient soutenu, mais je commençais à sentir la fatigue, et, sans les gouttes de gniole que le major me donnait de temps en temps, je serais tombé. L'alcool me fouettait le sang, et me rendait les jambes plus lestes... Enfin, nous approchions de Rouges-Maisons, ou plutôt de ce qu'il en restait. Chemin faisant, nous avions rencontré le cuistot et l'ordonnance du capitaine, qui s'étaient joints à nous. Nous arrivâmes enfin à l'endroit où le médecin-chef avait établi son poste de secours. Il me donna les renseignements nécessaires pour trouver la 21, et je le quittai, après avoir bu un demi-quart de gniole, qui me redonna toutes mes forces. Une heure après, je trouvai la compagnie dans une carrière transformée par les boches en abri, au milieu d'un petit bois. Le ravitaillement était arrivé, et de plus cette carrière constituait un dépôt d'approvisionnements boches. Il y avait là au bas mot, cinquante kilos de viande, vingt kilos de boudin, du pain noir, des biscuits de réserve, un grand sac de sucre, un sac de café, un sac de sel, des pruneaux, du thé, et enfin, le couronnement : deux bonbonnes de vingt-cinq litres environ, pleines l'une de whisky, l'autre de rhum ordinaire. Tout fut liquidé !! Au milieu du bois était un croisement de chemins. Les boches avaient fait sauter ce carrefour, au moyen d'une mine. L'entonnoir avait une profondeur de cinq ou six mètres. Dans la nuit un caporal et un homme, allant en corvée, tombèrent dans le trou. Le caporal se fit une entorse, et le poilu s'en tira sain et sauf. Ils avaient eu de la chance. Ils pouvaient se tuer. Lorsque j'eus mangé, je me jetais sur un des lits qui garnissaient la carrière et je m'endormis d'un sommeil de plomb. Combien de temps ai-je dormi ? Je n'en sais rien. Je fus réveillé lorsqu'il faisait petit jour. Nous devions repartir de l'avant, reprendre contact avec les boches. Le colonel venait occuper la carrière. Nous le vîmes au moment de partir. Il demanda le sergent Moussard, afin de lui faire connaître sa nomination de sous-lieutenant. Enfin, tout le monde se mit en route. Nous marchions, le capitaine et moi, à 200 mètres environ, en avant de la compagnie qui marchait en lignes de demi-sections par un. Devant nous, s'étendait une plaine, qui montait en pente douce. Nous arrivions à trois ou quatre mètres d'une tranchée, quand, brusquement, les balles se mirent à siffler. D'où venaient-elles ? On n'en savait rien, on ne voyait rien, on n'entendait rien. Je puis assurer que nous ne fûmes pas long, le capitaine et moi, à nous coucher. Les sections derrière nous firent de même. "Nous allons faire un bond, et sauter dans la tranchée, me dit alors le capitaine. - Oui. - Tu y es ? Eh bien, allons-y." Un saut et nous retombions sur nos pieds, dans le fond sablonneux d'un boyau. Le capitaine fit alors signe à la compagnie de ne pas bouger, pendant que nous explorions la tranchée. En faisant notre visite nous trouvâmes un bout de boyau, qui partait vers les autres poilus. C'est par là que nous fûmes rejoint par la compagnie. Nous primes position dans la tranchée. J'avais trouvé un petit abri de quatre places, renfermant un poêle, pour le capitaine. Ce fut son P.C. Nous étions au milieu de l'organisation d'une batterie ennemie. 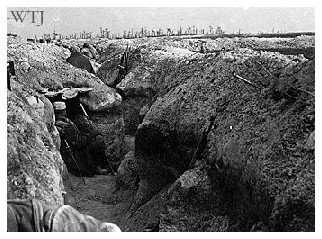 Vers la fin de l'après-midi, le brouillard était tombé. Il y en avait une telle épaisseur, que tout le monde pouvait se promener sur la plaine impunément. J'en profitais pour visiter le secteur. Quelques courses aux sections, ce fut tout. Dans la nuit, nous fûmes ravitaillés. Le lendemain, 19 avril, nous ne fîmes pas beaucoup de chemin. On s'avança vers l'extrémité de la tranchée, du côté de l'ennemi, ce fut tout. Je n'eus que quelques ordres à porter aux sections. Mais, l'avance reprit le 20. Nous étions arrivés au bord d'un bois qui s'étageait sur la pente d'un ravin et remontait de l'autre côté. J'étais toujours avec le capitaine. Pendant que les sections descendaient dans le bois, luit était resté sur la hauteur afin de voir ce qui se passait sur la crête de l'autre côté du ravin. Là, en effet, était une mitrailleuse. Celle-là, sans doute, qui nous avait tiré dessus, la veille. Le capitaine fit demander le canon de 37. Sitôt arrivé, lui montrant l'emplacement que l'on distinguait très bien, il fit ouvrir le feu. Le premier obus un peu à gauche; le deuxième, bonne direction, un peu long; mais le troisième était en plein dans le but. La mitrailleuse ne nous gênerait toujours plus. A ce moment le capitaine m'appelait et me tendant un papier : "première section !" Je partis, mais voulant couper au court je traversais un endroit découvert, au pas comme d'habitude, lorsque j'entendis la voix du lieutenant qui m'interpellait : "Tu vas te faire tuer ! Arrive ici, sous bois et en vitesse !" Ma foi, je n'avais pas réfléchi à ça. Je n'avais vu que le moyen de gagner quelques pas, c'est tout. Lorsque j'eus transmis l'ordre au lieutenant, il s'agissait de retrouver le capitaine. Je pris alors un chemin sous bois et je m'occupais à monter directement, quitte à appuyer, en haut à droite ou à gauche, suivant le cas, lorsqu'au dessus de ma tête une mitrailleuse se mit à crépiter. La compagnie de mitrailleurs avait en effet pris position, de suite à l'entrée du bois, mais moi je n'en savais rien; toujours est-il qu'il était temps qu'elle tire, car deux ou trois minutes plus tard, j'arrivais en plein dedans. Je fis un crochet et j'eus bientôt rejoint le capitaine. Nous partîmes enfin en avant. Descente dans le ravin, ascension de l'autre côté. Les poilus s'étaient installés, en avant du bois, le long d'un fossé. Devant il y avait une espèce de plateau. Nous faisons la pause un moment. Tout à coup un bruit de moteurs se fait entendre. Puis un, puis un deuxième, puis un troisième, enfin un quatrième avion arrivent. Ce sont des boches. Ils sont à trente ou quarante mètres de haut, pas plus. Mais avant qu'ils ne soient là, tout le monde s'était déjà blotti sous des buissons et des arbustes poussés là. Ils tournoyèrent un moment, puis repartirent. A ce moment, je vis arriver le capitaine, parti une minute auparavant, voir un officier voisin : "Es-tu fatigué ? me demanda-t-il. - Pourquoi ? - Veux-tu venir avec moi, faire un tour ? - Avec plaisir !" Ce qu'il appelait faire un tour, c'était aller reconnaître la ferme Hamlet, qui se trouvait à 8 ou 900 mètres de là, dans un espèce de trou. Il y avait le plateau à traverser et on descendait dans un ravin où se trouvait la ferme. Il s'agissait de savoir si elle était occupée ou non. Cela l'embêtait d'y envoyer une patrouille, alors on allait y aller tous les deux en se promenant. Cette promenade n'avait rien d'amusant, car les avions avaient dû repérer quelque chose et les boches des obus par rafale sur le plateau. Tout en marchant, on causait de Paris, de sa vie, de la mienne. Il se croyait certainement sur les boulevards plutôt qu'au milieu des obus. Enfin, nous arrivons à la ferme. Elle a l'air inoccupée. Nous descendons dans le fond, juste au moment où un boche essayait de se sauver. Le malheureux, deux minutes plus tard était entre nos mains. Le capitaine me donna alors l'ordre d'aller chercher la compagnie. Je lui objectais qu'il était imprudent de rester seul : "Je ne suis pas seul !" me répondit-il en me montrant le prisonnier. Je partis en courant, et je ne fut pas long à aller et à revenir. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour et la compagnie faisait sa progression. Elle prit position en avant de la ferme. Là, nous apprîmes que nous étions relevés le soir même. Nous en fûmes très heureux car nous étions épuisés. Un exemple. Nous avions avec nous, un vieux de la classe 1989. On se demandait comment il avait pu venir jusque là. Mais il était à la limite de ses forces. A peine arrivé, sans même avoir posé son sac, il s'abattit d'une masse. Nous le crûmes tué. Il n'en était rien. Il n'était qu'endormi : la fatigue l'avait terrassé. A minuit la relève était faite, et nous nous dirigions à vive allure vers l'arrière. La cuisine roulante devait nous donner la soupe à Vailly. Voulant voir clair pour manger, je descendis avec quelques poilus dans une cave. Il y avait un bon moment de pause, la fatigue l'emportant, nous fûmes bientôt endormis. Quand nous nous réveillâmes, la compagnie était partie. Croyant qu'il n'y avait pas de pont établi sur l'Aisne, à Vailly, nous décidâmes de longer la rivière jusqu'à Chavonne, où nous savions trouver une passerelle. En passant à Chavonne, j'allais jeter un regard ému sur le cimetière que l'on était en train de créer. Puis nous reprîmes notre route. Dans l'après-midi seulement, nous rejoignions la compagnie à Vasseny, le 21 avril. Nous étions au repos. Ce jour-là, nous ne fîmes absolument rien. Le caporal-fourrier ayant été fait prisonnier, le capitaine me fit appeler le lendemain, et me montrant un papier : "Tiens, voudrais-tu reproduire cela au net ?" J'acceptais et me mis au travail. Tout en écrivant, le capitaine me causait : "Je voudrais te récompenser. Je sais que les galons de caporal te feraient plaisir, mais j'ai encore des vieux qui ont été proposés plusieurs fois, à faire nommer ce coup-ci; mais à la prochaine affaire, conduis-toi comme tu l'as fait ces jours-ci, et en descendant tu seras caporal. Pour cette fois je vais te proposer pour une citation." Je le remerciais, et en effet quatre jours après, ma première citation au régiment, revenait avec le texte suivant : "Jeune soldat, engagé volontaire, voyant le feu pour la première fois. Comme agent de liaison a été remarquable de bravoure et d'entrain, pendant les combats du 16 au 21 avril 1917." Comme texte, c'était un peu exagéré, car après tout je n'avais fait que mon service, mais il flattait ma vanité et j'en fus tout heureux. J'avais donc une décoration et, peut-être, bientôt, j'aurais aussi des galons. Hélas ! ... Enfin, n'anticipons pas. Le premier mai, bruits divers. Un renfort arriver, nous devons bientôt remettre ça. C'est tout d'abord pour le 4 mai. Le 3, au soir, je monte vers quatre heures, avec le capitaine pour reconnaître les lignes. Nous passons au pas gymnastique sur une route qui est bombardée et nous tournons à droite dans un ravin, où se trouve un poste de secours. Le capitaine me lâche là et s'en va en avant. Il revient au bout d'une heure environ pour m'annoncer que c'est retardé de vingt-quatre heures et que nous allons rejoindre la compagnie, à la champignonnière de Chassemy, car le premier mai nous avions déménagé, pour occuper une position de réserve d'armée. Nous redescendons donc et passons encore une nuit tranquille. Le lendemain, on monte les sacs et le soir, on remonte dans la direction de Vailly que nous traversons, puis nous passons successivement à Jouy et à Aizy, suivons une route dans le fond d'un ravin, et montant à droite vers la crête, nous entrons dans une caverne qui sert de poste de secours à notre bataillon, P.C. du colonel, et dans laquelle nous passons le restant de la nuit. Il est environ trois heures moins dix, nous sortons de la caverne à toute vitesse, nous passons devant des prisonniers boches qui arrivent. Il y a un vacarme d'artillerie épouvantable. Les obus soufflent drus. Les boches font un barrage pour empêcher les réserves d'arriver. Nous sommes réserve du 294e. Nous arrivons à l'ancien emplacement de ce régiment, au défilé d'une crête, c'est-à-dire un peu avant le haut de la crête. La compagnie s'installe le long d'un boyau, avec ordre de l'approfondir, dans la mesure du possible. Le capitaine et la liaison, nous restons à 200 mètres environ, en arrière du centre de la compagnie. Le terrain se présente de la manière suivante : le Chemin des Dames, devant et parallèlement à nous; un chemin, allant de Jouy-Aizy vers le Chemin des Dames, et à côté de nous un carrefour de différents chemins. Le chemin qui descendait du Chemin des Dames était, par rapport au champ dans lequel était notre bout de boyau, en contre-bas de un mètre cinquante à deux mètres. A peine étions-nous arrivés que l'on entend des explosions de grenades : "Vas voir, me dit le capitaine." Pour aller à la compagnie, je descendais sur le chemin, et tournant à gauche, je le remontais jusqu'à la tranchée. Il y avait une sacrée mitrailleuse qui tirait continuellement arrosant la plaine. Je fus plusieurs obligé de me coucher. Aussi, quand j'arrivais, il n'y avait plus rien. Mais je vis et j'appris quelque chose. Les boches avaient contre-attaqué. Le 294e avait fléchi et s'était écarté. Nous étions de ce fait en première ligne. Les boches s'étaient amenés et avaient envoyé des grenades, mais nos feux de mitrailleuses et de fusils les avaient repoussés. Seulement j'appris qu'un de mes camarades du 164 venu avec moi au 355 était tué par une grenade, et que le sous-lieutenant Moussard, qui était monté sur le parapet pour voir ce qui se passait, avait reçu une balle en pleine tête. Enfin, un autre poilu avait été tué, atteint en plein par un 88. Je retournais aussitôt pour porter ces nouvelles au capitaine. J'étais énervé par ce que je venais d'apprendre et par cette satanée mitrailleuse qui me crachait au c.. derrière, je pris franchement le pas gymnastique, ayant hâte d'annoncer cela au capitaine. A peine arrivé et le capitaine mis au courant, je fis demi-tour, porter l'ordre de rester sur place, coûte que coûte, et dire à un sergent de remplacer le sous-lieutenant Moussard. Maintenant je ne prenais plus de précautions, ça ne servait à rien. Aussi je ne fus pas long à accomplir ma mission. Un peu de repos, puis ayant trouvé une pelle boche, je me mis en devoir d'approfondir l'endroit du boyau où je me trouvai. Il avait à peine quatre-vingt centimètres, moitié de ma hauteur. Au moment où je me relevais pour jeter une pelletée de terre, je fus jeté à terre avec violence. Je me relevais, prêt à enguirlander celui qui m'avait joué ce tour-là : "Qu'est-ce qui m'a fait tomber ? demandai-je à mon voisin, un autre agent de liaison. - Ce n'est rien, me répond-il, un 88 qui vient de passer." Ce n'est rien, peut-être, mais il s'en était fallu de peu, pour que j'en perde la tête. La journée se passa à travailler et à aller à la compagnie. Vers cinq heures les boches déclenchent un violent tir de barrage. Les nôtres y répondent, et c'est dans l'air, une nuée de sifflements. 75, 90, 105, 155, 120, 220 se croisent avec les 88, 105, 150 et 210. Un vacarme abominable. Nous baissons la tête dans le fond du boyau, surtout que les boches ont pris à partie avec leurs 88 et leurs 150 le carrefour qui se trouve à côté de nous. Le même incident que le matin m'arrive encore, mais cette fois je sais que "ce n'est qu'un 88". A entendre le tapage, je pense en moi-même : "Cela fait deux fois, la troisième sera la bonne !" 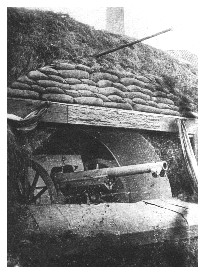 Vers huit heures, je vais faire un tour en vitesse à la compagnie, afin d'aller chercher le compte-rendu. Les éclats sifflent à droite et à gauche. Je me rassure en pensant que j'en verrai bien d'autres d'ici la fin de la guerre et je file avec le sourire que m'a arraché cette idée. La nuit passe lente et morne. Vers une heure du matin, le 6, le fourrier m'appelle : "Tu vas descendre sur le chemin, tu y trouveras cinq ou six poilus avec des caisses de grenades. Tu les conduiras à la quatrième section." J'allais répliquer que je n'étais pas agent de liaison pour la quatrième, mais bien pour la première section, lorsque je réfléchis que ce serait une occasion pour aller faire un tour. Je dis : "Bien. J'y vais." Je prends mon fusil, je saute sur le parapet, et je descends sur le chemin. Il fait une nuit très obscure. On ne voit pas à trois mètres devant soi. Je me tourne à droite pour voir si quelqu'un est là. Personne. Je me tourne à gauche... mais j'ai à peine esquissé ce mouvement que je me sens aplati à terre par une force mystérieuse, en même temps qu'une lueur fulgurante apparaît devant mes yeux, que je fermais instinctivement... Suis-je resté longtemps couché, ou au contraire me suis-je relever de suite ? Je ne saurais le dire... Tout en me mettant à genoux pour me lever, je redresse la tête, et je sens une douleur du côté droit du cou. Je me lève. Je retourne au boyau et j'appelle le capitaine Flamand : "Mon capitaine, je dois être blessé, je viens d'être couché par un obus, et en me relevant, j'ai senti une piqûre du côté droit du cou." Il regarde à la lueur d'une fusée, mais il ne s'aperçoit pas que le col de la capote est troué. Il ne regarde que la peau au-dessus du col. Ne voyant rien : "Tu as du être frappé par une pierre. Il n'y a rien !" Je le remercie et de suite rassuré, je redescends sur le chemin. J'y aperçois une demi-douzaine de poilus, qui avaient posé leurs caisses en m'attendant : "Vous avez les grenades ? - Oui. - Eh bien, grouillez-vous, et amenez vous en vitesse, car il ne faut pas s'attarder. Il ne fait pas bon, ici !" Les deux premiers saisissent leurs caisses et tout en les plaçant sur l'épaule commencent à marcher. Nous n'avons pas fait quatre pas qu'un sifflement se fait entendre. J'ai la sensation qu'il est seul, qu'on n'entend que lui, mais qu'il est pour nous. Nous nous couchons contre le revers du fossé... Une explosion... des cris... L'obus est tombé à l'endroit précis où nous étions une minute avant. Faute de s'être dépêchés, les autres payeront peut-être de leur vie, leur imprudence, car, un retard d'une seconde, dans ce cas, peut entraîner la mort. Ceux-ci ne sont pas encore morts, mais ils n'en valent guère mieux, car ils crient comme des putois : "Oh ! Oh ! Aie... Aie... Je souffre ! ..." Enfin, les deux poilus avec leurs caisses, et moi, nous ne voulons pas rester là plus longtemps. Nous filons. Nous appuyons à droite, dans la direction que je sais être celle de la quatrième section. Nous passons dans des entonnoirs. Nous croisons des hommes : cadavres moraux et cadavres physiques, les vivants et les morts. Il me semble bientôt que nous devrions avoir atteint l'endroit, où se tenait la quatrième section, dans des trous d'obus. Ah ! Enfin, des ombres, des poilus veillant au fond d'un entonnoir : "La 21e compagnie ? - Non, répondent-ils, 22 du 355. - Il n'y en avait pas là de la 21 ? - Si, mais un capitaine du 294, les a emmenés pour aider ses poilus à faire une tranchée." Je rester abasourdi. Il y a une demi-heure que nous marchons et je suis de plus en plus convaincu que je suis blessé. Je sens la fièvre qui est montée et qui me fait trembler et sa tête tourne... Mais il faut prendre un parti... J'allais repartir de l'avant lorsque les deux poilus grognent : "Eh, dis donc vieux, prends tes caisses, si tu veux, et porte-les à domicile. Mais on ne marche plus ... !" Je tâche de les décider. Je voudrais bien pouvoir remplir ma mission avant de ne plus pouvoir marcher, mais les poilus dans l'entonnoir lèvent mes hésitations : "C'est des grenades ? Laisse-les là, j'en avons justement besoin... !"  Ma foi, ça me décide : "Eh bien, prenez-les, je ne peux pas aller plus loin." et j'explique à mes deux poilus que je suis blessé. Alors je les emmène, mais en suivant le Chemin des Dames, au lieu de retourner directement vers le P.C. du capitaine. C'est que je veux passer par ma section afin d'avertir le lieutenant. Je le vais vite, dans le trou qu'il s'est creusé lui-même : "Mon lieutenant, c'est moi, l'agent de liaison. Vous voudrez bien désigner un remplaçant, je suis blessé, je m'en vais." Il me dit au revoir, et je repars vers le P.C. où je ne tarde pas à arriver. Le capitaine est parti. Je voulais l'avertir, je ne peux pas. Je me dirige vers l'endroit où j'ai laissé mon sac, avec l'intention de préparer ce que je veux emporter, lorsqu'un vieux poilu me dit : "Où vas -tu ? - Au poste de secours, je suis blessé ! - Veux-tu un bon conseil ? Reste là tranquillement. Si tu veux te faire achever, vas-t'en. Mais attends plutôt le jour, ça se calmera et tu pourras partir. Tu te ferais tuer en partant maintenant." Je l'écoute et je reste, car j'ai confiance en lui. C'est un vieux, il sait mieux que moi ce qu'il y a à faire. Il veut voir ma plaie afin d'y faire un pansement. Il regarde, me dit que ce n'est pas grand chose, et veut me mettre un petit pansement. Je l'en dissuade, en lui disant que le sang s'arrêtera bien de couler tout seul. Il me laisse. Je prépare ma musette, et je m'asseois dans le fond du boyau. Depuis un moment le ciel était parsemé d'éclairs. On n'y faisait pas attention, croyant que c'étaient des départs de pièces, lorsque brusquement une pluie diluvienne se met à tomber. Au moment où j'ai été renversé par le 88 qui m'a blessé, je me suis allongé à plat ventre dans la boue, et ma figure n'a pas manqué de se maquiller de cette boue jaunâtre. Ma capote n'est plus bleue sur le devant, mais jaune : je ressemble plus à un tirailleur qu'à un honnête pioupiou.  Cette pluie délaie tout ça, rend la couche plus uniforme et me traverse. On m'aurait pris ma température à ce moment, j'avais au moins quarante degrés... ! Incapable de faire un mouvement, je sentais l'eau monter lentement sous moi, mais je ne bougeais pas : je ne pouvais pas bouger... ! Enfin, au bout de trois quarts d'heure ou une heure, la pluie cessa. Heureusement, car il y avait déjà, au moins dix centimètres d'eau au fond du boyau, qui n'avait d'écoulement nulle part, et dont la terre était imperméable. Enfin le petit jour parut. J'appelais les brancardiers que je croyais devoir être là, afin de me faire indiquer le chemin du poste de secours. Mais personne ne répondit. Alors passant ma musette en bandoulière, je pris mon courage à deux mains, rassemblai toute ma volonté de partir et toute mon énergie, et je filai. Le barrage, depuis une demi-heure tendait à s'apaiser. Il ne tombait plus que de rares obus à droite ou à gauche. Je filai en reprenant le chemin parcouru la veille par la compagnie. J'arrivai essoufflé, épuisé, rendu au poste de secours. Le major, après avoir coupé les cols de ma veste, de mon chandail et de ma chemise, me fait un pansement sommaire, me donne une fiche que j'accroche après un bouton et me voilà parti vers Aizy en compagnie de deux brancardiers qui emportent un moribond sur leur brancard. Nous faisons vite pour suivre cette petite route qui suit le ravin car cet endroit a été battu par l'artillerie toute la nuit, et il suffirait d'un hasard pour que ça recommence. A un tournant du chemin, un spectacle horrible se montre : une section de mitrailleuses avec ses voiturettes, montait en ligne. Elle fut prise sous le feu boche. Ce qu'il reste est effroyable : des voiturettes en miettes, les caisses de cartouches éventrées, traînant à droite et à gauche, les mulots déchiquetés et les hommes, pauvres cadavres mutilés; l'un d'eux a le corps à gauche de la route et la tête à droite. Cette horrible vision me fait mal au coeur. A un moment je tremble à l'idée que je pourrais être achevé, et, malgré ma blessure, malgré ma fièvre, malgré mon épuisement, j'ai envie de courir, mais je me ressaisis vite et c'est du même pas tranquille des brancardiers que nous arrivons à Aizy. On nous fait entrer dans la cave d'une maison en ruine, pour la piqûre anti-tétanique. Il faut baisser son pantalon, afin que le major fasse une piqûre au-dessus de l'aisne, à gauche du nombril. Il pince la peau, enfonce la seringue, je sens le liquide entrer dans la chair, il enlève vivement sa seringue. Heureusement qu'une table se trouve derrière moi. Je n'ai que le temps de m'appuyer contre : tout tournoie, de grosses gouttes de sueur froide coulent sur mon front. Cela dure deux minutes. J'avale une tasse de thé que l'on me présente et ça va mieux. Une voiture arrive, j'y monte avec plusieurs camarades. Elle nous conduit à Vailly. Là on nous prend nos noms et divers renseignements et on nous fait descendre dans une cave minée, dont le tonneau de poudre, encore dans son trou, installe sa rotondité dangereuse. On attend l'auto sanitaire. Elle arrive bientôt et à toute allure, nous filons sur Couvrelles. Là encore, nom, prénoms, on nous fixe l'hôpital d'opération et d'évacuation (HOE) où nous devons aller. Je suis désigné pour aller au Mont-Notre-Dame. L'auto nous emmène aussitôt, et à onze heures du matin, j'arrive à l'HOE, le 6 mai. Que de foule... ! Les chirurgiens avaient de la clientèle. Yeux brûlés par les gaz, pieds arrachés, jambes ou bars enlevés, et blessures simples. Il y en avait de tous les genres. Un infirmier disait que dans la journée du 5, les chirurgiens avaient fait plus de mille opérations.  Vers midi nous fûmes restaurés. Maintenant que je me voyais arrivé, je n'avais plus de soucis. Nous craignons encore les gros calibres et les bombes d'avions. Mais nous étions à l'abri des boches eux-mêmes, ce qui était beaucoup; aussi fut-ce de bon appétit que je mangeais le morceau de viande et le riz qui me furent présentés. Malheureusement j'étais plus gêné que je n'aurais voulu. Ma tête s'était ankylosée, ainsi que mon bras droit. J'avais alors la tête inclinée sur le côté droit sans rien pouvoir faire pour la relever et le bras immobile. Je devais être plutôt ridicule; enfin, ce n'était pas de ma faute... ! Je partis aussitôt vers la salle d'opérations, mais je ne passai pas ce jour-là. Il y en avait trop à attendre. Je retournai vers la baraque où j'avais mangé, et là, je retrouvai l'ordonnance du capitaine avec deux balles dans le bras. Nous discutâmes un moment, puis voulant essayer de dormir, je fermais les yeux. Mais impossible de sommeiller. Alors je songeai, et c'est ainsi que ma nuit se passa. Enfin le lendemain, 7 mai, à quatre heures, nous fûmes appelés pour les opérations. J'entrai dans la salle du billard. Un coup de ciseau dans le dos de la veste, puis deux infirmières tirent chacune de leur côté, de même pour le chandail et la chemise. La ceinture de flanelle prend le même chemin. On me coupe mon pansement. Le major examine la plaie, puis m'envoie à la radiographie. En un quart d'heure ces messieurs connaissent et ont inscrit au crayon-encre sur mon cou, l'emplacement exact de l'éclat. Je retourne alors dans la salle d'opérations. On me fait coucher sur le billard, mais auparavant, ces dames voulurent me déchausser. Mais ça faisait trois ou quatre jours que ça ne m'était pas arrivé, et avec l'eau de la nuit, il y avait des difficultés. Enfin à deux elles y réussirent. Je fus ensuite ligoté par les bras et par les jambes avec des cordes. Enfin, on me plaque sur le bas du visage, un masque conique en me commandant de respirer : c'est du chloroforme. Je m'étais bien promis de faire vite, aussi aspirai-je un bon coup... J'ai la sensation d'une chute dans le vide. Puis plus rien... ! Au bout d'un moment, long... court... le sais-je... ? j'entends une voix qui dit : "Faites vite, il pourrait payer ça fort cher... HO-CL-X-1..." Est-ce bien ces lettres ? Je ne sais, je n'ai pu retenir la formule réelle, dans l'état dans lequel je me trouvais. Ce que j'ai entendu bien distinctement, c'est -1. Aussitôt, je sens une nouvelle dose de chloroforme pénétrer dans le masque. Je veux crier : j'étouffe, je ne réussis qu'à grogner : "J'étouf... j'ét..." J'entends toutes les cloches de France et de Navarre, sonner à toute volée, et c'est le néant... Lorsque je reviens à moi, je me demande quels sont les deux yeux que je vois si près des miens. Je suis encore dans le demi-sommeil, mais une voix se charge de m'en tirer : "Eh bien, comment ça va ? - Je ne sais pas... telle fut ma réponse. Qu'est-ce qu'il y a ? - Vous savez, l'opération a bien marché. Votre éclat est dans le bracelet de toile que vous avez au poignet droit." Machinalement, je jette les yeux à l'endroit indiqué et tout me revient en mémoire : "Oui, oui, ça va bien..." réponds-je dans un souffle. J'ai entendu dire que le chloroformé, d'habitude, et je l'ai vu dans cette salle, rend le surplus de chloroforme et en même temps ce qu'il a sur l'estomac. Ma foi, en me réveillant, je n'ai rien ressenti... ou plutôt, si... j'avais faim !... Heureusement on me fit cadeau d'un quart de jus, et à dix heures, d'une bonne soupe. Mais j'étais toujours allongé sur ma paillasse, ne pouvant faire un mouvement sans avoir la sensation d'avoir la tête arrachée du tronc. Pour m'asseoir sur mon séant, afin de pouvoir manger, deux brancardiers, m'avaient aidé à me relever, puis à me recoucher. Dans l'après-midi, ayant envie d'uriner, j'appelais les brancardiers, pas de réponse. Je criais, personne... Alors mes nerfs surexcités et tendus, me lâchèrent brusquement, et je me mis à pleurer, tout en réclamant toujours les brancardiers. Alors j'essayai en roulant, de descendre de dessus ma paillasse. Je réussis à me coucher sur le ventre, une jambe pendant en dehors, mais impossible de me relever... Je souffrais horriblement... Heureusement, deux camarades entrant dans la baraque à ce moment me virent et vinrent m'aider. Je pus aller à mes besoins. La fin de la journée se passa lentement. La nuit me parut interminable. J'avais de la fièvre et je savais comment me placer pour dormir. Je ne réussis pas à fermer l'oeil. Le lendemain, 8 mai, dans la journée, j'eus la visite du chirurgien qui m'avait opéré : le docteur Martin. J'étais un peu ragaillardi à l'idée de partir bientôt. Je savais que j'étais évacué à l'intérieur : "Eh bien, comment ça va ? - Très bien, Monsieur le Major, je n'attends plus que le moment d'aller voir Paris ! - Ah, tu es de Paris ? - Oui, Monsieur le Major. - Il y a un train qui part pour La Chapelle, ce soir. Je vais tâcher de t'y embarquer. - Je vous remercie d'avance, Monsieur le Major." Sur ce il partit, me laissant dans la joie : je me voyais déjà à hôpital à Paris. Un quart d'heure plus tard, il revint : "Je ne peux pas te faire partir ce soir, il n'y a plus de place. Mais voici une carte, tu la donneras au médecin de service du train qui t'emmènera demain. Il tâchera de te faire rester le plus près possible de Paris. Et voici ma carte, écris-moi dès que tu seras arrivé." Je sus par des camarades, qu'il s'était intéressé à moi, à cause de mon cas, qui, au point de vue chirurgical, était assez curieux. En quoi, je ne sais. Enfin, le lendemain, 9 mai, à dix heures, j'embarquai. Jusqu'à Châlons-sur-Marne, je souffris terriblement. J'étais blessé couché. Etalé sur un brancard suspendu, et le poilu qui s'occupait du wagon, m'avait fait un traversin avec une couverture roulée, afin que mon cou repose bien dessus. Mais le mécanicien du train s'arrêtait et repartait si brusquement, qu'il donnait aux brancards un mouvement de va-et-vient, d'avant en arrière, qui était insupportable. Je souffrais tellement qu'il me semblait que ma tête se décollait. Après Châlons, où nous avions changé de machine, le mécanicien fut très doux, et le voyage me fut moins pénible. Tout en roulant, j'avais causé avec le brancardier de service dans le wagon, et lui avais fait part de mon désir de rester près de Paris, puisque le train n'y allait pas, ainsi qu'il avait eu l'occasion de me le dire un instant plus tôt. Il me donna alors un tuyau : "Nous allons arriver à Troyes. Tu vas te coucher, et j'irai voir le toubib, en lui disant qu'il y a un blessé qui ne peut pas aller plus loin. Il te fera sûrement descendre à la station suivante qui est Sens, et qui n'est qu'à cent kilomètres de Paris. Seulement tu te coucheras, en arrivant près de Troyes, qu'il ne te trouve pas debout. - Bon c'est entendu. Je te remercie." Ainsi fut fait. En approchant de la gare, je me couchai, et sitôt le train arrêté, il courut voir le major. Cinq minutes après ils étaient de retour : "Eh bien, ça ne va pas, mon petit gars ? me dit le major. Qu'est-ce qu'il y a, tu es fatigué ? - Oui, Monsieur le Major. Ma blessure me fait mal. - Eh bien, je ne peux pas te faire descendre ici, car tu es évacué dans la zone de l'intérieur, et, de plus mes dispositions sont prises, quant à ceux qui descendent ici. Mais à Sens, je tâcherai de t'y laisser. Patiente jusque là. - Je vous remercie, Monsieur le Major." Ainsi donc, ça avait parfaitement réussi et j'allais descendre, relativement près de Paris. Le train se remit en marche, et nous étions bientôt arrivés. Je me préparais à... ficher le camp, quand le major s'amena au wagon : "Il faut que tu restes jusqu'à Montargis. Ici on ne peut faire descendre personne. Ce n'est pas loin, il n'y en a donc pas pour longtemps." Eh bien soit, allons à Montargis... En arrivant à cette gare, on me fit descendre de wagon, et j'adressais mes adieux au brancardier : "Au revoir, vieux ! Et merci ! - Pas de quoi ! Bonne chance ! Au revoir !" Je traversais la voie et entrais dans la gare. Ici étaient descendus quatre blessés couchés et moi. On nous fit monter dans une petite auto sanitaire, faisant le service entre la gare et hôpital : les autres sur leurs brancards dans l'auto, et moi sur le siège, à côté du conducteur. L'auto filait à bonne allure et nous ne fûmes pas longs à entrer dans la cour de l'hôpital-mixte où nous devions être soignés. Je mis pied à terre, et en regardant où je posais le pied, je me vis tel que j'étais, et j'eus honte de moi-même : mes pieds noirs, nus dans mes godillots non lacés, pas de caleçon, mon pantalon tenant par un prodige, et enfin, ma capote jetée sur mes épaules, le torse nu dessous. Et la capote, jaune de boue séchée, formait carapace. Ah... ! J'étais propre. Je pouvais me montrer dans le Grand Monde... ! Je grimpai le perron, sur l'invitation d'une infirmière, et j'entrai dans une salle bien propre, parquets cirés, murs et tables de nuit blancs, le tout luisant de propreté. Je n'osai toucher à rien, ni même poser mes pieds à terre, j'avais peur de tout salir. On m'indiqua un lit et je m'assis sur la chaise se trouvant à côté. Pendant ce temps, une infirmière apportait une cuvette. Je me déchaussai, voulant me laver les pieds moi-même avec ma main gauche qui était libre. Mais elle ne l'entendit pas de cette oreille. Elle me commanda de rester tranquille, et me savonnant mes petons, elle fit leur toilette elle-même. Elle était moins dégoûtée que moi, car je ne l'aurais pas fait pour un autre : j'aurais reculé devant une telle odeur... ! Comme je donnais mon nom et le numéro de mon régiment, une voix m'interpella : "T'es du 355 ? Le pote." La voix sortait d'un volumineux paquet de pansement, enveloppant la tête d'un poilu couché dans son lit. Sur ma réponse affirmative, la voix reprit : "J'suis du 172. J'ai été brûlé dans un incendie à Braine. Un obus qu'est tombé sur la maison où j'étais, le 15 avril, et j'ai eu les mains et la figure brûlées." Nous causons encore quelques minutes, puis je passe dans la salle de pansements. Un coup de ciseaux pour fendre la toile en deux... Le major tire un bon coup... Je lâche un : ah!, vite réprimé. Cela a été si vite fait que j'ai eu à peine le temps de sentir la douleur. On me renouvelle mon pansement, et c'est alors qu'une infirmière complaisante, à l'aide de deux glaces, me montre l'état exact de ma blessure : il y a deux plaies rondes, l'entrée et la sortie, alors que je croyais avoir une plaie en longueur. Le major me déclare que ce n'est rien, et il m'envoie avec les petits blessés et les malades, à la salle d'asile. J'y fus accueilli par une soeur qui m'indiqua un lit, en me demandant mon âge (je paraissais si jeune !), d'où je venais et divers renseignements. Quand je lui eus dit que j'avais dix-huit ans, elle en fut étonnée. Elle m'appela son enfant et me fit toutes sortes de cajoleries. Je me couchais, car je ne tenais plus debout. Depuis la nuit du 3 au 4 mai, je n'avais pour ainsi dire pas dormi, reposant par intervalles, d'un sommeil léger, agité, nerveux et traversé de cauchemars. La douceur des draps blancs me remplit d'un bien-être immense, et je m'assoupis... C'était le 10 mai 1917. Il était une heure de l'après-midi... L'hôpital. Le dépôt. J'entends dans un rêve sonner quatre heures. Je me frotte les yeux et en voyant les rangées de lits aux draps blancs, je reprends conscience avec la réalité. Ainsi donc c'est bien vrai, j'ai été blessé et je suis à l'hôpital. Mot magique et si plein d'espérance, lorsqu'on y pense au front. On voit en songe, pendant que sifflent balles et obus, des lits propres, et de bons plats défiler devant nos yeux émerveillés, et l'on se demande s'il n'y aura pas un boche intelligent pour vous flanquer une balle dans une jambe ou un bras ou si un obus bien envoyé, ne vous permettra pas de partir avec la fameuse fiche rouge pendant à la boutonnière... L'aventure m'est arrivée et je suis là, allongé bien douillettement entre deux toiles, sentant bon le frais blanchissage.  Dehors il fait un temps splendide : ciel pur sans un nuage et soleil éblouissant. Je voudrais pouvoir me lever et courir dans les rues de la ville, sans avoir à baisser la tête ou à faire d'un brusque mouvement, un plat-ventre par principe. Mais barca, défense de bouger. Néanmoins ça va beaucoup mieux. Le pansement frais m'a fait du bien et engourdi ma blessure. Je ressens plutôt une gêne qu'une souffrance... Une infirmière de service m'apporte une petite table montée sur quatre pieds bas se posant sur le lit. Ensuite défilent une bonne soupe, un beau morceau de viande, cuit à point, et une assiettée de pommes. Il me reste quatorze sous que j'ai sauvé du naufrage, car avant de monter en ligne, le 4 mai, j'ai fait comme le 15 avril, j'ai pris la précaution de dépenser mon argent... Précaution que je regrette maintenant... Sur le reliquat de ma modeste fortune, je tire treize sous, moyennant quoi j'ai droit à un paquet de cigarettes, dont j'en tire une que je fume avec délices. J'ai écrit sitôt arrivé, à mes parents afin de leur faire part de mon adresse, et en même temps du dénuement dans lequel je me trouve... Je vais donc fumer mes cigarettes doucement, afin qu'elles durent jusqu'à l'arrivée du mandat sauveur, car le temps n'est plus où l'on distribuait à pleines mains, tabac et cigarettes aux blessés... On me procure des livres et je lis un bon moment. Mais la fatigue l'emporte et je pars pour le doux pays des songes... Je suis réveillé le lendemain matin, par un bruit de vaisselle remuée. C'est l'infirmier de service qui distribue un bol à chaque poilu. Me voici frais et dispos, ragaillardi par la bonne nuit que je viens de passer. Aussi est-ce d'un oeil intéressé que je suis les évolutions du bonhomme... Après les bols, il répartit un panier de pain à raison d'une tranche par occupant de la salle... Et, enfin, arrive le café au lait. Je me jette là-dessus comme un affamé... Tout en mangeant, mon voisin de gauche cause : "Eh bien, mon vieux, qu'est-ce qu'ils ont pris les boches, cette nuit ! - Comment ça ? - Ben oui, tu leur en as raconté... Ils avaient dû vouloir te vendre des fayots qui voulaient pas cuire... C'que tu les a engueulés... !" Moi, qui croyais avoir dormi d'un sommeil sans rêve... ! Nous plaisantons cinq minutes tout en ingurgitant pain et café au lait. Ensuite, une cigarette, et je reprends ma lecture. A neuf heures je me lève, ne ressentant plus de ma blessure qu'une ankylose de la tête et du bras. La soeur, au moment de l'arrivée du major, me défait mon pansement et me toubib m'examine. Il trouve que ça va très bien et passe à un autre. Soeur Blandine (tel est le nom de mon infirmière) me refait mon pansement, et d'une main moins que douce, car elle me fait rudement mal, surtout qu'avant de poser la bande, elle presse sur chacune des deux plaies, pour en extraire le pus. Heureusement il n'y en a pas beaucoup, et, me dit-elle, mes blessures sont très saines. Si elles ne l'étaient pas je pourrais crier à l'assassin... Maintenant que je suis levé, ça ne me dit rien de me recoucher, d'autant plus qu'il va être l'heure de la soupe. De plus il fait un beau temps dehors. J'ai envie de voir le jardin, et ma foi, je reste debout, et sors. Le jardin est dans toute sa vigueur printanière; l'air est pur. On est très bien. Je reste assis sur un banc jusqu'à l'heure de la soupe, qui ne tarde pas, d'ailleurs... De midi à quatre heures, on peut sortir en ville, je vais en profiter. J'ai une folle envie de voir ma veste fleurie des deux rubans auxquels j'ai droit maintenant : croix de guerre et insigne des blessés. Je vais visiter la ville avec l'espoir de satisfaire mon envie, lorsque, au moment d'entrer dans une boutique, je me rappelle qu'il me reste... un sou... ! Tant pis ce sera pour plus tard ! Je vais voir les bords du canal et je rentre tranquillement. Je passai une meilleure nuit encore que précédemment, et le lendemain matin, les mêmes cérémonies que la veille se déroulent. A dix heures je reçois un mot de mes parents en même temps qu'un mandat... Béni soit-il... ! Ma mère m'annonce qu'elle fera son possible pour venir me voir le jeudi de l'Ascension. Je voudrais déjà être à ce jour-là. Il est vrai que c'est le 17 et que nous sommes au 12. Donc plus que cinq jours à attendre... Qu'ils vont me sembler longs... L'après-midi je satisfais mon envie, je rentre vivement, et je couds immédiatement mes deux insignes sur ma veste. Je voudrais déjà ressortir pour m'exhiber. Mais la soupe est là et il faut rester... Ce sera pour demain. Je me suis lié avec quelques camarades et nous pouvons faire une manille. Le lendemain, un de ces camarades passe la matinée à m'apprendre à jouer au jacquet : telle sera ma distraction, tous les matins et tous les soirs. L'après-midi je sors avec lui. Nous entrons dans un café, après une bonne promenade. Nous commandons deux bocks et nous mettons en devoir de rouler chacun une cigarette. En nous voyant, un consommateur s'approche : "Eh... les amis, vous n'auriez pas une cigarette à m'offrir ?" Je pousse un ah! de stupéfaction. J'ai toujours entendu dire que les poilus étaient bien choyés par les civiles qui leur offraient des cigarettes et mille autres douceurs, et voilà que... Ah non, alors, pas de ça... ! "Non, mais dites donc, depuis quand avez-vous vu des poilus faire des cadeaux aux civils, répliquai-je. Dans mon pays c'est le contraire qui se passe ! Sans blague, vous ne vous doutez pas que nous ne gagnons que cinq sous par jour ? Si vous n'avez pas de tabac, le bureau n'est pas loin, faites comme nous, ou alors contentez-vous de cracher... !" Ce vulgaire pékin ne voulut pas en entendre davantage. Il prit la poudre d'escampette. Nous causons encore cinq minutes de cet incident. Un bonhomme, à côté de nous avait suivi la scène d'un oeil amusé, et se tournant vers moi : "Qu'avez-vous donc au cou ? Un furoncle ? - Oui, un clou en acier qui m'est entré dans la viande, au Chemin des Dames... !" Décidément c'était le jour. Ils avaient tous envie de se f...icher de moi, aujourd'hui... ! "Des drôles de civelots qu'il y a à Montargis, dis-je à Max (ainsi surnommons-nous le copain, car il ressemble beaucoup à Max Linder, le comique du cinéma). Ils ne savent donc pas qu'il y a la guerre ?" Puis nous sortons, tout en riant de l'inconscience de ce bonhomme. Pendant deux ou trois jours, nous passons nos matinées à jouer au jacquet et nos après-midi à nous promener. Enfin, le jeudi tant attendu arriva. Ma mère devait arriver vers dix heures ou dix heures trente... J'étais à table, lorsqu'elle se montra à la porte de la courette dans laquelle nous mangions... J'eus vite fait de laisser là patates, viande, pinard et tout le reste. Je lui sautais au cou car je la voyais bouleversée par ma trombine. Il est vrai que j'étais bien changé pour ceux qui m'avaient vu grassouillet, les joues pleines. J'étais devenu, en quelques jours de front et hôpital, blême, les yeux caves et les pommettes saillantes, et j'avais rudement maigri. De plus, ma tête penchée et mon bras ankylosé n'étaient pas faits pour me donner une allure bien guerrière. En un bond, je saute sur mon képi et en route. Nous partons à l'aventure, tout en causant. Nous en avons tant à nous raconter. Enfin vers midi, notre estomac nous rappelle à la réalité, nous cherchons un petit restaurant tranquille, et nous mangeons. Ensuite quelques cartes à mon père et je reconduis ma mère à la gare, non sans qu'elle m'ait promis de revenir bientôt et, cette fois, accompagnée de mon père. Les jours qui suivent s'écoulent monotones. Ma blessure se cicatrise assez rapidement. Mon ankylose a tout à fait disparu et, à part une petite gêne de la tête, je suis libre de mes mouvements. Je suis devenu tout à fait bon au jeu de jacquet, et le jeu de piquet n'a plus de secrets pour moi. C'est à jouer ainsi que le 27 mai, dimanche de Pentecôte, arrive tranquillement. La soeur était en train de refaire mon pansement, lorsque mes parents arrivèrent. Ma mère voyant cela, renonça à entrer dans la salle, tandis que mon père venait voir l'état de mes plaies. Elles étaient très jolies, et il n'eut pas à faire le dégôuté. En deux temps et trois mouvements, je suis prêt et nous filons. Mes parents ont apporté à manger, aussi n'avons-nous pas à recourir au restaurant. Nous nous dirigeons tranquillement vers le bois qui se trouve de l'autre côté du canal et de la voie ferrée, et nous nous installons sur l'herbe, pour y savourer notre repas, tout en devient gaiement. L'après-midi, promenade et le soir, mes parents restant les deux jours à Montargis, s'en vont coucher à l'hôtel, pendant que je rentre à hôpital Le lendemain matin, même programme. Le soir, je les reconduis tous deux à la gare, et rentre à l'hostau, très satisfait de mes deux journées. Le temps passait assez vite en sorties en ville et en jeux de cartes ou de jacquet. Enfin ma blessure se guérit peu à peu et je vois se dresser devant moi, le spectre de la convalescence. Combien aurai-je ? Vingt jours ou simplement sept ? Il me semble que blessé, j'aurai bien vingt jours, peut-être même un mois. Tous les lundis, le chirurgien, accompagné du médecin-chef, passe la visite de "vidage". C'est le lundi qu'ils déclarent tous deux, les guéris sortants. Le lundi 4 juin, je suis sûr de mon affaire. je ne porte plus qu'un pansement insignifiant, et certainement ils vont me "vider". A huit heures, tout le monde est à son poste, c'est-à-dire au pied de son lit. Les deux toubibs s'amènent et la visite commence... Quand il arrive à moi, il regarde les plaies découvertes et jette un "sortant" d'une voix profonde... Les vidés, d'habitude, prennent leur train le mardi, car on leur fait leurs papiers (feuille de route et autres) dans l'après-midi du lundi. Mais cette fois, je ne sais pour quel motif, on nous annonce que nous ne partirons que mercredi, mais moi, ça ne fait pas mon affaire. Voici trois jours que ça ne va pas. Hier dimanche, j'ai voulu sortir en ville, mais j'ai été obligé de rentrer en vitesse, je ne tenais pas debout. J'ai la bouche entourée de boutons de fièvre et je tremble. Ce matin, pour la visite, je me suis levé, non sans peine. Le major n'a pas même fait attention aux boutons et à ma mine. Mon intention était celle-ci : être sortant aujourd'hui, pren- (manque page 99) - Il faut que tu prennes un lavement. - Moi, jamais de la vie ! Le toubib n'a jamais dit ça... !" La soeur n'étant pas là pour me soutenir, et l'infirmier insistant, je dus me soumettre à cette opération. Il était monté sur une chaise et tenait le récipient le plus haut possible, lorsque la soeur arriva : "Mais vous êtes fou... Ce n'est pas à celui-là que je vous avais dit de donner un lavement, c'est au numéro 32 !" Le bonhomme ne se troubla pas pour si peu : "Ah... je me suis trompé ! Oh ben, puisque je suis en train, je vais tout lui donner. Si ça ne lui fait pas de bien, ça ne lui fera pas de mal !" Inutile de dire que toute la journée on ne vit que moi aux cabinets... J'étais dans une colère folle, de voir la manière dont on était soigné. Aussi je cherchais un moyen pour filer le plus vite possible... Je l'eus vite trouvé... Matin et soir, on me prenait ma température. L'infirmière me donnait le thermomètre que je plaçais moi-même à l'anus. Ces thermomètres médicaux, une fois montés, ne redescendent pas tout seuls. Je savais qu'il fallait les secouer. J'avais encore à ce moment 38°5 passés de température le matin et 39 le soir. Pour débuter, j'arrêtais, le premier jour que je mis mon idée à exécution, le thermomètre à deux ou trois dixièmes de degré plus bas que la veille, et tous les jours de même. Au bout de trois jours, je n'avais plus de fièvre d'après le thermomètre, alors qu'en réalité, j'en avais autant. Le mardi 12 juin, le major, constatant d'après ma feuille, que je n'avais plus de fièvre, me déclara que j'allais pouvoir partir. J'allais au bureau faire établir mes feuilles, car il donnait sept jours de convalescence (ô le mois espéré, où es-tu ?). Le chef des scribouillards de l'endroit, un sergent me dit que je devais attendre jusqu'au samedi, car ma croix de guerre était arrivée, et que, comme il y avait une prise d'armes à hôpital, on me la remettrait à cette occasion. Je lui demandai, comme complaisance de me tenir mes feuilles prêtes pour samedi matin, le train pour Paris partant à deux heures vingt-huit, et la prise d'armes étant pour le matin. Vendredi, changement d'ordres. La prise d'armes est reportée au 14 juillet, mais le colonel du 82e d'infanterie qui devait la présider annonce en même temps, que s'il se trouve à hôpital, des soldats devant partir en permission et ayant à recevoir la croix, il se dérangera néanmoins pour la leur remettre en sortant du conseil de réforme, où il était président tous les samedis. Ce cas est le mien et je suis d'ailleurs le seul de cette catégorie. Ainsi donc le colon se dérangera pour moi, personnellement. Ma matinée du samedi se passe à faire mes musettes et à découdre mon insigne de croix de guerre, afin que le colon puisse épingler la croix elle-même à l'emplacement voulu. A dix heures la soupe... D'être resté debout toute la matinée, et la nervosité du départ aidant, la fièvre m'a repris. Je suis dévoré par la soif, une soif intense... Onze heures, personne... Midi, toujours rien. Je commence à m'impatienter. Une heure, je n'y tiens plus, j'ai trop soif... Je sors et vais dans le café de l'autre côté de la rue, juste en face de la porte de hôpital Je commande une boisson glacée que j'avale d'un trait et paye en vitesse... Je ne suis pas resté cinq minutes parti... A peine rentré, je vois le chirurgien arriver vers moi, essouflé : "On vous cherche partout ! Arrivez vite, le colonel vous attend, dans le bureau du médecin-chef !" Ainsi donc pendant le peu de temps que je m'étais absenté le colon avait trouvé le moyen d'arriver. Je me hâtais vers le bureau où il m'attendait, car j'étais pressé par l'heure de mon train, que j'entendais ne pas manquer, cela me permettant de passer deux dimanches, chez nous avec mes sept jours. J'y trouvai effectivement les deux officiers annoncés. Je me mets au garde à vous en entrant et le "cinq-ficelles" me fait son petit speech : "Bon soldat, fait-il, après avoir lu le texte de la citation continuez... courage... en avoir d'autres... !"  Bon sang, qu'il est long... ! J'ai aperçu, en entrant mon titre de permission, sur le bureau du toubib, mais il n'est pas signé, je voudrais bien que l'autre ait fini son discours ! Enfin, il s'arrête, pour respirer, sans doute, il accroche et m'embrasse. Aussi, avant qu'il ne reprenne la parole, je ne perds pas de temps ! "Pardon, Monsieur le Médecin-Chef, dis-je, mon Colonel a-t-il signé ma permission, s'il vous plait ? - Ah bien, il ne perd pas le nord, celui-là ! Où est-il, ce titre que je le lui signe !" Le médecin lui donne et il signe. Ensuite vient le tour du médecin et j'ai enfin le précieux papier dans la main. Cinq minutes après je suis dans le bureau des secrétaires. J'attends un instant mes papiers : bulletin hôpital, certificat de cessation de paiement, mais il manque encore mes feuilles de route : "Il faut que vous attendiez encore un peu, me dit le sergent, le cycliste est allé les chercher à l'intendance, il ne va pas tarder." Pourvu qu'il ne crève pas en route... Je vais à la porte le guetter. Pour prendre patience, je mets mes musettes sur le dos. Il est deux heures passées quand il arrive. Je lui saute dessus. Il me remet mes précieuses feuilles et je bondis. La gare est assez loin et je n'ai qu'une vingtaine de minutes... Enfin, je me dépêche et j'arrive à temps. A cinq heures trente je débarque à la gare de Lyon, et, peu après, chez nous... ...Je passe une assez bonne permission, malgré que je sois mal fichu. Cela ne fait rien. Je suis chez nous, c'est tout ce que je vois pour le moment... Le 25, je quitte mes parents pour Saint-Brieux. Ayant été évacué à l'intérieur, je rejoins le grand dépôt du 355 qui est là-bas. le 26, au matin, j'y arrive. A la gare on me dit que je dois aller jusqu'au Légué, port de Saint-Brieux, et où se trouvent les bureaux des compagnies de dépôt. J'y pars tranquillement après avoir pris un bon café. Au bureau de la compagnie, ça va vite. On me prend mes papiers sans même y avoir jeté un coup d'oeil. J'aurais pu rester quatre ou cinq jours de trop chez nous, qu'ils ne s'en apercevrait même pas. Je suis affecté à une escouade, avec laquelle je ne tarde pas à faire connaissance. Nous sommes logés dans un grand moulin. Mais nous ne devons pas y rester longtemps car des bruits de départ pour Saint-Brieuc circulent. Ils ne tardent d'ailleurs pas à se réaliser, car trois jours plus tard, toute la bande d'éclopés se met en route pour entrer en ville. Ah, la belle marche ! Nous mettons plus d'une heure pour faire les trois kilomètres qui nous séparent de notre nouvelle résidence. Nous allons près de la place du marché, dans un ancien patronage, rue du combat des trente. On demande à midi au rapport, un planton pour le palais de justice. Je me suis fait inscrire, car ça s'embête rudement de faire les corvées. J'ai été classé C3 à la visite d'entrée le jour même de mon arrivée. Les blessés rentrants sont classés en trois catégories : C1, C2 et C3, ceux-ci étant les plus valides et tous les huit jours, nous devons passer une visite semblable. Je suis accepté comme planton, et j'en suis satisfait. Je commence mon service le jour même. Il s'agit de se tenir sur un banc à la porte du Palais et de renseigner les visiteurs et tous ceux qui y ont à faire. Malheureusement le lendemain, comme je m'étais absenté à dix heures pour aller manger la soupe, l'officier en rentrant me dit que je dois toujours être présent. Ceci est impossible et je le lui fais comprendre : "Vous n'avez qu'à être deux, me dit-il, et en vous arrangeant bien, ça ira, il y aura toujours quelqu'un là." Le soir même, je fais part à l'aspirant de semaine de la communication de l'officier, et il m'est adjoint un second poilu, avec lequel je m'entends. Nous prendrons chacun vingt-quatre heures de service tous les deux jours, de onze heures à onze heures, puisque telle est l'heure de la soupe. Celui qui devra prendre mangera à dix heures quarante-cinq et viendra de suite, afin que le relevé mange le plus tôt possible. Un avantage que je n'avais pas prévu dans ce service est le suivant : dans la journée, à part les corvées régulières, personne ne peut sortir du cantonnement, à la porte duquel se tien un caporal de service, tandis que le copain et moi, pouvons aller et venir à toute heure. Il nous suffit de dire en sortant que nous sommes de planton au Palais et que nous allons prendre notre service. D'ailleurs en deux ou trois jours, nous sommes connus et on ne nous dit plus rien. Ceci est d'autant plus précieux qu'il fait un temps superbe et que je désire en profiter le plus possible. Il y a un tramway à vapeur qui quitte Saint-Brieuc et va vers la mer, en suivant le rivage. Il se rend jusqu'à une petite plage : la plage des Rosaires, où il fait bon se baigner. En peu de temps on ne voit plus que moi au bord de la mer. Je quitte mon service à onze heures, je mange en vitesse et vais prendre le tacot. En arrivant, je loue un caleçon, je vais me déshabiller dans les rochers, et ensuite je fais mon petit Neptune fendant les ondes. Au début j'éprouve du mal à nager, car je n'ai jamais été qu'en eau douce, mais l'habitude vient vite et en peu de temps, je nage aussi bien ici que dans une piscine. Quand j'en ai assez, comme il fait très bon, je cherche des moules, elles sont bien petites, mais bonnes quand même. La nuit, je dors d'un sommeil calme et le matin, je peux faire la grasse matinée, puisque je ne reprends mon service qu'à onze heures. Etant de service, maintenant que je suis au courant, je monte jusqu'à la cour d'assises. J'ai ainsi, l'occasion d'assister au jugement de deux femmes, une de vingt-six ans et sa soeur de quatorze ans, coupables de tentative d'assassinat et complicité. Mais cette affaire est renvoyée à trois mois, faute d'un témoin important qui manquait. Ainsi les jours passent tranquillement, lorsque le 7 juillet, un samedi, il me semble qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu mes parents. Le cafard me travaille. Je sais que l'on peut prendre le train comme l'on veut. Il y a un express à 19 heures 21, je saute dedans. Le lendemain je débarque chez mes parents stupéfaits. Une journée ensemble et le soir même je repars. Le lundi matin, je rentre bien fatigué, mais content quand même. Comme on a parlé, il y a quelques jours des permissions agricoles, j'ai écrit à Madame Reillon, pour lui demander si elle voulait m'envoyer un certificat... Je l'ai reçu par retour du courrier. Le 12, je passe la visite médicale, et le 13 à vingt heures, je quitte Saint-Brieuc, afin d'avoir la correspondance à quatre heures quarante, comme l'année précédente. Mais en arrivant à Laval, surprise, le train du matin est supprimé, il n'y en a plus qu'un pour Craon, à quatorze heures quatorze. Je vais donc passer la matinée à Laval. La ville est pavoisée pour la fête nationale. Je passe le temps en me promenant, en écrivant à mes parents et amis, et en mangeant... A l'heure dite, je m'embarquais et arrivais dans la soirée à Chassebourg, où je reçus un accueil chaleureux. Mes parents m'avaient écrit qu'ils viendraient comme l'an passé, prendre leurs vacances à Laigné. Le 21 juillet, ils arrivaient. Les Reillon m'avaient prêté leur voiture et un cheval pour aller les chercher à la gare. Mais j'étais perplexe, car on peut arriver à Laigné par deux gares : celle d'Ampoigné, à trois kilomètres et celle de Craon à onze kilomètres, et ma mère en écrivant, avait omis de préciser. Heureusement que celui de Craon arrive un peu après celui d'Ampoigné...  Enfin, je me décide et je fais trotter la bique vers Ampoigné. J'y arrive en même temps que le train. Personne. Ils sont donc arrivés par Craon. Je fais faire demi-tour à mon cheval en vitesse, et à toute allure, je refais le chemin parcouru, car il faut repasser par Laigné, que je ne tarde pas à traverser. Ensuite en route vers Craon. Le cheval marche bien, heureusement... Enfin, du haut de la cote qui se termine à l'entrée de Craon, j'aperçois dans le fond, deux bourgeois, marchant lentement, et une petite tache à côté d'eux. Pas de doute, ce sont eux. Je fais des signaux avec les bras. Ce sont bien eux, car je les vois qui s'arrêtent et posent leurs colis à terre. Cinq minutes après, nous étions réunis. Tout le monde en voiture et hue, cocotte ! Nous arrivons à Laigné, à l'auberge Leduc, où mes parents vont loger. Je reste un moment avec eux, puis je rentre à Chassebourg. Je bouchonne le cheval, après avoir remisé la voiture, puis je retourne vers mes parents, avec qui je dois dîner. Pendant quatre jours je vais tous les soirs dîner avec eux, et je rentre vers dix heures à la ferme. Le 25, ils me quittent, car ils ont l'intention d'aller à Plélan, avant de venir avec moi, à Saint-Brieux. Le 27, je pars de Chassebourg, à destination de Plélan, où je vais les retrouver. Nous y restons jusqu'au dimanche huit heures, moment du départ pour ma ville de garnison. A quatorze heures, nous étions arrivés. Nous cherchons une chambre pour mes parents et ils optent pour l'hôtel de la promenade, à trois cents mètres de mon cantonnement. Ils posent leurs colis et nous partons dîner au Légué. Ils s'extasient sur le port, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous mangeons et revenons à Saint-Brieuc. Je rentre à mon cantonnement et mes parents à leur hôtel. Le lendemain matin, je vais au bureau de la place me faire porter rentrant, et ensuite je vais trouver le lieutenant qui commande la 25e compagnie, afin de lui demander la permission de la journée jusqu'à lundi. Elle m'est accordée, je n'aurai qu'à venir chercher mon titre tous les matins. Le lendemain, lundi, nous prenons le tortillard qui nous emmène jusqu'à la plage des Rosaires. Je prends un bain, entre deux averses, car le temps est au vilain, nous ramassons des bigorneaux, des moules et des coques, dont nous faisons notre repas. La journée du mardi se passe à visiter Saint-Brieuc. Le lendemain, je passe la visite des C3 et je suis maintenu. Puis arrive le jeudi, jour de départ de mes parents. Ils devaient d'abord partir à vingt heures vingt-une, mais le temps est tellement vilain, qu'ils s'en vont à dix heures vingt-six. Je les accompagne à la gare et ils me quittent heureux de leur voyage. Le lendemain je reprends mon service au Palais de Justice. Cela dure ainsi pendant trois jours. Puis le 6 août, au rapport, on demande trois poilus volontaires et capables, pour suivre un cours de chefs de section. Je me fais inscrire, mais il faut être apte. Deux jours après on lisait au rapport que le sergent X, du 154, et le soldat Cambounet, du 155, étaient proposés pour suivre le cours. J'étais donc accepté par la place de Saint-Brieuc. L'après-midi à la visite des C3, je soutins au major que ça allait tout à fait bien. Il me déclare apte. Nous devions partir le lendemain pour le camp de Coetquidan, où nous devions rester jusqu'au premier septembre, sans être envoyé en renfort, sans nouveaux ordres. Notre départ eut lieu le jeudi 9 août, à onze heures, et nous allons au bureau de la 29e compagnie dont nous faisons partie, maintenant. Nous donnons tous les renseignements que l'on nous demande et on nous indique notre baraque, dans laquelle nous devons loger jusqu'à nouvel ordre. Le lendemain nouvelle visite d'aptitude. Le "apte" traditionnel sort, pour les fronts français, soit pour Salonique, sort de l'auguste bouche du toubib. La journée du samedi se passe en exercice, et le dimanche, je file à Plélan, voir Madame Guénard, chez qui mes parents ont logé, lors de leur passage dans le pays. Le lendemain, je suis de garde à la prison du camp. Je reçois à ce moment, un certificat de la 33e compagnie, attestant que je suis rentrée de permission le 15 février. Je le porte au bureau en demandant mon deuxième tour de détente. Le samedi, 18 août, on me fait inscrire mon adresse à laquelle je passe ma permission et le lendemain je file. Je vais à pied jusqu'à Plélan, car j'ai prévenu Madame Guénard, de me préparer un colis d'oeufs et de poulets, que je prends au passage. J'attrape le tacot à Plélan, pour aller à Rennes, et le lendemain matin, je débarque à Paris... J'y passe dix jours heureux et je reviens à la 29e compagnie le 30 août. En allant porter mon titre de permission au bureau, je me renseigne pour le fameux cours de chefs de section. Il n'y a rien de nouveau, j'attends donc. Au rapport du 1er septembre, on parle d'un sergent du 154e : Choquet, il me semble vaguement que c'est ce nom qui a été appelé comme proposé pour le cours. Il a répondu présent et je ne le perds pas de vue. Après le rapport, je vais le trouver et lui demande si c'est lui qui a été proposé. Il me répond négativement, et ajoute que c'est le sergent Rigaut, et que ce dernier est parti, il y a trois ou quatre jours. Je saute au bureau et bondis sur le fourrier. Je lui explique ce que je viens d'apprendre. Il n'en a rien su. Nous allons voir ensemble le fourrier du 154 qui nous confirme la nouvelle et nous dit qu'il a reçu ordre de faire pour les autres, comme s'il n'y avait rien eu. Je pouvais donc faire mon deuil du cours et de l'embusquage y afférant. Le lendemain, je pars faire un tour à Plélan y voir la marraine de ma mère, déjeuner avec elle et y passer la journée. Le lendemain, surprise : à midi, le sergent de jour lit les noms de vingt cinq poilus qui partent en renfort pour le 155, plus quatre noms supplémentaires. Je ne fais pas partie de cette liste, mais deux heures après, le caporal de jour vient me dire que je pars. Je lui fais remarquer que je n'étais pas inscrit. Mais il me répond qu'il y a eu un changement dans la liste, que de plus un partant s'est fait porter malade et est remis à huitaine, et qu'un deuxième est en permission. Je pourrais rouspéter, car il y en a qui sont ici, depuis bien plus longtemps que moi, et qui restent. Mais comme la question de rester ou partir m'est parfaitement égale, je ne dis rien et fais comme les autres. Le lendemain, nous nous faisons habiller et équiper. Cela nous prend toute la journée et le mercredi 5 septembre, nous filons du camp, à midi, pour embarquer à Guer, la gare la plus proche. A six heures, nous arrivons à Rennes, où nous faisons la pause jusqu'à neuf heures. Encore un changement à Chartres, pour prendre la direction d'Orléans, Montargis, Sens, Joigny, etc... Tout en roulant, nous discutons sur les derniers évènements arrivés au 155, qui sont parvenus à notre connaissance, par des lettres écrites du régiment à des copains du dépôt A Joigny, on accroche à notre train, deux wagons de voyageurs transportant des convoyeurs américains. L'un d'eux nous explique en mauvais français qu'il y a plusieurs jours qu'ils voyagent et qu'ils n'ont plus de pain, aussi nous offre-t-il de nous acheter une boule pour trente sous. Nous lui en donnons. Puis, comme nous sommes là une bonne équipe, nous rassemblons tout ce que nous avons comme pinard et comme pain disponible et nous filons à six, vers le wagon des américains. J'ai avec moi, un caporal martiniquais, nommé Péters, qui parle anglais, et comme je connais un peu l'espagnol et l'allemand probablement que nous réussirons à nous entendre. Nous montons tous les six dans un compartiment de ces vieux wagons sans couloir, où se trouvent déjà huit américains. Nous sommes serrés là-dedans comme de pauvres voyageurs de métro. Le train se met en marche. Nous, nous entamons une conversation à bâtons rompus sur les grades et insignes des armées française et américaine. Les mots anglais, allemand, espagnols, français accompagnés de gestes multiples, s'entrecroisent dans notre tour de Babel en miniature. Tout en causant, nous séchons les bidons de pinard. Les américains ont sorti des boites de corned-beef, et cassent la croûte avec notre pain. Ensuite, ils ouvrent des boites de cigarettes et nous nous mettons à fumer dur, tout en continuant à discuter. A l'arrêt suivant, nous descendons et regagnons notre compartiment. Ensuite, il y a arrêt à Saint-Dizier, car nous devons prendre au passage, des poilus qui rejoignent le dépôt divisionnaire. Je retrouve là Chièze, un ex-copain du 164 qui était avec moi à Verdun, Wassy et Laval, et que j'avais quitté pour aller à Oëlleville. Il a été blessé le 14 juillet à Dugny, près Verdun, par un éclat de 380. Il monte dans mon compartiment afin de pouvoir causer un peu. Nous passons à la gare régulatrice de BOlogne, d'où nous sommes dirigés sur Blesmes-Haussignémont, dans la Marne. C'est là que nous descendons du train, à six heures du soir, le 7 septembre, après cinquante-quatre heures de voyage, environ. De là, nous filons à pied pour Vavray-le-Petit, à vingt kilomètres de là, lieu de stationnement momentané du dépôt divisionnaire de la 165e division. Nous y arrivons à vingt-trois heures, amusés pendant les pauses par les chants et les danses des Martiniquais qui sont avec nous. On nous colle dans le grenier d'une cagna et nous nous mettons à roupiller sans soucis du lendemain, qui est d'ailleurs un dimanche, que nous passons à rôder. Le lundi, au réveil, on nous annonce que nous sommes versés à la 8e compagnie. Nous passons au bureau, décliner nom, prénoms, grade, sans oublier la personne à prévenir en cas "d'accident". A midi, on nous rassemble et nous partons à Vavray-le-Grand, pays voisin, pour y entendre une théorie, sur un nouveau fusil, modèle 1917, à charger de cinq balles. L'après-midi se passe ainsi tranquillement. Nous rentrons au cantonnement pour la soupe. Le lendemain, les poilus appartenant, auparavant au 154, et qui étaient venus en renfort avec nous, nous quittent pour retourner à leur ancien régiment.  Puis vingt-quatre heures après vient notre tour. Nous n'aurons pas eu le temps de moisir au dépôt, puisque arrivés du 7 septembre, nous filons le 12. Nous sommes envoyés pour renforcer le premier bataillon du 155, qui se trouve à Possesse. Comme je me suis attaché quelque peu à Péters, qui est très gentil camarade, et que tous deux, nous sommes affectés à la première compagnie, je demande au sergent-major qu'il nous mette à la même section, chose qui est accordée. Nous voici donc, faisant partie de la troisième section de la première compagnie, douzième escouade, et Péters est mon caporal. Il est vrai que je ne resterai pas longtemps avec lui, car tous les créoles doivent quitter le front dès les premiers mauvais jours et aller dans le midi. J'en ferai bien autant... Une petite station sur la Cote d'Azur ou du coté de Bayonne me plairait infiniment, mais je suis de... Panam ! Chapitre premier. Retour au front. Me voici donc revenu dans une unité combattante, qui souffle pour le moment, mais ne tardera pas, sans doute, à remonter en ligne puisqu'on lui envoie des renforts. Je ne tarde d'ailleurs pas à être fixé sur ce point, car le jour même de notre arrivée, le sous-lieutenant Sénèque qui commande la compagnie, nous rassemble pour voir la binette que possèdent les nouveaux et pour nous annoncer que nous partons demain pour nous rapprocher des lignes, car nous allons occuper un secteur assez calme... si on est prudent... On me fait appeler au bureau pour m'annoncer que je suis agent de liaison. Cela ne me plait pas beaucoup, car j'en ai assez de courir comme un dératé sous les balles et les obus, d'autant plus que ça ne m'a pas très bien réussi la première fois. Enfin, puisqu'on me dit que je dois être agent de liaison, je serai agent de liaison ! Le lendemain matin, réveil à cinq heures. On prend le jus et on nous rassemble à six heures, pour nous annoncer les dispositions de départ. En rentrant dans le cantonnement, je me trouve nez à nez, avec un caporal de la section, et ce type est mon premier cabot ! Desprez, un poilu de la classe 1914, qui a été mon chef d'escouade à Verdun, Wassy et Laval, et soit dit en passant, une rosse qui avait cherché à me faire tout le mal possible (probablement parce que j'étais engagé). Je lui fais néanmoins bonne figure. On se serre la main comme deux bons copains qui se retrouvent et je file. Le rassemblement de départ a lieu à sept heures trente et nous nous dirigeons vers la sortie de Possesse, où nous attendent les camions-autos dans lesquels nous devons embarquer. Comme compagnie de tête nous avons la chance unique de défiler devant toute cette foule de véhicules, ce qui nous fait un rabiot de quinze cents mètres sur la compagnie de queue. Puis, nous roulons... Il fait un temps superbe et nous avalons de la poussière par kilos. De plus nous avons la figure et les vêtements blancs ! Encore heureux que le matin, nous ayons touché un demi-litre de picrate qui nous aide puissamment à supporter le goût sec et mauvais de cette satanée poussière. Nous traversons notamment Dieue et Sommedieue, quelque peu esquintés par les bombes d'avions. Puis nous arrivons à Génicourt, dans la Meuse, vers treize heures. Là, pas de place pour nous loger. Nous devons faire deux kilomètres pour monter dans un bois, coucher dans des baraquements au-dessus de Rupt-en-Woëvre. Nous nous mettons à faire notre soupe nous-mêmes avec les aliments que nous avons portés dans nos musettes et nos sacs, chacun sa petite part; la roulante n'étant pas près d'arriver, car elle vient au pas de ses deux vieux carcans : Caporal et Bichette (Bissette, comme dit Bonnefoy, le conducteur un gars du midi). Il n'y a pas de paillasse dans les baraques et nous devons coucher sur des treillages en fil de fer qui constituent les bas-flancs. Le lendemain, après le jus, huit heures, on m'annonce que je pars avec le sergent Rémy, chef de demi-section à la troisième, pour reconnaître le secteur que nous devons occuper. En-agent de liaison à la 21, voila mon travail à la première qui commence. Pendant que les copains vont se reposer toute la journée tranquillement, je vais baguenauder toute la journée, moi, à droite et à gauche. Je vois ça d'ici. J'aurai autant de repos qu'à la 21, c'est-à-dire pas beaucoup. A neuf heures trente le rassemblement s'opère pour tout le bataillon, à raison d'un agent de liaison et d'un sergent par section sous la haute autorité (ô combien !) du capitaine Lambert, faisant fonction de chef de bataillon. Ce monsieur qui est à cheval, semble ignorer que nous sommes à pied, et comme nous nous trouvons en plein dans les forêts de l'Argonne, devant le secteur des Eparges, nous faisons pas mal de kilomètres à filer comme des cerfs, derrière son bourrin. Je tire la langue et je sue comme pas un... Enfin, nous arrivons, ou du moins nous ne sommes pas loin du but. Voici déjà les petites cagnas des réserves. Le piston (pauvre homme !) est obligé d'abandonner son cheval, et il nous distribue entre les mains d'agents de liaison du 41e que nous devons remplacer à partir de ce soir. Pour la première compagnie, c'est un sous-lieutenant qui nous dirige. Il nous fait admirer le confort (moderne !) des sapes et des abris, le bon dispositif des tranchées avec leurs postes d'alerte, des boyaux, nous fait faire connaissance avec les dépôts d'outils et de grenades, sans oublier (naturellement !) les feuillées, et, enfin nous communique ses observations au point de vue des coins dangereux... Tout en circulant dans la tranchée de première ligne, tranchée Crausse, je remarque que le parapet sert de tombe à pas mal de poilus. Une petite pancarte rectangulaire, en tôle légère, avec trois pendrilles tricolores et gravés au couteau, ces mots : "Ici, repose un soldat français inconnu !" 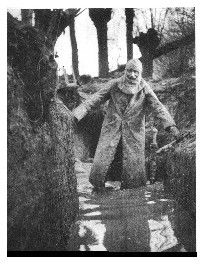 A un endroit même un pied dépasse encore. Cela pourrait servir de porte-manteau, car le bonhomme est couché sur le dos et la pointe du pied est tournée vers le ciel. Cela m'émeut un peu, mais il y en a tellement que je n'y fais bientôt plus attention. L'officier du 41 nous explique qu'il faudra prévenir les hommes de ne pas gueuler trop fort et de mettre une sourdine quand ils voudront parler de la paix... future ou de leur permission, car les boches sont à quarante-cinq mètres et dame, s'ils entendent quelque chose, malgré qu'ils sachent que nous sommes là et que ce ne serait pas une raison pour eux, de tirer, ils nous enverraient encore bien des grenades, sans se gêner. Il nous explique ensuite la circulation dans les boyaux du Portugal et des Italiens. Dans ce dernier, se trouve la sape du commandant de compagnie, en l'occurrence le sous-lieutenant Sénèque. Dans la tranchée Crausse logeront les première et deuxième sections et la sape de la troisième section se trouve à l'embranchement du boyau du Portugal et de la tranchée de première ligne. La troisième doit prendre un petit poste qui à dix mètres de l'entrée de la sape et s'avance de deux ou trois mètres, hors de la tranchée... pas plus, sans ça, il rencontrerait le petit poste boche qui s'avance beaucoup plus que le notre et dont il n'est séparé que par une dizaine de mètres. Enfin, me voici tuyauté sur tout ce qu'il importe de savoir, quand à moi, je loge avec les autres agents de liaison, dans l'escalier de la cagna du capitaine... Vers trois heures et demie, nous repartons, les trois agents de liaison et le sous-lieutenant Duret, de la première qui nous a accompagné, afin d'aller à la rencontre de la compagnie, qui doit quitter Rupt vers dix-sept heures trente. Nous laissons nos sacs et nos musettes à la cagna et nous filons. En traversant le bois, nous passons devant une coopérative appartenant à la division actuellement en ligne. Le lieutenant me donne un billet de vingt francs et me commande du pinard, du fromage, des filets de hareng et des madeleines. Quand je suis de retour, nous nous installons dans une cagna vide et à nous quatre, nous cassons la figure aux boites de harengs, au fromage et aux madeleines. Un bon coup de vin bouché, par là-dessus et nous voilà retapés... Il fait un temps de déluge lorsque nous nous remettons en route. Nous marchons quand même, naturellement, et comme nous commençons à être transpercés, nous filons vite. Nous sommes presque arrivés à Rupt, lorsque nous voyons la compagnie en déboucher. Nous nous mettons chacun avec notre section, et c'est alors un afflux de questions, auxquelles il faut répondre : "Y a-t-il une coopé ? - C'est-y loin encore ? - C'est calme ? - Y a des cagnas ? - Les boches sont loin ? - Ca chie ?" Je réponds de mon mieux à toutes ces interrogations qui se croisent et s'entre-croisent, et lorsque j'ai satisfait toute la section, nous avons déjà fait au moins quatre kilomètres. Nous sommes sous bois. Les poilus commencent à être fatigués, d'autant plus que le terrain est argileux et qu'il y a quelque chose comme boue : "Tu parles d'une mouscaille ! fait un type. - On se croirait en train de patauger dans les tinettes d'un couvent ! fait un autre" Et ainsi de suite, la marche se continue, au milieu des lazzis des loustics de la section, car malgré la fatigue, malgré le mauvais temps, la vieille grivoiserie gauloise ne perd pas ses droits... 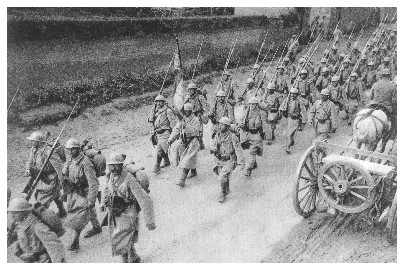 La nuit est venue et on n'y voit pas à deux mètres devant soi, tellement elle est obscure. Je m'y reconnais, néanmoins, au passage de la tranchée de Calonne (ainsi s'appelle une belle route large, qui se trouve un peu avant d'arriver aux premières cagnas des réserves). Puis, c'est devant ces dernières que nous défilons. Comme nous sommes sous les arbres et que le temps est au vilain, les poilus qui occupent ces gourbis, prennent moins de précaution avec leur lumière, que l'on voit filtrer quelque peu, sous les toiles de tente servant des portes : "Camouflez les callebombes, là-dedans ! - Eh, attention, tu vas te faire repérer !" Un ordre passe : "Que l'on fasse silence ! Faites passer ! - Que l'on fasse silence ! Faites passer !" Partie du numéro un de la colonne cette phrase arrive, passe, puis se perd à l'arrière, transmise à voix basse par chaque poilu à son suivant. Nous nous engageons dans le boyau des Italiens, à l'entrée duquel se trouvent des poilus du 41, venus pour chercher chacun une section. J'appelle à voix basse, celui qui doit conduire la section et nous continuons notre marche en avant. Je vais avec la section jusqu'à ma sape et ensuite, je reviens au P.C. du capitaine, juste pour m'entendre dire par le caporal-fourrier : "Allez donc à la troisième section, demander à l'aspirant Bardot, le compte-rendu d'installation de sa section !" Le commencement de mes petites misères. Je repars, toujours traînant mon fusil dont je n'ai pas le droit de me séparer. Au lieu de me dire de rapporter le compte-rendu en rejoignant le P.C. il vaut bien mieux que j'y retourne. C'est toujours une demi-heure de moins à me reposer. Enfin, j'arrive au P.C. de l'aspirant en suivant le boyau des Italiens, en tournant à droite dans la tranchée Crausse et en la suivant tout droit. En effet à l'endroit où se trouvait la troisième section, la tranchée tourne à angle droit vers la gauche, et forme en quelque sorte, prolongement du boyau du Portugal, qui vient aboutir là. L'entrée de la sape se trouve dans le boyau du Portugal, juste vis-à-vis de la tranchée. Je demande à l'aspirant (un récupéré de la classe 1916, dont les Eparges constituent le début au front) son compte -rendu, et je repars. Mais dans le jour, je ne me suis pas rendu compte qu'il existe un élément de boyau en demi-cercle, qui va de la tranchée Crausse au boyau du Portugal, et dont le débouché dans la tranchée se trouve à une centaine de mètres de l'entrée de la sape. Je me rappelle d'une chose, c'est qu'une fois sorti de la sape, et engagé dans la tranchée Crausse, je dois tourner dans le premier boyau à gauche. Aussi à la première entrée qui s'offre à moi, je m'y engage résolument. En peu de temps, j'arrive au bout de cet élément de boyau. Je tourne à droite me croyant dans le boyau des Italiens, et comptant trouver la sape du capitaine à cinquante mètres, mais je marche, sans voir personne. Je me sens perdu, et ne voyant comme ressource que celle de faire demi-tour, je reviens sur mes pas. Quelle n'est pas ma stupeur, lorsqu'au bout d'un instant, je me retrouve devant la sape de la troisième section. Je souffle un instant, puis j'essaye de m'orienter. Je réfléchis que je dois faire au moins cinq ou six cent mètres avant d'arriver au boyau des Italiens. Je repars et cette fois, au lieu de tourner dans le premier boyau à gauche, je continue mon chemin, dans la tranchée, sans rencontrer personne, pendant au moins cent cinquante mètres. Je pense que les boches pourraient venir comme ils voudraient entre les sentinelles de la deuxième section, où je me trouve, et celles de la troisième que je viens de quitter. Voulant m'en assurer, je me hausse au-dessus du parapet afin de voir en avant. Je ne distingue qu'un amas de fil de fer, et à soixante ou soixante-dix mètres, une ligne grise : la tranchée allemande... Je file, car il est temps que je rentre au P.C. En passant devant la sape de l'adjudant Bénard, le chef de la deuxième section, un poilu en sort, un papier à la main. Je m'arrête pour le laisser passer : "Qui est là ? demande-t-il. - Cambounet. C'est toi, Rosat ? - Oui, tu vas au P.C. ? - Oui, j'y retourne. Et toi ? - Moi aussi. Tu viens ?" Rosat est l'agent de liaison de la deuxième section. Nous rentrons donc au P.C., remettons nos bouts de papiers au fourrier, et allons à notre place, place bien minime, car il faut que je m'asseois sur une marche de l'escalier, accoté au mur et j'essaie de roupiller... C'est inutile... Il n'y a pas cinq minutes que je suis ainsi, que la voix du fourrier se fait entendre : "Agent de liaison, troisième section ! - Voilà, présent, fis-je à moitié somnolent. - Vous allez aller à votre section, dire à l'aspirant Bardot qu'il vous communique ce qui lui manque en fusées, grenades et cartouches." Ah ! il aime à faire courir sa liaison, celui-là. Il y a huit qu'il est nommé, et il me fait l'effet d'un parfait imbécile. Enfin, j'exécute l'ordre reçu et je suis vite de retour car je fais attention à mon chemin... Ma nuit se passe ainsi... Pour des communications idiotes, ou des ordres moins que pressants, il me fait cavaler du P.C. à la troisième section. Pas moyen de reposer tranquillement. Je commence à en avoir plein les jambes... Lorsqu'il fait jour, je m'envoie la trotte du P.C. de la compagnie au P.C. du bataillon, et cependant il y a un agent de liaison de la compagnie auprès du capitaine Lambert, actuel chef de bataillon, en remplacement du commandant De Bizemont, fait prisonnier à Beaumont, près Verdun, le 26 août, et dont il était le capitaine-adjudant-major... Mais probablement que cet agent zélé a les pieds nickelés, car on ne le voit pas souvent. Aussi à courir tantôt comme agent de liaison de la compagnie et tantôt, comme agent de liaison du bataillon, je finis par en avoir assez... et pendant ce temps, les poilus de la section se reposent ! ...Le secteur est relativement calme. Quelques coups de mitrailleuses à droite et à gauche, dans la nuit, quelques minenwerfer, et dans l'après-midi, nos 75 de tranchée qui font du tir indirect, dans la direction du village des Eparges, que l'on distingue parfaitement bien en ce moment, dans le fond, à notre gauche et c'est tout.  Les cuisines roulantes se trouvent, ainsi que la coopérative du régiment, sur notre gauche, dans un ravin à deux ou trois cents mètres en arrière de la première ligne. D'ailleurs, notre coin est un des plus calmes du secteur : le bombardement ne se fait guère sentir que sur les Eparges-village, à notre gauche, et sur l'Eperon, à notre droite. Quant à nous, nous nous trouvons à l'emplacement du village de Saint-Rémy. Je dis emplacement, car il n'en reste plus rien, que quelques pierres, qui ont servi à consolider les parapets rembourrés de cadavres... A dix heures et à dix-sept heures, des hommes de corvée appartenant à la compagnie de réserve nous apportent la soupe. Mais, comme ils ont pris soin de manger eux-mêmes avant de venir, c'est froid. De plus, nous ne pouvons pas manger de suite, il faut les accompagner aux sections dont ils ne connaissent pas encore l'emplacement. Je conduis ceux des deuxième et troisième sections, et en route... En arrivant, un poilu, nous apercevant, se met à brailler, à l'entrée de la sape : "A la soupe, là-dedans !" Mais ça ne fait pas l'affaire des veilleurs : "Tu vas fermer ta gueule ! Espèce de c... endimanché ! Tu veux nous faire recevoir des grenades sur la gueule !" En effet, ils ont raison... En arrivant, j'ai transmis les conseils de l'officier du 41, aux poilus, en leur disant de ne pas faire de bruit, car les boches ne sont à cet endroit, qu'à trente-cinq mètres de nous. Aussi, les veilleurs s'en souvenant, veulent-ils faire respecter les traditions ! Et ils y réussissent. Mais, nouveaux cris de la part des poilus, en voyant la soupe figée : "Ah vous vous en faites pas ! Vous avez becqueté chaud, vous autres hein ? Mais attendez qu'on soit en réserve. On se les calera d'abord, et on viendra quand on pensera à vous !" Enfin, ça se calme. Les caporaux font le service, et nous repartons. Les poilus ont bien gueulé, mais que dirais-je, moi, qui en rentrant, trouve tout gelé. Je bouffe, néanmoins les vieux fayots et la barbaque, en caoutchouc Michelin et je fume par là-dessus une bonne cigarette... et le moral s'en trouve remonté... La nuit vient vite... Au crépuscule, un compte-rendu à aller chercher, et je me figure être tranquille ensuite... Andouille, va ! Ce n'est plus assez d'être agent de liaison de la troisième section, il faut aussi que je sois aussi celui de la première, le poilu se plaignant qu'il est malade. Eh bien, moi aussi, je serai malade ! Comme cela, je me reposerai, et, qui sait, ce sera peut-être une occasion de me faire relever. Le lendemain matin, je ne rate pas le coup, je me fais inscrire, et, nanti du carnet de visite, je pars... Je me dirige d'abord vers le P.C. du bataillon, où l'on me dit que le poste de secours doit se trouver du coté des roulantes... Me voilà parti vers le ravin des roulantes. Il n'y a pas plus d'infirmerie que sur ma main, mais on me donne un tuyau. Il s'en trouverait une, à la cloche. On appelle ainsi un carrefour de pistes, où se trouve suspendue entre deux arbres la grosse cloche d'une église des environs, amenée là par qui ? comment ? on ne sait, et qui sert à alerter, en cas de gaz. Je me repère et j'y vais. Il y a là, effectivement, une cagna à croix rouge, mais je suis déçu, car ce n'est qu'un poste de relais pour les blessés. Il y a tout juste quatre brancardiers qui n'ont rien à leur disposition, sinon un jeu de cartes dont ils ont l'air d'user terriblement. J'étais déjà prêt à retourner au P.C. de la compagnie, lorsque je rencontre un infirmier du bataillon. Je lui cause, afin de me renseigner et comme il va au poste de secours, je vais avec lui. La cagna se trouve en troisième ligne, un peu à notre droite, pas même à six cent mètres, et personne ne le savait, pas même le bureau du bataillon... S'il y avait eu des blessés, ç'aurait été rigolo !... mais pas pour eux ! Enfin, je vois le major, après avoir fait une heure et demie de marche militaire, toujours avec mon fusil... J'ai idée qu'ici on doit enterrer les morts avec leurs armes, car on est sévère à ce sujet. Le major examine ma gorge, pour laquelle je me plains, et il me met exempt de service. Je m'en retourne à la cagna tout guilleret. Enfin, je vais pouvoir me reposer et faire la nique au cabot-fourrier à qui d'ailleurs on a du adjoindre un caporal, car il n'est pas capable de torcher un compte-rendu, ne pouvant arriver à écrire lisiblement. Je m'installe sur ma marche d'escalier dans mon coin et roupille tout le temps, sauf, naturellement, au moment de la soupe.  Le lendemain, je repique au truc et suis encore reconnu. Mais le lieutenant en a assez de moi, comme agent de liaison, d'autant plus que celui de la deuxième a râlé (poussé par moi) qu'il était obligé de faire son travail et le mien en même temps. Aussi vient-on m'inviter à prendre mon fourbi et à retourner dans ma section. Je dois avertir par la même occasion, l'aspirant Bardot, qu'il ait à envoyer Chièze pour me remplacer. Quant à moi, je prends une place sur un des pajots en fil de fer. Je m'installe là-dessus, et comme je suis exempt de service, je ne prends pas la garde, et peut roupiller à mon aise, surtout la nuit, alors qu'il n'y a plus personne dans la sape. Je commence à me retaper... Le lendemain de ma rentrée à ma section, je reçois une lettre de mes parents, la première depuis quinze jours. Je me fais encore porter malade deux jours, car je commence à prendre goût à ce truc de ne rien faire, et puisque je suis reconnu, pas besoin de me gêner ! Le 16 septembre, je cesse ce manège et je reprends mon service. L'aspirant m'a inscrit comme travailleur. En effet, la section, comme les deux autres, d'ailleurs, est très faible; tout le monde est dehors la nuit, partagé en deux parties : la majorité qui prend la garde, et une équipe de deux ou trois poilus, qui travaille sur le parapet à poser du barbelé, comme s'il n'y en avait pas assez comme cela ! Il y a pour chaque poilu quinze heures de garde à prendre : douze heures de nuit, de sept heures du soir à sept heures du matin, et trois heures du jour. Quant à nous qui travaillons, nous allons au dépôt de matériel, placé derrière la première section, à huit cents mètres à notre gauche, et nous rapportons des piquets en fer, des bobines de fil de fer barbelé, des sacs à terre... etc... Ensuite, on grimpe sur le parapet, en faisant le moins de bruit possible, et on poste tout cela comme on peut. C'est d'autant plus embêtant, que, par intervalles, dans la nuit, les boches tirent quelques coups de mitrailleuses, probablement pour montrer qu'ils ne dorment pas. Aujourd'hui, j'ai perdu mon copain Péters, le caporal martiniquais et l'aspirant Bardot, partis tous deux en permission. Je regrette Péters, car c'était un bon camarade, mais quant à Bardot, je trouve que nous sommes bien débarrassés, car bien qu'il ait trois ans de plus que moi, il est beaucoup plus gamin et s'y connaît encore moins que moi, au point de vue front. Je n'y connais pourtant pas grand chose ! Comme l'autre nuit, par exemple, étant sur le parapet, il voulait allumer sa lampe électrique de poche, pour lire un ordre, ou encore, une idée qui le prenant de temps à autres d'aller poisser un fusil-mitrailleur ou une mitrailleuse de chez nous, pour prouver qu'il y avait des sentinelles qui dormaient. Non, il a bien fait de partir ! et qu'il ne revienne plus, malgré qu'au point de vue caractère ce soit un charmant garçon, ce n'est pas un conducteur d'hommes ! Il est vrai que ça viendra un jour ! ...La nuit suivante, je fais avec quelques camarades, une corvée de fils de fer, et ensuite, je m'installe pour le restant de la nuit au petit poste pour monter la garde... Je suis gelé... Nous sommes deux pour prendre la garde. Pendant qu'il y en a un qui veille attentivement, l'autre s'enroule dans sa couverture et essaye de dormir. Mais l'humidité transperce tout : couverture, toile de tente, capote et au bout de cinq minutes, on en a assez, c'est intenable. On se met debout et on saute sur place, en s'intéressant aux lueurs des fusées ou aux traînées que font dans le ciel, les minenwerfer dont on entend le terrible craquement, quelques secondes plus tard. Au petit jour, vers sept heures, nous pouvons rentrer dans la cagna. Nous sommes au 21 septembre, un vendredi. J'ai mal à la gorge, pour de bon, cette fois. Je vais à la visite. Le major n'est pas là, il est parti déjeuner avec le colonel, c'est le caporal-infirmier qui me met exempt de service et me dit de revenir le lendemain. Je passe mon après-midi dans la tranchée, car il fait un temps splendide... Je suis en train d'écrire, lorsque, brutalement, zin... zin... zin... zin... quatre obus passent en rasant le parapet. Instinctivement, je baisse la tête, et cependant ce sont des nôtres : les 75 de tranchée qui vont envoyer une rafale sur les Eparges. Mais ils sont derrière nous à quatre-vingt mètres et les obus passent avant qu'on ait entendu les coups de départ. Il passe ainsi une douzaine d'obus et ça se calme. Les boches ne répondent pas... pas sur nous, du moins. Car il y a quelques jours, mes voisins de droite, de la troisième compagnie se sont crus bien malins, en jetant des grenades dans le petit poste boche, qu'ils ont d'ailleurs manqué, et les Fritz pour se rattraper, leur envoient chaque soir, une décoction de minenwerfer et de grenades à fusil. Leur position est devenue un enfer. Nous, au contraire, nous tenons bien sages, n'embêtant pas les Frigolins qui nous font face, mais prêts à riposter si ce sont eux qui commencent les premiers.  Mais je ne crois pas qu'ils aient cette velléité, car à l'aide des microphones nous avons appris que les boches d'en face, appartiennent au 168 d'infanterie, régiment qui s'est trouvé devant le 155 à Beaumont, le 26 août. Ils sont venus ici, comme nous d'ailleurs pour se refaire la cerise. ...Le soir, minute d'émotion. A part un grenadier par section, tout le monde reste dans les cagnas, car les français doivent faire sauter une mine sur notre gauche, et on craint le tir de représailles boche. Mais à neuf heures un quart, un agent de liaison arrive, afin de faire remonter tout le monde, car le lieutenant Sénèque n'ayant rien entendu, pense que l'explosion de la mine est retardée et que, en conséquence, nous n'avons rien à craindre. Moi, je m'en fiche, je reste dans la cagna à me reposer et à allumer, de temps à autre, une bougie à l'aide de mon briquet, afin d'éclairer un poilu, qui vient furtivement, faire une cigarette qu'il allumera et fumera ensuite dans ses mains, en se cachant dans le fond de la tranchée. Heureusement que j'ai ma provision d'essence pour mon briquet, car il n'y a plus moyen de trouver d'allumettes et le tabac se fait rare. Mais de même que j'ai ma provision d'essence, je possède une réserve de tabac et j'ai pas mal de cigarettes à fumer. Le lendemain, samedi, je retourne à la visite, espérant revoir le caporal comme toubib... Mais, barca. Le major était là, et probablement avait-il assez vu ma cafetière, car il me mit consultation motivée, c'est-à-dire que j'avais bien fait de me déranger, mais que je n'étais pas assez malade pour me mettre exempt de service. J'ai donc passé mon après-midi à travailler. Armé d'une pelle, j'ai nettoyé le boyau du Portugal, puis fatigué d'un tel effort, je m'en fus me coucher jusqu'à la soupe du soir... Dans la nuit, nous sommes allés à deux dans la tranchée Crausse, creuser le fond, mettre la terre dans des sacs et surélever le parapet, car à cet endroit il fallait se baisser pour passer et c'était dangereux. Un minen de 240 était tombé là, et avait creusé un entonnoir, faisant du même coup, écrouler le parapet. A une heure du matin, notre travail était fini et nous pouvions rentrer dans la sape, nous coucher. Au jour, à sept heures, nous remontons tous deux et on nous colle à faire une chicane à coté de la porte de la cagna. En faisant ce travail, nous mettons à jour l'entrée d'une sape qui est éboulée. Ce que ça tape ! Il doit y avoir des macchabés, car ça pue rudement. Mais ça n'a pas d'importance et nous travaillons ainsi jusqu'à dix heures. La nuit suivante, changement dans le travail. Nous grimpons sur le parapet. Entre la première et la deuxième ligne, se trouve un gros entonnoir de torpille. Il faut le remplir de fil de fer barbelé de manière que personne ne puisse s'y mettre. Une idée comme une autre ! Mais après tout faire ça ou peigner la girafe du Jardin des Plantes ! Seulement c'est un ouvrage qui ne va pas tout seul, ni sans bruit, car nous faisons vite. Aussi les fusées éclairantes boches se mettent-elles de la partie, en même temps que les mitrailleuses tirent. Mais on les em...de au fond de notre trou ! Les balles sifflent au-dessus de nos têtes. Entre deux tirs, nous déroulons quelques mètres de fil, quand ça reprend nous nous baissons au fond du trou, et ainsi de suite. Brusquement, nous entendons un frt... frt... frt... comme le vol lourd d'un oiseau de nuit : c'est une bombe à ailettes qui descend. Nous n'avons que le temps de nous baisser. Un craquement formidable à droite et les éclats qui sifflent en passant. Nous en jetons un coup pour être vite débarrassés, car nous avons peur que le coin empire tout à l'heure. Nous suivons maintenant la descente des bombes à nénettes, et nous voyons que ce n'est pas pour nous. Mais ce sont les balles de mitrailleuses et les éclats qui nous gênent. Enfin, notre travail va être fini : nous avions laissé un coin sans fil de fer. Nous la dévidons à toute allure; peu importe si nous faisons du bruit, il s'agit d'en mettre un coup. En moins de deux, le rouleau est achevé, nous parcourons la dizaine de mètres qui nous séparent de la tranchée en deux bonds et nous rendons compte que le travail est fini. L'autorisation nous est donnée d'aller nous coucher, autorisation dont nous profitons immédiatement. Dans la matinée, nous nous mettons à la construction d'une chicane dans la tranchée Ganne, soutien de la première ligne, dont elle est distante d'une trentaine de mètres. Nous exécutions dans ce secteur des travaux qui ne serviront jamais à rien, car les défenses accessoires en avant de la première ligne sont telles que le boches n'attaqueront jamais, et de plus de la manière dont disposons ces travaux, il n'y aura jamais moyen de s'en servir. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien faire ? On nous dit de faire une chicane, nous faisons une chicane... On nous dirait de monter sur le parapet en plein jour, pour faire nos ordures, nous y monterions ! Nous abattons un peu du parapet et avec la terre tombée, nous remplissons des sacs à terre, qui, placés d'une certaine manière nous donne notre chicane désirée. A dix heures, nous interrompons notre travail qui est repris ensuite par la deuxième équipe. Je me repose l'après-midi, et à sept heures, je grimpe sur la banquette de tir, pour m'envoyer la garde, car il y a un départ de permissionnaires, dont un poilu de ma section, et je suis obligé de le remplacer comme gardien au poste de fusil-mitrailleur. Douze, bien longues heures à passer là ! Mais enfin ça se tire, en contemplant les fils de fer et les rats qui y passent, gros comme des lapins. La nuit est bien fraîche, on grelotte. Il faut danser sur place si on ne veut pas avoir trop froid. Dans la journée, je croyais prendre trois heures de garde, comme les copains, mais le sergent Rémy, qui commande actuellement la section a changé le dispositif et il y a du rabiot de bonshommes pour le service de jour. Le soir, à vingt-deux heures, je fais partie d'une équipe qui doit faire une patrouille. Je me voyais déjà en train de traverser le barbelé à quarante mètres des boches, mais nous avons râlé : "On va se faire sonner le cul ! - Faut être fou pour faire faire une patrouille ici ! - C'est bien des coups à la Sénèque. Bougre de c.., va !" Mais nous avions affaire à un sergent qui ne tenait pas plus que nous à servir de façon aussi ostensible, de cible aux boches, et notre patrouille se fait dans la tranchée Crausse; une ballade d'une demi-heure et nous nous séparons... Quant à moi, je vais reprendre la garde au poste de F.M. jusqu'au jour. Le lendemain, comme je trouve que je me suis bien embêté, cette nuit, je vais voir le major. C'est un nouveau. Il me reconnaît exempt de service pour la journée et me donne du chlorate de potasse après m'avoir enduit la gorge d'une couche de teinture d'iode. Je passe ainsi une nuit tranquille. Nous commençons à songer à la relève. Voici déjà treize jours que nous sommes en première ligne et on ne parle pas de nous envoyer en réserve. Il y a quatre jours la troisième compagnie, à notre droite, a été relevée par la deuxième. Quant à nous toujours rien. Je retourne voir le major, le lendemain. Il me reconnaît, encore une fois exempt de service. Dans l'après-midi, alerte comme celle de l'autre soir : on descend tous dans la sape, car on craint un bombardement qui ne vient, d'ailleurs pas; mais parait-il que le préposé au microphone a entendu une conversation entre boches, où il en était question, et on nous fait prendre nos précautions. Mais rien ne se passe et on reprend le service normal au bout d'un instant... Maintenant, j'ai pris l'habitude de passer ma nuit tranquille et tant que le major me reconnaîtra j'irai le voir. Ce que je ne manque pas, d'ailleurs de faire le lendemain matin... Je ne sais ce qu'il croit me trouver, mais il me dit d'uriner demain matin dans une bouteille et de la lui apporter en venant à la visite. Donc toujours pas de service à fournir. Néanmoins à midi, je vais prendre la garde, volontairement, une demi-heure afin de permettre au poilu qui y est en ce moment, d'aller manger tranquillement. Le temps est superbe, il fait un beau soleil au milieu d'un ciel bleu. Nous voyons les taubes évoluer au-dessus de nous et les oiseaux gazouillent... ! Les oiseaux, parfaitement ! Indifférents aux coups de canon qui tapent de temps en temps, ils sortent du bois et viennent se poser sur les branches déchiquetées des arbres, placés entre les lignes... Le lendemain, je retourne à la visite, muni de mon urine. Je me demande ce qu'il en résultera. Je me vois déjà empli d'albumine et filant à l'hôpital ! Mais je ne connaîtrai le résultat de l'analyse que demain matin. Ainsi donc c'est une habitude prise d'aller voir le toubib tous les matins, et grâce à cette question d'urine, il faudra que j'y retourne demain matin, même si je n'en avais pas eu l'intention... Ma journée se passer dans la confection d'un briquet. Le soir, nous apprenons que le 267e régiment d'infanterie est dissous et que nous en recevons un renfort qui arrive d'ailleurs avec la soupe. La compagnie se reforme alors à quatre sections, puisqu'il y a maintenant suffisamment de poilus pour le faire. Quant à moi, je reste à la troisième. Il est vrai que pour ce que je fais, être là ou ailleurs, peu importe. Enfin, je conserve mon coin. Nous avons maintenant pour nous commander l'adjudant Bénard, les sergents Rémy et Gonnord, le caporal Garnier, cousin du précédent et un nouveau caporal venu du 267. Voici donc la section au complet. De plus, nous avons un nouveau commandant de compagnie : le lieutenant Troutot. Demain, c'est dimanche, mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Dimanche ou jour de semaine, pour nous, c'est la même chose. A la visite, déception. L'analyse de l'urine n'est pas encore faite. Je reviendrai demain afin de la connaître. Au poste de secours j'apprends un bruit de relève pour la compagnie. Ce serait pour demain... Effectivement, le lundi soir, à cinq heures, un agent de liaison apporte l'ordre officiel que l'on est relevé dans la nuit par la troisième compagnie et que l'on va prendre sa place en réserve. Nous montons nos sacs en vitesse, comme on peut, dans le fond de la cagna... La compagnie de relève arrive vers vingt heures et accapare nos places en première ligne et dans les sapes sans que nous en soyons fâchés, car nous finissions par en avoir assez, même moi, que ne faisais rien !  Depuis dix-huit jours (du 14 septembre au 1er octobre) nous ne pouvions pas aller et venir tranquillement, nous ne pouvions pas parler, ça devenait barbant ! Enfin, sitôt les consignes passées, nous filons au grand trot vers l'arrière. Nous suivons le boyau des Italiens un bon bout de chemin, jusque dans le bois, puis nous le quittons en montant sur le parapet par un petit escalier de quatre ou cinq marches. En peu de temps, nous arrivons aux cagnas que nous devons occuper. Je m'installe dans une petit guitoune où il y a six lits. Nous ne sommes que trois, mais ça ne fait rien nous serons plus tranquilles. Nous bouchons l'entrée et nous examinons le trou où nous sommes... Il y a une cheminée, ce qui est très chic, nous pourrons faire du feu... Si ça ne fait pas trop de fumée. Enfin de ça, on s'arrangera toujours. Nous sommes en plein dans le bois, et ces grands arbres nous servent de camouflage, mais d'un autre coté, nous ne somme qu'à huit cent mètres des premières lignes. Quand à la couverture de la cagna, il ne faudrait pas qu'il tombe une fusée éclairante dessus : elle serait traversée ! Mais ça, importe peu : le secteur est calme. Nous entendons dans la nuit passer les taubes qui vont bombarder l'arrière, mais nous respectent, nous. Au jour, je vais voir le toubib qui me rend compte qu'il n'y avait rien dans mon urine. Il m'ausculte, me palpe, puis veut m'envoyer à l'arrière au train de combat, mais réfléchissant que nous sommes en réserve et après m'avoir demandé si je suis bien dans ma cagna, il me colle trois jours exempt de service, couché. Rien que ça de luxe : trois jours à faire ce qu'il me plait, rester couché, tant que je voudrais ! Quel bonheur ! En rentrant de la visite, je vois Péters qui revient de permission. Il a été chez mes parents qui lui ont remis un colis de tabac pour moi. Il a été déjeuner chez nous, et parait avoir été heureux de sa visite. De cette manière, j'ai des nouvelles encore plus fraîches que par lettre. ...Pendant quelques jours, je continue à aller voir le major. A la fin de mes trois jours, il m'en a redonné deux autres de même nature : c'est le bon fricot ! Le lendemain matin, je vais à la visite du Médecin-chef qui me prescrit les mêmes soins que le toubib et me maintient exempt de service. La compagnie fait des corvées de soupe et de jus en ligne, et moi, je me repose. J'en suis d'autant plus heureux qu'il fait un temps affreux, de l'orage et de la pluie en quantité et que les boyaux sont pleins de boue. On y enfonce plus haut que la cheville. Les poilus en rentrant, rouscaillent tout ce qu'ils savent ! Ce soir, 7 octobre, Péters me quitte pour une seconde permission de sept jours, car il était en retard et a repris sa place normale. Je lui donne, naturellement, une lettre pour mes parents, puisqu'il va les voir... A la tombée de la nuit, nous étions occupés à jouer aux cartes près du feu, lorsqu'on entend une voix venant de l'extérieur : "Eh, les amis, c'est la première ici ? - Oui, mon vieux. Tu cherches quelqu'un ? - Je rentre de permission. Je suis du 267 et je viens à la première. - Entre, mon vieux ! faisons-nous. Il y aura une place pour toi, ici !" Nous voyons alors apparaître un vieux bonhomme (il est de la classe 1898) à barbe grise, l'air bien doux. Il s'appelle Tual. Il nous raconte qu'il vient de Bretagne où il a passé sa permission. En rentrant à la compagnie, il s'est arrêté chez le sergent-major et s'est fait donner un bon pour dix litres de vin, bon qui est nécessaire pour avoir du pinard à la coopérative. Il nous donne le bon et nous nous cotisons à nous quatre, pour acheter les dix litres, que nous boirons bien. Le lendemain, un de nous dégotte un grand baquet de fer-blanc. Nous y adaptons une anse faite avec un fil de fer et ils filent à deux à la coopérative, chercher le pinard... Quand ils reviennent nous buvons à la santé de l'ancien qui est nouveau, et à notre santé également, car il ne faut pas s'oublier soi-même. Trois jours s'écoulent ainsi, tranquilles, je dirai même heureux dans notre cagna, où à nous quatre nous nous entendons très bien... Enfin, le 10 octobre, à midi, on nous rassemble, pour le rapport afin de nous annoncer qu'on est relevés le soir même et qu'on ira à Rattentout finir la nuit, que nous embarquerions le lendemain matin en camions pour aller à Taillancourt, un pays meusien situé sur la frontière de la Meurthe-et-Moselle.  Le soir, à la tombée de la nuit, un sergent me demande si je veux aller pour la section, chercher les poilus du 48, qui doivent nous relever. Il m'explique que tout le monde est occupé, que ça évitera à un poilu fatigué la peine d'y aller... Enfin, je me rends à ses bonnes raisons, malgré que, étant exempt de service je sois libre de ne rien faire... Je file avec trois autres poilus, mais pour le retour, ça ne va pas tout seul, on a un chiendent infini à retrouver son chemin. Il fait une nuit très obscure... Nous y arrivons néanmoins. Les gradés passent les consignes, ce qui est vite fait, et nous voilà partis... Nous arrivons à Rattentout au milieu de la nuit et nous y reposons jusqu'au matin. Le jeudi, 11 octobre, à huit heures du matin, nous embarquons dans les camions qui roulent tranquillement vers l'arrière. Vers treize heures, ils s'arrêtent; on nous fait descendre et monter ensuite dans des autobus (genre Mavieille-Pastille, comme dit un poilu). A six heures, nous débarquons à l'entrée de Taillancourt-Montbras, le pays où nous devons loger... En attendant les fourriers qui sont partis reconnaître et préparer le cantonnement, nous formons les faisceaux dans un champ, en dehors de la route. Au bout d'une grande heure ils se ramènent et nous allons nous installer... La section n'est pas trop mal : dans une espèce de petite chambre, dans un grenier. Mais il faut y monter par une échelle sans rampe et il y a de quoi se casser la figure la nuit surtout... Mais ça ne fait rien, on en sera quitte pour y faire attention. Nous collons nos affaires dans un coin, démontons notre sac, et on s'endort bien tranquillement, après s'être enveloppés dans nos couvertures... Pendant trois jours on n'a pas grand'chose à faire : nettoyage des armes et du cantonnement et c'est tout. Le troisième jour que nous étions là, le 14 octobre, j'étais seul en train d'écrire, lorsqu'un poilu, Jobin, qui était saoul, rentre comme il peut dans la chambre et s'allonge sur la paille. Puis il s'asseoit sur son séant, et se met à jargonner, qu'il en a marre, que ça le fait chier, puis il se met debout et sort son couteau... Je me demande ce qu'il veut faire, et je me lève aussi, prêt à intervenir : "Ils me font tous chier. J'en ai marre et je vais m'en foutre un coup. - Tu es fou, ne fais pas cette bêtise-là. - Toi, ne m'emmerde pas. Laisse-moi tranquille. Je veux m'en foutre un coup !" Cela commence à m'embêter, d'autant plus qu'il a un fameux couteau à cran d'arrêt. Le pire, c'est qu'il veut passer des paroles aux actes. Il étend le bras... Je me jette sur lui et comme il est pas mal saoul, je le flanque par terre, et, en le tenant, je réussis à lui enlever son couteau... Je m'asseois ensuite près de lui et je tâche de le ramener à la raison. Je lui parle de sa famille, de sa mère tout au moins, car je sais que son père est mort... Je n'ai qu'une peur : c'est qu'il n'ait l'idée de prendre son revolver derrière lui. Il est vrai que je le surveille et que je serai arrivé à l'arme avant lui... Enfin, bercé par mes paroles, il s'endort... Ouf ! Je suis enfin tranquille ! D'ailleurs, les copains ne vont pas tarder à rentrer. Il est vrai qu'il y en a la moitié qui sont aussi saouls que Jobin lui-même et par conséquent, bien incapables de me donner un coup de main. Je raconte ça à un poilu qui couche à coté de moi et qui est copain avec Jobin. Il me promet de le surveiller et je m'endors. Le lendemain matin, je vais au jus et je rapporte la capote du sergent Gonnord, que j'avais trouvée au beau milieu de la route. Il ne tenait rien non plus hier soir !  En bas de l'échelle, il y a quelque chose comme saletés à nettoyer. On voit qu'on descend des lignes. Privés pendant quelques jours ils se rattrapent ! Le 15 octobre, au matin, on nous annonce qu'il faut monter les sacs : nous sommes détachés, toute la compagnie, à Maxey-sur-Vaise, à trois kilomètres de Taillancourt, auprès de l'état-major de la division et du général Caron. Nous sommes compagnie d'honneur. Rien que ça de luxe ! Le lendemain à huit heures je suis de garde. Le poste de police se trouve dans une maison dont le grenier est semblable à celui de Taillancourt. On prend la garde pendant vingt-quatre heures, et le lendemain matin, 17 octobre, on est relevés à huit heures. L'après-midi, nous allons à l'exercice. Je marche avec les grenadiers. Nous montons sur le plateau, au-dessus du pays et nous formons des jeux, qui nous font passer l'après-midi assez rapidement... Je reçois le lendemain des nouvelles de Paris, de Péters. Je ne le reverrais pas car il a rejoint directement, la 27e compagnie au grand dépôt, à Saint-Brieuc, afin de partir dans le midi, passer l'hiver... Et en lisant cette lettre, je ne puis m'empêcher de songer que ça va être le quatrième hiver que nous sommes en guerre, et que ça fait rudement longtemps, surtout pour ceux qui y sont depuis le 3 août 1914... Enfin, en moi-même j'espère que ce sera le dernier et que, dans un sens ou dans un autre nous aurons une décision... ...Je ne suis d'ailleurs pas le seul de cet avis, c'est celui de tous les poilus du front. A l'arrière, on s'en fout... on en a pris l'habitude ! Chaque matin ils voient le communiqué, le commentent par des : ça marche, ou des : ça ne va pas, mais ils ne se rendent pas compte, les civils, ce que ces simples mots cachent de misères, de souffrances, de morts et de blessés... Seuls, ceux qui ont entendu siffler les balles et les 88, par-devant, les 75 par-derrière, les gros en haut... ceux-là seuls, pourraient le dire, mais ils sont soldats et n'ont que le droit de se taire... !  ...Je vais voir le major, histoire de me reposer un jour ou deux. Le deuxième jour, le major inscrit sur le carnet de visite, en face de mon nom : consultation non motivée, et, d'autre part, il m'envoie à la visite du médecin-chef pour le lendemain, et il parle de me faire analyser mon urine. Ma parole, il doit être fou ! Le lieutenant Sénèque qui commande la compagnie, en l'absence du lieutenant Troutot, permissionnaire, me fait appeler et me demande si je suis malade. Je lui raconte la visite. Il m'écoute puis me renvoie, en me disant qu'il prendra une décision après la visite de médecin-chef... Si, jamais ce dernier ne me reconnaît pas, je peux préparer mon matricule ! Mais à la visite, tout se passe bien. Le médecin me reconnaît une laryngite et me prescrit quelques médicaments. Je suis donc tranquille, il n'y aura rien. Le 24 octobre, un mercredi, nous sommes de parade, pour la dégradation d'un poilu du 155e puni de trois ans de prison avec dégradation militaire. Je fais partie du piquet de quatre hommes, qui baïonnette au canon, encadre le prisonnier pendant l'exécution. Le type ne s'en fait pas une miette. Il a l'air parfaitement heureux de son sort et tremble, certainement moins que le sergent qui, armé d'un couteau, lui coupe ses boutons et ses écussons. La cérémonie finie, nous passons devant les poilus, puis sortant du carré, nous remettons le bonhomme aux gendarmes qui vont l'emmener à la tôle... Le lendemain, je suis, avec une demi-douzaine d'autres poilus de garde au conseil de guerre. J'ai ainsi l'occasion de voir, d'abord l'installation d'un tribunal militaire, chose que je n'avais jamais vue, et ensuite d'entendre la défense et la plaidoirie des avocats. Les premières affaires sont simples : désertions à l'intérieur en temps de guerre. Les accusés sont punis de peines, variant de trois mois de prison à sept ans de travaux publics, avec ou sans dégradation, puis vient l'affaire la plus intéressante. A Verdun, au début de septembre, le 267 était en ligne. Ils venaient de s'appuyer quatorze jours de tranchée et avaient été relevés depuis vingt-quatre heures, lorsqu'ils reçoivent l'ordre de remonter. Rouspétance, râles, refus de marcher, plus ou moins caractérisés. Il y a discussion. Quelques-uns des prévenus prétendent n'avoir rien dit. Tous se plaignent du capitaine. C'est très obscur comme affaire... Enfin, à huit heures du soir, les juges se mettent à délibérer et une grande demi-heure après, nous rentrons dans la salle pour entendre le président, donner lecture aux réponses faites aux quarante-huit questions posées. A l'unanimité, le caporal est acquitté. Il a l'air d'être heureux. Un poilu est condamné à mort, ça n'a pas l'air de lui faire grand chose, un autre à vingt ans de travaux forcés, et les cinq autres chacun à cinq ans, tous avec dégradation. Le conseil suspend son audience à neuf heure du soir. Nous allons à la prévoté, présenter les armes à la lecture de la peine infligée à chaque accusé, puis nous nous retirons. Nous n'avons pas mangé depuis midi et lorsque nous rentrons, tout est froid. On va voir le sergent-major afin d'avoir quelque chose à manger. Il nous fait l'aumône d'un camembert que nous avalons en vitesse, et nous nous couchons... ...Le lendemain soir, nous recevons un renfort de récupérés des classes 1913 à 1917. Il y en a une trentaine pour la compagnie. Moi, qui déjà étais heureux, car j'étais dans premiers à partir en perme, je me vois remis à une date ultérieure. Il y en a là-dedans qui n'ont pas profité de leur tour depuis trois ou quatre mois et qui vont me griller sûrement. Mais au moment où il était décidé que les nouveaux arrivés prendraient leur tour normal dans la compagnie, le cabot-fourrier retrouve une circulaire, disant que les poilus venant du C.I.D. ou du bataillon de marche devaient prendre place à la gauche de la compagnie. Aussi, le 27 octobre à midi, je donnais mon adresse, et le surlendemain 29, je partais à quatre heures quarante-deux de Maxey-sur-Vaise, à destination de Neufchâteau, Gondrecourt, Vaire-Torcy et Paris, où j'allais passer douze bonnes journées sans souci de la roulante, ni des corvées, ni du retour, qui, pourtant, devait arriver relativement vite. En Lorraine, l'hiver. Le 15 novembre, je quitte Paris, après douze jours de permission. Je dois rejoindre la gare de Frouard, où l'on m'indiquera l'endroit exact où se tient mon bataillon. Lorsque j'y arrive, on m'envoie à Pompey, le patelin voisin, à douze cent mètres de là. Le régiment s'y trouve depuis le premier novembre, transporté en camions-autos. Je m'installe et je visite le pays. Il y a une usine de guerre qui fabrique les obus, des plaques de blindage, des rails de chemins de fer. C'est la première fois qu'il m'est donné de visiter pareil spectacle, aussi je m'y intéresse. D'ailleurs, il y a repos le 17, car le régiment vient d'obtenir la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre, et le lendemain 18, qui est un dimanche, nous avons également journée libre. Le lundi, je vais avec une dizaine de poilus collaborer à la construction d'une sape, destinée à abriter les poilus qui s'occupent du projecteur contre avions, se trouvant à proximité de l'usine. On ne se la foule pas de manière à ne pas se fatiguer et nous rentrons pour la soupe du soir. En rentrant de permission, je n'ai pas trouvé de place dans le cantonnement, et j'ai dû suivre l'exemple de deux poilus, revenus la veille : aller loger dans la cave. On y est aussi bien qu'en haut, et je dirais même mieux, car les civils y ont descendu des lits et des sommiers et sauf l'absence de matelas et de draps on pourrait se croire dans le civil. Le soir et le matin, aucun bruit ne vient nous déranger et on peut dormir tranquilles... Le lendemain matin, je vais à la visite pour me faire piquer contre la variole. Toute la compagnie y passe. Les jours s'écoulent tranquillement. Le jeudi, je prends la garde à l'usine. Pas grand'chose comme service. Nul besoin d'armes. On se tient à la porte d'entrée des ouvriers et on empêche les étrangers d'entrer... Lorsqu'on n'est pas à la porte, on va dans l'usine se promener et admirer le convertisseur Boessmer, dont la flamme éclaire toute la ville, les tracteurs transporteurs de rails, les wagonnets chargés du métal en fusion, les fours actifs, et enfin toutes les parties qui composent une usine en pleine activité. Le lendemain matin, on est relevés et on rentre au cantonnement, heureux d'être débarrassés d'une corvée qui, quoique n'étant pas bien désagréable, n'en reste pas moins une corvée. Ayant vu pendant mes heures de garde des poilus qui travaillaient à l'usine, je me renseigne, car je voudrais en faire autant et l'argent gagné me servirait pour mon tabac et pour améliorer sensiblement l'ordinaire. Les noms des poilus ont été pris au bureau et ils y vont par ordre. D'ailleurs ils ne doivent plus en inscrire d'autres. Tant pis, l'occasion est perdue. Le soir, après la soupe, je vais le promener mélancoliquement vers l'usine toujours en pleine activité et quelle n'est pas ma stupéfaction en voyant des poilus y entrer. Ma foi, je fais comme eux. Ils se dirigent vers une cabane qui se trouve à cinquante mètres de la porte d'entrée et où se tient un surveillant. J'écoute ce qui se dit. Ils viennent travailler. Si je peux être pris, je vais faire comme eux, ça ne me fait rien. Le matin, on ne va nulle part, et dans notre cave nous ne sommes embêtés par personne : on peut dormir tranquille, aussi tard que l'on veut. Le contremaître nous envoie, après avoir pris nos noms, dans une grande cabane, au centre de laquelle chauffe un grand braséro plein de coke. On y reste une heure à fumer et à causer, puis il revient nous chercher. Nous le suivons. Il nous fait prendre des pelles en passant, puis nous emmène vers quelques wagons remplis de minerai, qu'il s'agit de vider. Nous nous mettons à la besogne. A onze heures, nous avons fini et nous partons. Le lendemain soir, samedi, c'est jour de pays. Je fais comme les autres et passe à la caisse. Je reçois sept francs quatre-vingts pour un travail de deux heures et demie environ, mais la chose est facile à comprendre. Le travail de nuit se paye un franc trente de l'heure et contremaître nous a inscrit comme si nous avions travaillé de six heures à minuit... Je ne m'en plains pas, au contraire. Pendant deux ou trois jours, je retourne ainsi travailler, puis le bruit court que nous allons monter en ligne. Le départ est fixé au mercredi 28 novembre. La veille au soir, je passe à l'usine me faire régler. Au réveil, nous commençons nos préparatifs de départ. Nous montons nos sacs que nous devons porter de suite au bureau, car nous avons des fourragères d'artillerie qui vont nous les porter un bon bout de chemin. A dix heures, on nous distribue la soupe et à onze heures, départ. Nous montons dans le secteur du Grand Couronné de Nancy, à gauche de Nomény, station terminus du chemin de fer français et ville-frontière avant 1914.  Nous marchons d'abord en colonne par quatre, en discutant de choses et d'autres. Les roulantes suivent. A seize heures, arrêt général. Nous faisons la grand'halte. Les artilleurs nous restituent nos sacs et se sauvent. Nous mangeons en vitesse, et deux heures plus tard, la nuit déjà tombée, nous arrivons à Clémery, où nous devons prendre position. Le secteur est d'un calme absolu. Ne serait-ce les barbelés on se croirait faisant une excursion de nuit à Laval ou à Saint-Brieuc ! Les officiers étaient venus à cheval, faire un tour, la veille, et reconnaître le dispositif. Chaque chef de section connaissait l'emplacement de combat de ses hommes. Aussi, en arrivant à Clémery, il n'y a pas d'hésitation. Nous, nous logeons au presbytère. Nous y entrons pendant que les poilus du 154 que nous relevons mettent sac au dos. Nous causons. Ils nous expliquent que les boches sont au moins à quinze cent mètres, que le secteur est un vrai filon, un vrai repos, et qu'il n'y a que la garde et quelques petites patrouilles à fournir... et ils filent. Je suis désigné illico, avec cinq autres poilus pour aller au petit poste du bois Carré, relever les sentinelles du 154. Nous partons accompagnés du sergent Gonnord, et à six cents mètres du presbytère, en suivant un boyau, nous arrivons au petit poste... Le bois Carré est un boqueteau de cinquante mètres de coté, dans lequel se trouvent une demi-douzaine de cabanons en planches. C'est dans l'un de ceux-ci que le petit poste est installé. Nous entrons. Il y a quatre poilus et un gradé, assis autour du feu, ainsi qu'un gros cabot, genre de chien de berger. Les poilus, en nous voyant arriver se lèvent, sauf un, qui, ainsi qu'il se charge de nous l'apprendre, est gardien du cabot et n'a que lui à s'occuper. Tout à fait à la lisière du bois est creusé un boyau, muni de tout le confort moderne : emplacement pour fusil-mitrailleur, et grenadiers. Le fond est recouvert de caillebotis, qui sont d'ailleurs bien utiles, car surélevés, comme ils le sont, ils nous permettent de ne pas marcher dans l'eau et il y en a bien une trentaine de centimètres dans le fond. A gauche du bois est une sorte de petite guérite, et sur le parapet de la tranchée, appuyée à un arbre, face aux boches, il y en a une autre plus large, pouvant tenir deux poilus. Sous la banquette de chaque guérite, il y a une demi-douzaine de grenades, prêtes à être envoyées. Et d'ailleurs, que pourrait-on craindre ? (d'après les types du 154, naturellement, car nous, nous ne connaissons pas encore le secteur.) Les boches sont loin : quinze cents mètres, on n'a donc pas à craindre les fusils et certainement ils doivent aimer leur tranquillité, tout autant que nous aimons la notre. Je suis de la première faction avec deux autres poilus. L'un de ces derniers prend à la guérite de gauche, et je prends avec le deuxième, un nommé Nadeau, en avant du bois. Nous nous enveloppons dans nos couvertures, mais il fait pas mal froid et au bout d'un moment nous devons nous résoudre à faire les cent pas pour nous réchauffer. Rien ne vient troubler nos trois heures de garde, et nous nous distrayons à écouter le bruit des moteurs des avions boches qui vont jeter des bombes sur l'usine de Pompey, dont on aperçoit la lueur à l'arrière, et le bruit des moteurs des avions français allant également jeter des bombes sur une usine boche dont on aperçoit les lumières au loin. On voit des deux cotés, les fusants éclater, sans gêner, en rien, d'ailleurs, la marche des avions. Quelques temps après, ils reviennent, et on sent à leur manière d'aller, au bruit que font leurs moteurs qu'ils sont moins chargés. Ils marchent plus vite et leur moteur va plus régulièrement. Ils se sont débarrassés, sinon, sur le but projeté, du moins en chemin, des projectiles qui les alourdissaient... Quand les deux autres viennent nous relever, nous rentrons dans la cagna, tout heureux de pouvoir nous asseoir près d'un bon feu. Une fois réchauffés, nous nous étalons sur nos paillasses et nous dormons jusqu'au moment où une des sentinelles vient nous secouer et nous annoncer qu'il est l'heure... l'heure sombre... où nous devons retourner à notre guérite. Encore trois heures à tirer, les trois dernières et nous serons libres. Nous retournons nous coucher à quatre heures du matin et, jusqu'à sept heures nous faisons un bon somme. A ce moment, le petit jour est venu, on va pouvoir rentrer, car on doit abandonner le poste avant qu'il ne fasse entièrement jour, et rentrer au presbytère. En arrivant, nous avalons notre jus et, comme nous n'avons rien d'autre à faire, nous nous... recouchons jusqu'à la soupe de dix heures. L'après-midi s'écoule à lire, fumer, et jouer aux cartes. Le soir, nous repartons, le sergent, nous six et le poilu avec son chien. Ces deux derniers marchent en avant, nous suivons le boyau. En arrivant à la lisière du bois, nous préparons nos armes, car nous devons visiter le boqueteau et ses cabanes avant de prendre la garde... Le chien renâcle, on ouvre les portes de bois des cagnas à toute volée, on remue les feuilles et la paille... rien. On rentre dans notre cabane, pendant que les sentinelles vont prendre leurs places. ...Il y a avec nous, deux fusiliers-mitrailleurs avec leur tacot : Neveu et Meslay, le premier, tireur et le second, deuxième pourvoyeur... Ils installent leur arme sur le parapet de l'élément de tranchée, à l'emplacement spécial. Ce sont d'ailleurs les deux poilus qui prennent la garde à coté de cet endroit qui sont chargés de le faire fonctionner...  Je me pose d'ailleurs une question à ce sujet : comment, en cas d'alerte, ferions-nous, Nadeau et moi, pour tirer, puisque nous ne connaissons, ni l'un, ni l'autre, cette arme ? Il est vrai que Neveu nous la prépare, de façon qu'il n'y ait qu'à appuyer sur la détente. Enfin, comme nous ne craignons pas grand'chose, rien ne sert de nous biler, et, d'ailleurs, nous avons nos lebels, qui nous rendraient tout autant service. Tout se passe ainsi pendant trois ou quatre jours, puis le 1er décembre, voilà du nouveau : Comme d'habitude, nous étions rentrés au presbytère vers sept heures, et nous avions mangé la soupe à dix heures. Nous avions à peine commencé une partie de manille, lorsque le sergent Brisse vient nous réquisitionner pour faire des corvées. Cela ne va pas beaucoup, d'autant plus que le matin il se fait un pétard de tous les diables dans le presbytère, au point que je me demande même ce que penserait le curé, s'il revenait, à ce moment, passer une heure dans son habitation ! Jusqu'à trois heures et demie, nous travaillons à l'obstruction de certains boyaux désaffectés et à quatre heures, après avoir mangé la soupe, nous filons. Les nuits sont devenues plus longues. Nous prenons maintenant de cinq heures et demie et de minuit à trois heures et demie. Au jour, au lieu de retourner au presbytère, nous avons décidé à trois, de rester dans le bois, afin de pouvoir dormir tranquilles. L'un de nous, se détache, vers six heures, pour aller chercher le jus et la gniole, car nous ne tenons aucunement à en être privés, et nous pouvons ainsi roupiller tranquillement, jusqu'à neuf heures du matin, sans entendre les criailleries des copains, peu généreux, qui, ne pouvant dormir, empêchent les autres de dormir. A dix heures, nous allons manger la soupe au presbytère, et voulons ensuite retourner dans le bois pour y préparer des fagots et des bûches, pour le feu la nuit. Mais, il n'y a pas un quart d'heure que nous y sommes, que le lieutenant Troutot arrive : "Que faites-vous ici ? - Nous préparons du bois pour cette nuit, mon Lieutenant. - Filez. Vous savez qu'il ne faut personne ici !" Nous obtempérons à l'ordre et rentrons à Clémery, juste pour nous entendre dire, d'avoir à sauter sur des pelotes de fil de fer barbelé et d'avoir à le transporter dans un boyau en avant. Le lendemain, comme la nuit a été encore plus rigoureuse et que la neige s'est mise à tomber, nous réduisons le service de garde à deux heures, afin de pouvoir venir se réchauffer plus souvent dans la cagna. Seulement, ce service est plus fatiguant, puisqu'on se repose moins longtemps... Je commence à être bien fatigué. Lorsqu'on rentre au presbytère, le matin, on croit pouvoir se reposer... macache ! Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre ! Ce matin-là, nous rentrons et nous demandons le casse-croûte au caporal Garnier qui s'en occupe tous les matins. Il nous amène des boites de sardines de deux grandeurs : les unes pour neuf, les autres pour cinq. Nous nous étonnons surtout lorsqu'il ajoute qu'il y a un quart de gniole pour cinq, alors que d'habitude, il est pour quatre. Dubois un fusilier-mitrailleur, ne voulant pas perdre son temps à discuter, s'en va à la cuisine, se renseigner auprès du caporal d'ordinaire. Cinq minutes après, il est de retour, triomphant. Cela va barder, d'autant plus que Garnier est mal vu dans sa section. C'est un type qui veut faire un service extraordinaire afin de mériter les éloges de ses chefs, et surtout, le galon de sergent, afin de rattraper son cousin, mais qui est trop bête pour faire son service intelligemment. C'est du reste, le genre de Brisse, mon sergent, avec qui il s'entend fort bien. Dubois le prend à parti : "Pour combien les sardines ? - Ces boites pour neuf et celles-ci pour cinq ? - Ah, eh bien moi, je prends cette boite-ci pour huit ! - Tu ne prendra rien du tout et tu feras comme on te dira !" Nous sommes au premier étage du presbytère et l'escalier donne sur une espèce de couloir, dont la fenêtre qui le termine donne sur la rue. Dubois et Garnier discutent près de l'ouverture, qui, d'ailleurs n'a plus ni carreaux, ni battants. La colère commence à gagner Dubois : "De quoi ? Si tu n'es pas content, va chercher la boite de sardines que tu as gardé en bas ! - Quelle boite ? Tu es fou ? - Non, mon vieux. Le cabot d'ordinaire t'a donné des boites de sardines, les unes pour quatre et les autres pour huit, seulement toi, tu veux faire du rabiot; c'est comme pour la gniole, il y en a un quart pour quatre ! Déjà hier ç'a été la boite de pâté, on n'en a vue que la moitié... avant-hier, un quart de gniole soi-disant renversé. Tu comprends, il y en a marre, comme ça, et je te conseille de la boucler ! - Oh ! non mais ce n'est pas toi qui me la feras boucler ! - Tu crois. Eh bien, un bon conseil : fous-moi le camp ou je te balance par la fenêtre !" Là-dessus, Garnier, voyant que c'est sérieux ne sait plus quoi dire. A ce moment l'adjudant Bénard, attiré par le bruit monte et demande des explications, qu'il obtient d'ailleurs, rapidement. Garnier reçoit un savon qu'il a moins volé que les sardines et le calme se rétablit. En attendant, on n'a toujours pas dormi ! Mais malgré ça nous sommes heureux de la bonne leçon reçue par Garnier et nous espérons bien qu'elle lui servira. ...Le lendemain matin, nouvelle histoire ! En rentrant, tout était tranquille. Nous étions déjà heureux, comptant pouvoir roupiller, lorsqu'une demi-heure plus tard un agent de liaison arrive annonçant que la coopérative est installée à Bénicourt et que l'on ait à faire une commande pour toute la section, car deux poilus seulement pourront se détacher pour aller chercher ce dont on avait besoin. Garnier monte dans notre chambre. Il commence par buter dans un banc, puis dans un sommier, sur lequel dorment deux poilus. Il pousse quelques jurons, puis nous explique ce qu'il y a. Les poilus mécontents d'être réveillés si tôt, rouspètent : "Tu nous fais chier avec ta coopé ! - Tu peux te torcher le cul, avec ta commande !" Voilà alors Garnier qui envoie tout promener et veut commander à Ronteix, un autre cabot, de faire la commande. Ce dernier ne veut rien entendre... et les voilà partis à se disputer. Cela m'agace, je me lève et les trois quarts font comme moi, car il n'y a plus moyen de dormir. Enfin, après un bon moment de discussion, la commande se fait et je pars avec un copain, chercher les objets demandés... Bénicourt fait suite à Clémery, les maisons du premier touchent à celles du second. Le chemin que l'on prend pour aller à la coopérative est curieux, car afin de ne pas faire d'allées et venues dans la rue, on a imaginé un chemin passant dans les maisons. Les murs sont percés et il n'y a qu'à suivre la piste ainsi constituée... Nous nous chargeons et refaisons le chemin en sens inverse... Je répartis la marchandise et rend la monnaie, et en peu de temps je suis débarrassé de ma corvée... A quatre heures, retour au bois. Le temps étant trop mauvais on n'a pas travaillé cette après-midi. Aujourd'hui, c'est l'équipe Neveu, Meslay et Lebras (ce dernier est un récupéré, arrivé dernièrement) qui prennent les premiers de cinq à sept heures. Au jour, nous allions rentrer, lorsque nous voyons le sergent Brisse qui vient à notre rencontre. Nous étions trois : Lebras, Lepot et moi, tous trois de Paris. En nous apercevant, Brisse nous dit d'aller à une centaine de mètres de là, dans un vieux boyau abandonné, chercher du bois pour qu'il puisse se chauffer. Il loge avec la moitié de la section dans une sape, qui se trouve dans le boyau où nous passons à mi-chemin entre le presbytère et le bois Carré. Lepot prend la parole : "Non, mais tu veux rire ! On n'a pas le droit d'aller chercher du bois pour nous et tu voudrais qu'on y aille pour toi. Tu peux toujours courir. On n'est pas tes larbins. Tu as des poilus avec toi !" Brisse se tenait sur le parapet et nous, dans le boyau. Lepot faisait allusion au jour où nous avions été dans le boqueteau pour préparer du bois et que le lieutenant était venu pour nous faire faire demi-tour. Mais ça ne faisait pas l'affaire de Brisse : "Je vous donne l'ordre d'y aller et ça doit vous suffire ! - Tu crois ?" En deux secondes, on se concerte entre nous. On va faire semblant d'y aller, puis on fera demi-tour en vitesse. Il nous indique le bois dont il veut parler. C'est une sape à demi-écroulée dont il s'agit d'enlever quelques poutres. On le laisse nous dépasser, puis brusquement, nous faisons demi-tour et détalons. Mais Brisse nous a entendus et il se met à notre poursuite. Il coupe à travers la plaine et saute dans le boyau afin de nous barrer le passage : "Où allez-vous comme ça ? - On va se coucher ! - Je vous ai donné un ordre, vous savez, et si vous refusez, vous verrez ce que ça vous coûtera !" Il me fait suer, ce pecnot à se croire tout permis parce qu'il est gradé, et j'ai envie de lui donner une leçon. Je ne veux pas laisser passer l'occasion : "Tu n'as pas besoin de nous l'apprendre, mon vieux, dis-je. Refus d'obéissance en présence de l'ennemi, ça doit être la mort avec dégradation militaire. Mais ça ne fait rien. Nous re-fu-sons !" Et j'appuie fortement sur ce dernier mot. Il devient blême de rage : "D'abord, vous, Cambounet, vous viendrez avec moi, voir le Lieutenant ! - Si tu veux, mon vieux. Mais un petit conseil en passant, porte le motif, si ça te fait plaisir, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Seulement, pour un motif pareil, il faut deux témoins et tu ne les a pas. Quant à nous tu penses bien que nous nierons et jusqu'au bout !" Je suis satisfait de mon petit speech, car je vois qu'il a porté. En effet, nous sommes seuls. Il pourrait dire ce qu'il voudrait nous le démentirions et il est probable que son motif porterait à faut... Il le sent... ce paysan mal dégrossi, et il ne sait plus que dire : "C'est bon, rentrez, mais je vous poisserai une autre fois. Je saurais bien vous possédez ! - Tu possèderas tes colombins, mon pauvre vieux !" lui répond Lepot. Et c'est vrai ! Voilà le seul mot, qu'ils aient à la bouche, ces culs-terreux ! Ils ne se rendent pas même compte qu'au lieu de posséder les autres, ils y sont eux-mêmes. C'est égal, on aurait eu affaire à un type plus intelligent, on était tout de même bel et bien bouclés, car il aurait mieux su s'y prendre ! Voilà qu'en arrivant au presbytère, Neveu s'aperçoit qu'il a perdu son revolver. Il signale le fait à Gonnord, et je pars avec lui au bois Carré afin de tout fouiller et se rendre compte s'il est là-bas. Son étui ferme mal et le revolver a très bien pu sauter. Dans la tranchée, rien. Nous visitons la cabane et regardons dans la paille... Au bout d'un moment, je retrouve un chargeur, mais nous avons beau poursuivre nos recherches, nous ne trouvons rien d'autre.  C'est bizarre, surtout à la réflexion ! Car, enfin ayant retrouvé un chargeur, nous aurions dû retrouver le reste, tout ayant dû tomber ensemble pendant qu'il dormait. Nous revenons au presbytère et rendons compte du peu de chance de nos recherches. Nous sommes au 6 décembre, un jeudi. A midi, on vient annoncer que les permissions reprennent et que Neveu et Meslay partent le soir même. Les fusiliers-mitrailleurs partant en permission sont remplacés dans leur emploi par des grenadiers-voltigeurs, pendant tout le temps que dure leur absence. Verdier, premier pourvoyeur de Neveu prend sa place, et moi, je suis désigné pour prendre celle du premier pourvoyeur, en remplacement de Verdier. Je dois avoir comme arme, le pistolet automatique de Verdier et celui-ci doit avoir le fusil et le pistolet de Neveu. Mais, comme ce dernier a perdu le sien, Verdier préfère me voir sans arme que me confier son revolver Cela ne me va pas et je me mets dans l'idée de retrouver cette arme qui n'a pu s'envoler et doit se trouver quelque part. Je retourne au bois Carré, accompagné de Verdier. Nous y passons deux heures et ne laissons pas un coin inexploré. Nous allons arrêter nos fouilles, lorsqu'une idée nous vient : l'arme a du être trouvée par un des hommes du petit poste qui l'a gardée. Nous revenons à Clémery en toute hâte et faisons part de notre idée à l'adjudant. Celui-ci ne perd pas le nord. Il monte avec deux cabots et fait mettre tout le monde au pied de son lit avec ordre de tenir ses affaires à portée de sa main. Il va pour commencer dans un coin lorsqu'il remarque Nardeau dans le coin opposé occupé, d'une manière embarrassée à vider son sac. Changeant brusquement d'idée, il vient vers lui et sort le linge sous lequel se trouve... un revolver : "Quelle est cette arme ? demande l'adjudant. - C'est un revolver que j'ai ramassé à Verdun, le 26 août et que je voulais emporter chez moi, à ma prochaine permission. - Comment se fait-il que tu ne l'aies pas emporté à celle-ci, puisque tu en reviens, il y a peu de temps. - Je l'avais oublié. - Ah, vraiment ! - Mais oui, d'ailleurs vous pouvez demander à Cambounet, je lui en avais parlé !" Par exemple, moi, je ne marche pas dans la combinaison. Il ne m'a jamais parlé de pistolet trouvé à Verdun, et je suis bien convaincu que celui-ci est l'arme cherchée : celle de Neveu ! Je ne veux pas me faire le complice de Nadreau, en disant comme lui, aussi ma réponse est-elle une déception pour lui. D'ailleurs, Neveu revient justement de la coopérative, où il est allé s'approvisionner en vue de son voyage. On va être renseigné immédiatement. Ce n'est pas long. Il reconnaît aussitôt présenté, ce revolver comme lui appartenant, et il en est même très heureux, car il craignait qu'on l'ait soupçonné d'avoir voulu faire son arme, afin de l'emporter en allant en permission. L'adjudant est donc fixé, il ne lui reste plus qu'à faire son rapport. J'hérite du revolver avec plaisir, d'abord parce que j'étais embêté d'être sans arme, puisque le pistolet constitue le seul moyen défensif et offensif du premier pourvoyeur de F.M. et ensuite parce que je préfère le pistolet au Lebel. Comme on est obligé pour quelque corvée ou quelque déplacement que ce soit de prendre son arme, il est plus facile d'emporter un revolver dans un étui, au ceinturon, qu'un équipement de trois cartouchières et un fusil de quatre kilos. En changeant de spécialité, je change également de poste. Je ne fais plus partie du petit poste du bois Carré. Je prends maintenant la garde, au fond du jardin du presbytère, dans un petit bout de tranchée où se trouve un emplacement de F.M.  Nous sommes quatre : Dubois, tireur, moi, premier pourvoyeur, Blin, deuxième, et Landréat, placé là pour faire le quatrième, comme à la manille. Pour qu'il y en ait toujours un à la garde qui connaisse le fonctionnement du fusil, Dubois prend avec Landréat et je prends avec Blin. Nous passons nos deux heures à causer de choses et d'autres et j'en profite pour m'instruire sur le F.M. en général, et sur le tir, en particulier. Lorsque le jour arrive, je suis capable d'approvisionner, c'est-à-dire de placer les chargeurs et de tirer avec un tacot. Je prends la garde de cette façon pendant deux nuits. Le samedi 8 décembre, nous sommes relevés par une autre compagnie du bataillon. Il fait une nuit très obscure. De plus, j'ai sur les riens le sac de cartouches, auquel je ne suis pas habitué, aussi quoique faisant bien attention de ne pas perdre celui qui me précède, il arrive un moment où ayant eu le malheur d'appuyer un peu trop à gauche, me voilà parti à barboter dans les chevaux de frise... Le barbelé m'agrippe... Je vois le moment où je vais y laisser ma capote... Enfin, je me dépêtre, et petit à petit, je reprends ma place derrière Verdier... Nous allons en réserve, à Lixières, où nous arrivons en une grande heure de marche. Des poilus nous attendent, qui sont venus reconnaître et préparer le cantonnement. On entre dans une grande salle qui sert de chambre à la section et on se couche... Le lendemain, on a l'occasion de voir le pays. Il n'est pas bien grand, pas trop esquinté, à part l'église dont le clocher est venu faire sa prière sur le sol... Il y a quelques civils, qui devant la tranquillité du secteur, ont préféré rester... Ici, il n'y a que la garde au poste de police, et c'est tout le service à fournir, car nous travaillons toutes les nuits, sauf les trois premières pendant lesquelles nous avons repos complet. Les poilus en profitent d'ailleurs, pour faire de fréquentes visites à la coopérative, et on peut admirer des scènes, comme celle d'hier soir : Garnier avait acheté un paquet de douze bougies et... du pinard ! Une fois saoul, il a allumé ses douze bougies et s'amuse à les souffler avec un balai... ! Jeu d'innocent ! A la première section, scène plus violente : Vannacker, un gars du nord, à poil roux, père de trois gosses, étant saoul, se bat et esquinte à moitié son adversaire, aussi saoul que lui, d'ailleurs ! ...La brute humaine, dans toute sa splendeur... ! Heureusement que le 11 au soir, nous partons, vers onze heures, sous la conduite du lieutenant Sénèque, pour les environs de la ferme de Brionne, où nous devons creuser une tranchée. Nous travaillons sans rien nous casser, et nous rentrons vers quatre heures nous coucher. Nous dormons jusqu'à dix heures, moment où l'on nous apporte la soupe. L'après-midi, manilles, lettres, et le temps passe... Et ainsi, chaque jour. Le 15 décembre, au rapport de dix heures, on nous annonce que nous allons à Nomény, demain matin, relever la troisième compagnie du 156. C'est une compagnie de travailleurs, qui doit ficher le camp car son régiment est relevé. Le lendemain matin, donc, nous déménageons sans tambour ni trompette et nous allons à Nomény. Ce pays est en ruines, entièrement détruit. D'ailleurs, on s'y est battu ferme, et, en 1914, les boches l'ont occupé quelque temps. Notre travail ne durera pas bien longtemps : trois ou quatre heures à piocher la terre, le soir même pour approfondir un boyau de communication, au nord-est de Nomény et nous rentrons. Nous sommes logés, à une demi-section dans une cave. Nous avons un poêle et nous y sommes très bien... du moment qu'il ne tombe pas d'obus ! Le lendemain, repos, car nous allons le soir même relever la septième compagnie de chez nous, au moulin de Brionne, situé au bord de la Seille, à mi-chemin entre Clémery et Nomény, et sur la route réunissant ces deux pays. A huit heures la relève est achevée. 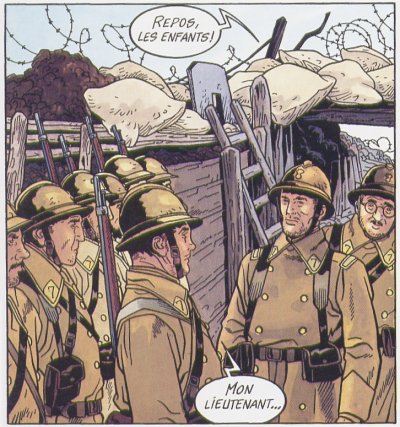 Comme je fais partie de l'équipe de F.M. j'ai un poste fixe. A cet endroit, est établie une passerelle sur la Seille, à l'entrée de laquelle on a installé une petite cabane en planches. Le fusil est posé sur la passerelle et nous avons deux grenades incendiaires à notre disposition, pour mettre le feu au pont en cas d'attaque de la part de Messieurs les Boches. Mais la cabane est percée comme une vieille écumoire, et on passe une nuit plutôt morose. Nous sommes là-dedans les trois poilus de l'équipe et le caporal Ronteix. D'un côté, la cabane est fermée par une couverture de l'autre côté de laquelle se trouve un banc : c'est là que nous prenons la garde. La sentinelle peut ainsi, en cas d'alerter, appeler les poilus qui arrivent immédiatement à leur poste... ...A cet endroit, la Seille n'est pas encore débordée, mais elle forme deux bras : l'un qui passe au pied du moulin et en actionne la roue à aubes, et l'autre sur lequel se trouve notre passerelle. Une cinquantaine de mètres séparent ces deux bras, et comme la Seille recouvre cet îlot pendant sa hausse, on a construit une sorte de piste en planches, à un mètre environ au-dessus du sol. De l'autre côté de notre passerelle, cette piste se poursuit également, sur une trentaine de mètres, afin de pouvoir n'importe quand, passer sur l'autre rive. Ce chemin est emprunté deux fois pas nuit, par des patrouilles qui sortent et au petit jour par les poilus d'un petit poste qui vont s'installe en haut de la crête qui se trouve devant nous, dans une cagna placée dans un verger. On appelle ce petit poste : poste de la guérite, et il tire son nom d'une guérie blindée qui sert d'observatoire, dans le jour, à la sentinelle du petit poste. Nous sommes relevés par une équipe de F.M. de la quatrième section, à une heure du matin. Nous rentrons dans notre sape : une petit cagna construite par un amoncellement de pierres placées les unes sur les autres. Cela n'a pas de consistance. Il suffirait d'un malheureux 88 pour dégommer tout le ba-ta-clan. Mais on y roupille bien quand même. Nous avons la roulante, sous le hangar même, à coté de notre gourbi. Nous n'avons donc pas loin à aller pour aller chercher la soupe et éplucher les pommes de terre. Nous passons une journée tranquille, puis à la tombée de la nuit, on nous fait préparer en vue d'une expédition nocturne : une reconnaissance avancée que nous devons effectuer dans la direction du village de Rouves, occupé par les boches, afin de savoir s'il n'y a pas un petit poste ennemi, installé sur la route de Nomény à Rouves, en avant de ce dernier pays, et ceci en vue d'un coup de main qui s'exécutera dans quelques temps. A six heures le départ est donné. Je dois suivre Verdier, mon tireur. J'ai, à ma disposition, une musette contenant six chargeurs pleins et mon revolver Nous montons tout d'abord, au petit poste de la guérite, puis nous appuyons à droite, en suivant le verger et nous nous dirigeons vers le cimetière de Nomény dans lequel est installé un petit poste de chez nous. A cet endroit, commence le labyrinthe de boyaux. Un officier nous attend pour nous indiquer le chemin. Il nous conduit à travers les boyaux jusqu'à la route de Nomény-Rouves, nous fait franchir le dernier barbelé et nous quitte. Nous suivons tout d'abord la route. Mais l'adjudant se rendant compte que nous faisons beaucoup trop de bruit, nous fait obliquer. Nous allons marcher dans les champs tout en suivant la route. Nous sommes en formation d'approche. Verdier et moi, en avant et au centre. A droite et à gauche, un grenadier. Nous allons doucement, en écoutant attentivement les moindres bruits. Tous les cinquante mètres, nous nous agenouillons et restons ainsi cinq minutes... Rien... Pas de bruit... Nous repartons... Nous parcourons ainsi un bon bout de chemin, lorsqu'à un tournant de la route, nous entendons en avant de nous, des voix causant en boche... Ainsi donc, nous sommes renseignés : il existe un petit poste boche à cet endroit, que l'adjudant repère soigneusement. Il donne alors ordre de faire demi-tour. Notre randonnée a parfaitement réussi, il ne s'agit plus que de rentrer aussi doucement que nous sommes sortis. Ordre est donné à voix basse de faire demi-tour, sans changer la figure de marche... Nous employons la même tactique qu'à l'aller. Verdier et moi, sommes maintenant en arrière. Nous devons nous arrêter de temps en temps et écouter, puis nous rejoignons les poilus... Nous regagnons tranquillement notre point de départ; nous nous retrouvons à la chicane par laquelle nous étions sortis. Nous suivons le même chemin que précédemment pour regagner notre cagna. Il est dix heures. Nous avons mis quatre heures pour faire environ huit kilomètres, en tout, aller et retour. En tout cas, nous aurons une nuit tranquille. Le lendemain matin, on nous apprend notre nouveau service, que le lieutenant Troutot a institué : tous les quatre jours, le même service se répétera. Pour commencer la troisième section fournira la garde et la quatrième les patrouilles, et ceci pendant quatre jours. Le cinquième, nous ferons les patrouilles et la quatrième la garde. Puisque nous allons avoir quatre nuits de suite à prendre la garde, nous nous entendons entre les deux équipes pour aller restaurer la cagna de la passerelle. Nous dégottons du treillage de fil de fer dont nous entourons la cabane, en laissant naturellement la porte libre. Puis, entre le treillage et les planches nous faisons couler de la boue épaisse prise sur les bords de la Seille, et qui une fois séchée, nous constituera un véritable mur. Ensuite, nous abattons du moulin, un morceau de tuyau, destiné à la descente des eaux. Nous l'attachons à trois ou quatre endroits avec du fil de fer pour qu'il ne se démonte pas, au cas où la chaleur le désouderait. Car, dans la cabane, nous avions un poêle, mais pas de tuyaux. Nous arrangeons tout ça, nous préparons du bois tout coupé, pour la nuit, et voilà notre installation terminée. Nous n'aurons pas froid cette nuit... Le service est partagé entre les deux équipes de la section la moitié de la nuit chacune. Nous prenons cette nuit les premiers de cinq heures et demie à minuit, heure à laquelle la deuxième équipe vient nous relever. Notre système de chauffage a parfaitement réussi. Nous nous félicitons d'avoir eu le bon esprit de ficeler le tuyau, car la soudure a fondu et je ne nous vois pas trop bien arrangeant ça une fois brûlant ! A minuit donc, je vais me coucher et je ne tarde pas à m'endormir d'un bon sommeil réparateur. Après la soupe du matin, rassemblement. Une auto a apporté des fascines, sortes de clayonnages formés de branches reliées par du fil de fer et d'une hauteur de deux mètres cinquante à trois mètres... Nous devons les étendre du coté boche, tout le long de la route Nomény-Clémery, pour remplacer le camouflage actuel qui tombe en désuétude.  Après la soupe du soir, je me couche et dors jusqu'à une heure du matin. A ce moment réveil et relève de la deuxième équipe. Il faut remuer pendant cette garde, car les distractions sont rares et il fait pas chaud dehors. Vers une heure et demie on entend le bruit fait par une troupe d'hommes, marchant sur la passerelle venant du moulin : la patrouille qui sort... Les poilus passent, échangent des quolibets avec nous, puis c'est fini, le calme plat. Il y en a ainsi jusqu'à une heure du matin, moment de la rentrée de la patrouille. Pendant quatre fois vingt-quatre heures, du 19 au 22 décembre nous faisons la même chose : garde de nuit et travail, l'après-midi. Je ne vais pas tarder à reprendre ma place de grenadier-voltigeur, car Neveu est rentrée de permission, ce matin. Il va prendre les vingt-quatre heures de repos auxquelles il a droit, puis il se ressaisira du revolver et du fusil-mitrailleur de Verdier qui reprendra ma place. 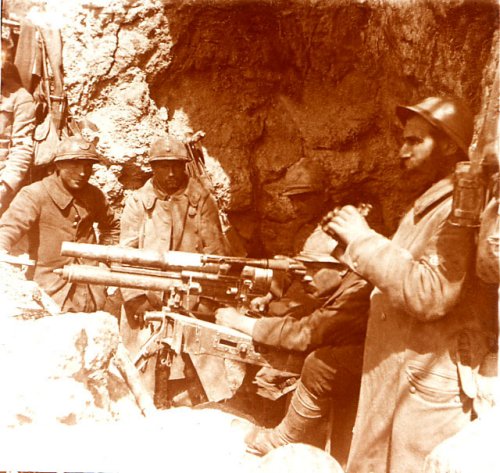 La nuit repos jusqu'à une heure et demie du matin. Nous sommes de patrouille. Nous quittons le moulin de Brionne, par la passerelle. Nous échangeons les signaux conventionnels en passant près du poste de F.M. puis nous poursuivons notre route. Nous longeons tout d'abord la Seille, au lieu de monter directement vers le petit poste de la guérite. Tout en marchant, nous examinons la neige. Il n'y a pas de trace de pas, sinon celles de quelques lièvres maraudeurs qui ne sont guère inquiétants. Nous traversons par des chicanes appropriés les réseaux de barbelés, qui nous barrent la route, et ils sont nombreux, car la plaine en est couverte. Enfin, nous sommes près des premiers réseaux boches, sans avoir fait de mauvaises rencontres. Là, se trouve un boyau qui s'en va rejoindre le boyau de la crête, dans lequel est installé le petit poste de la guérite. Nous suivons ce boyau, car il s'y trouve des petites cabanes abandonnées que nous devons visiter au passage... Rien... Nous arrivons en haut... Examen de la guérite et de la cagna et nous continuons notre chemin en suivant le verger, pour nous rendre au cimetière de Nomény, chemin que nous avons déjà emprunté une fois, lors de notre excursion vers Rouves... Au passage visite des ruines d'une ferme, qui dresse ses quatre pans de murs, noircis par l'incendie. Nous descendons ensuite dans le boyau creusé dans le cimetière. Un embranchement de ce boyau tourne et va sortir derrière le verger, chemin que nous parcourons. Nous traversons ensuite le verger et nous dirigeons vers la guérite. Il nous a fallu à peu près une heure et demie pour faire cette promenade, et nous ne devons rentrer qu'à quatre heures et demie, au plus tôt. Nous avons donc encore une heure et demi à passer : nous l'employons à prendre un peu de garde, deux par deux, pendant que les autres se chauffent dans le gourbi. Etant de deuxième patrouille, nous retrouvons un restant de feu laissé par ceux de la première qui l'ont allumé. Nous n'avons qu'à le ranimer. A quatre heures et demie, retour au bercail... Ce soir, réveillon, il est bien triste... Patrouille et garde à la guérite, de six heures du soir à onze heures. ...En prenant ma garde, je ne puis m'empêcher, tout en regardant chez les Fritz, de songer à ce que je ferais si j'étais chez mes parents... ...Il y aurait sans doute un bon rôti... et je me mets à rêver tout éveillé... ...Je me vois attablé auprès d'un bon feu, mon père à ma gauche et ma mère à ma droite... Nous avons tous trois la mine de gens heureux d'être réunis, satisfaits d'être chez soi... Une odeur appétissante de cuisine bien à point vient flatter notre odorat... ...Nous mangeons tranquillement... puis nous causons... J'allume un cigare... Quelle belle occasion de fumer un de ces bons cigares bien secs, mis soigneusement de coté par mon père, modeste fumeur... Je le fume béatement ! Que l'on est bien ! Mais... Un bruit de pas me fait sursauter... Ce n'est qu'un rêve ! Rêve qui est bien près de me donner le cafard. Je me secoue car je n'aime pas cette bête-là ! Après tout, un jour arrivera où ce songe se réalisera si... je ne reste pas dans quelque coin ! Mais telle n'est pas mon intention ! Je veux vivre ! J'ai envie de vivre, maintenant que je peux mourir d'un jour à l'autre... une envie, comme on en a à dix-neuf ans ! ...Il est vrai que l'envie ne suffit pas ! Enfin, je veux vivre et j'ai bon espoir que je vivrai. Le cafard n'a pas de prise sur moi. Cinq minutes plus tard, il est chassé, et je fume une cigarette (mon cigare de Noël) dans la cagna, en attendant le retour au moulin, ce qui ne tarde d'ailleurs pas... Pendant quatre nuits, suivant la décision du commandant de compagnie, nous accomplissons le même trajet. L'après-midi, nous travaillons dans la plaine, à l'approfondissement d'un boyau d'évacuation : c'est une véritable rue, on pourrait y passer avec une voiture à bras ! Le 27, changement de service. Comme je suis redevenu grenadier je suis désigné pour être de garde de jour, au petit poste de la guérite. C'est le filon, car on est tranquille. On prend deux heures de garde sur huit, puisque nous sommes quatre... Pendant nos deux heures, nous nous installons dans le verger, et, de temps en temps, nous entrons dans la guérite, car on y est mieux pour examiner les ouvrages boches. On voit des Fritz travaillant à Rouves, ils creusent un boyau. A droite du pays, un fortin : l'ouvrage des canuts, plus à droite, Raucourt, et enfin, dans la plaine, les emplacements de quelques petits postes... 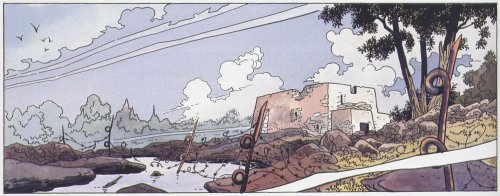 Dans la cagna, il y a une tripotée de petites souris : aussi nous avons imaginé un moyen de les posséder : nous enlevons les balles des cartouches et les remplaçons par une bourre de papier, maintenant la poudre. Une cartouche dans le canon et nous attendons, le fusil en arrête... Lorsqu'une souris passe (car elles ne se gênent pas avec nous !) boum ! un coup de fusil lui brûle la tête ! J'en brûle ainsi dans la première journée, une douzaine pour ma part ! Entre temps manilles sur manilles. A dix heures et à quatre heures, deux poilus descendent chercher la soupe. Le deuxième jour, je pars faire cette corvée avec Brunet, un poilu de mon escouade, et nous remontons la piste, nous conduisant à la guérite, lorsqu'à notre gauche, dans la plaine, à deux ou trois cents mètres, nous apercevons un poilu, se promenant. Le fait nous semble étrange, car d'ordinaire, dans le jour, personne ne baguenaude dans les lignes... Brunet qui voit des espions partout, me demande : "On y va ! - Et la soupe ?" C'est vrai. Nous avons chacun un bataillon à la main : "Bah ! laissons-les là. Nous les reprendrons en passant ! - Soit, allons-y !" Nous abandonnons nos ustensiles sur place, dans la neige, et l'arme à la main, nous dirigeons vers le type. Mais en se retournant, il nous voit et descend dans le boyau que nous visitons le soir. Ayant repéré l'endroit où il est descendu, nous nous séparons de façon à arriver l'un au-dessus, et l'autre au-dessous de cet endroit; arrivés au boyau, nous marchons à la rencontre l'un de l'autre. Brunet le voit le premier : "Qu'est-ce que tu fous là ?" lui demande-t-il. Puis, se reprenant : "Je vous demande pardon, mon Lieutenant, mais nous avons aperçu un poilu, de loin, et nous avons voulu nous rendre compte !" Le bonhomme que nous avions devant nous portait l'uniforme de lieutenant du 7e génie. Il n'avait aucune arme, juste son masque à gaz en bandoulière... Cette tenue m'intriguait. J'avais envie d'inviter le type à nous suivre jusqu'au P.C. du lieutenant Troutot... Mais j'aurais peut-être fait une gaffe. Je la fermais et nous repartons chercher nos bouteillons. En arrivant au petit poste, nous racontons cela : le caporal Ronteix nous dit qu'il fallait faire comme j'en avais l'intention. Mais la soupe est là, et nous ne tardons pas à parler d'autre chose... Au bout du quatrième jour, nous sommes relevés par la quatrième section. La nuit suivante, j'ai repos complet, car il y a du rabiot de poilus dans la section, et par roulement, chaque nuit, quatre poilus se reposent tranquillement toute la nuit... ...Enfin, voici le premier janvier 1918... Que va nous amener cette nouvelle année ? ...Une chose ardemment désirée : c'est la fin de la guerre, et c'est le premier de nos souhaits, en cette journée... Comme suppléments, nous touchons des cigares, des oranges, du jambon et une bouteille de champagne pour quatre. Dans l'après-midi, la coopérative du régiment étant installée à Nomény, je me dévoue avec un copain pour aller acheter du pinard, aussi, le quart de champagne aidant, quelques-uns des poilus sont-ils retournés proprement, le soir même... ...Nous devons partir en patrouille à une heure trente. Nous passons la première moitié de la nuit à jouer aux cartes tout en fumant et buvant... Aussi, lorsque l'heure de la patrouille arrive tout le monde n'est pas prêt. Verdier est affalé sur sa paillasse, pas moyen de le réveiller ! Brunet, lui, est saoul, mais il n'en est que plus vif ! Il prend un revolver et part en avant ! On a toutes les peines du monde à le retenir, et, une fois en plaine, inutile d'essayer ! Il fait cinquante mètres au pas gymnastique, se couche et colle son oreille sur le sol : méthode indienne. N'entendant rien, il nous fait signe que tout est tranquille. Arrivé aux cagnas échelonnées dans le boyau, il s'arrête à l'entrée de chacune d'elles et siffle quelques coups, en criant : "Fritz ! Fritz !" Personne ne répondant : "Eh, les gars, avancez ! Y a pas de pet !" Nous gravissons la crête. Il s'empêtre dans des chevaux de frise et nous avons un mal inouï à l'en sortir. Enfin, nous finissons notre tour et revenons à la guérite. Le champagne doit, sans doute, lui fouetter le sang, il ne peut rester en place. Il monte alors sur le parapet, roule une cigarette et l'allume tranquillement, avec son briquet à essence. Heureusement que nous sommes dans un secteur comme celui-ci, car la flamme se voit certainement de loin et les boches ne tirent pas... Il est vrai qu'ils sont peut-être aussi saouls que Brunet lui-même ! Notre garde se passe donc sans incident et nous revenons nous chauffer dans la cagna... Quant à Brunet, la cigarette l'a achevé; il descend dans le boyau et se couche sur le caillebottis, dans le fond de la tranchée. Heureusement nous n'y restons pas longtemps, sans ça il crèverait de froid, car il gèle à pierre fendre ! Vers cinq heures nous redescendons au moulin et nous couchons... Jusqu'au 4 janvier, nous continuons ce service de patrouille... A cette date, la compagnie est relevée et s'en va à Nomény. Nous reprenons les mêmes emplacements que précédemment. Le lendemain de notre arrivée, nous avons repos pour nous permettre de nous organiser à peu près. Puis ensuite travail jusqu'à la gauche : nous allons nous occuper de l'approfondissement d'un boyau le long de la route Nomény-Quatre-fers. On nous avertit qu'il doit avoir au moins un mètre quatre-vingts avant notre départ. Si la saison était meilleure, il n'y en aurait pas pour longtemps... Mais en ce moment, la terre est gelée, et à certains endroits il faut un pic pour déraciner un centimètre cube. Enfin au bout de six jours notre boyau est terminé. Il atteint même par endroits, deux mètres passés. Pour ma part, je ne voudrais pas y passer, en cas de bombardement. Un obus sur le bord et on peut être sûr d'être enterré... Agréable perspective ! qui ne me sourit pas du tout ! Nous apprenons que nous allons quitter Nomény, demain pour Manoncourt, pays situé en arrière, à mi-chemin entre Clémery et le moulin de Brionne. Nous devons y faire des patrouilles. Les sergents Brisse et Pélisson sont partis dès ce soir, faire une patrouille, avec les occupants actuels de Manoncourt, afin d'en reconnaître l'itinéraire... Nous croyons être relevés définitivement aujourd'hui, et ce n'est qu'un changement de place ! Pourtant voici quarante-cinq jours que nous sommes en ligne... Il est vrai que dans un secteur pareil on y finirait bien la guerre ! Le lendemain soir, 13 janvier, nous quittons Nomény, à six heures. Après une marche d'à peine une heure, nous arrivons à Manoncourt. Le service se partage en deux pour la section. Une patrouille par demi-section dans la nuit; la première demi-section faisant la sienne vers sept heures du soir et la deuxième, vers trois heures du matin. Quand aux autres sections il y en a deux à Manoncourt même et la troisième sur la route Nomény-Quatre-Fers, à la cote 208; cette dernière fournit la garde sur la route. Nous étions bien endormis, lorsque nous sommes réveillés en sursaut par des jurons... Brisse nous dit de nous dépêcher, qu'il va faire jour et qu'il faut faire la patrouille ! Il est cinq heures et demie et la patrouille doit se faire ... trois heures ! Quelques-uns lui disent de laisser choir, mais le monsieur ne l'entend pas de cette oreille. On lui a dit de faire une patrouille : il la fera, quand même il ferait jour ! Nous partons donc et raccourcissons néanmoins le chemin : en un mot, les deux heures de patrouille se réduisent à trente minutes ! Dans la journée, tranquillité la plus absolue. Aussi nous on profitons pour nous approvisionner de bois de chauffage. Il y a pas mal de maisons descendues, c'est un jeu que d'en avoir une poutre qui est débitée instantanément... Nous avons repéré un chat, un superbe matou, gras à souhait ! Un des poilus de la section, Chaxel, sorte de braconnier, s'est promis de l'attraper et de nous en régaler... Ce qu'il ne manque pas de faire. Le lendemain le chat vient faire un tour dans notre cave : Chaxel l'attrape et l'égorge illico ! ...Ensuite, il le pend dans l'escalier à la gelée. Il le laisse ainsi vingt-quatre heures. Pendant ce temps il se procure à la roulante tout ce qui est nécessaire à la confection d'un bon civet, lequel ne tarde pas à dégager son odeur. Odeur très appétissante je dois en convenir, mais l'idée seule que c'est du chat m'empêche d'y goûter, malgré les invitations pressantes de Chaxel et les exhortations des copains, qui le déclarent excellent ! Ce n'est qu'au bout d'un long moment en voyant les camarades se lécher les doigts que je me décide. Je dois reconnaître que c'est exquis ! Le 19 janvier, après six jours de patrouilles, nous allons à la cote 208, relever la deuxième section qui viendra prendre notre place. La section est alors divisée en trois portions : chacune étant logée à part dans une sape et fournissant son poste de garde... Pour ma part, je suis sous la route dans une sape nouvellement construite et dont le fond est empli d'eau. C'est humide au possible. Cette partie de la section fournit une sentinelle sur la route pour contrôler le passage des poilus : trois heures de nuit et deux de jour. Ce n'est pas trop dur. De plus, chaque nuit, un peu avant le lever du jour, deux poilus se détachent sous la conduite d'un caporal, faire une patrouille de liaison, jusqu'au bois du Génie, sur le bord de la Seille. Il fait un temps superbe, plutôt doux. Je peux d'ailleurs prendre la garde en veste : ce n'est pas un temps de janvier, mais nous ne pouvons que nous en féliciter... ...J'ai eu l'occasion d'avoir le Matin aujourd'hui. L'article de fond fait allusion à des préparatifs d'offensive allemande entre Metz et Strasbourg, c'est-à-dire en face de nous et il parle en même temps du débordement de la Seille et de la difficulté de la garde chez les boches, difficulté encore plus grande que chez nous ! A bien zut, alors ! ...Qu'est-ce qu'ils doivent prendre les boches... d'après le Matin ! Car si le signataire de cet article venait faire un tour par ici, il verrait que les boches ne craignent pas l'inondation, n'étant pas installés dans la vallée, mais sur les crêtes ! Ah, ces bourreurs de cranes ! Après quatre jours de séjour à la cote 208, nous regagnons Manoncourt, non plus comme patrouilleurs, mais comme postes de garde. Sept poilus à la fois : deux sur la route Manoncourt-Lixières, deux sur la route Manoncourt-Moulin de Brionne, deux sur la route Manoncourt-Quatre-Fers et enfin un autre sur la place de Manoncourt dans une guérite, prêt à faire marche le clakson en cas de gaz asphyxiants. On tient toujours. Des bruits de relèves circulent de plus en plus fort. Les tuyaux marchent bon train : on va près de Paris, au grand repos... on va instruire les américains... etc...  Le 24 janvier arrive sans qu'aucun changement ne se produise... Mais aujourd'hui, alors que nous étions en train de jouer aux cartes dans le jardin du château de Manoncourt, où nous sommes logés, l'adjudant arrive à toute allure : "Foutez-moi vos cartes en l'air, et rondement ! Montez vos sacs. Il faut être prêt à manger la soupe dans une heure et fiche le camp après !" Boum ! Où allons-nous ? Personne ne le sait. Un ordre a dû arriver sans que nous en ayons eu connaissance... Nos sacs sont vite montés : nous avons l'habitude ! On mange la soupe et aussitôt après nous caltons... Nous allons vers Clémery, et en effet, tel est le but de notre relève. La section s'installe dans une cave : celle de la première maison à gauche, en entrant dans le pays. Nous attendons un moment perplexes. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. L'adjudant est parti et ne nous a rien dit. Enfin il revient au bout d'un moment : "Vous pouvez vous déséquiper et vous coucher. Il n'y a rien à faire pour cette nuit." ...J'allume ma lampe et prépare mon lit... Ma lampe ! Une grenade offensive vide dont j'ai fait sauter le détonateur que j'ai ensuite percé avec un clou (facilement, car c'est du plomb). De la ouate dans la grenade, de l'essence, une mèche dans le détonateur et il ne reste plus qu'à visser ce dernier. Un coup de briquet et voilà de la lumière ! Plus pratique qu'une bougie, facilement transportable et qui n'est pas fragile. Le lendemain matin l'adjudant vient chercher un caporal et quatre hommes pour tenir un petit poste en avant de Clémery. Quant à nous repos complet... Voilà un mot que l'on n'avait pas entendu depuis longtemps ! Mais ce service ne dure pas longtemps : le lendemain nos cinq types reviennent. La quatrième section est chargée de les remplacer et nous nous occupons de ravitailler la première section qui est en ligne à droite de Clémery... ...Enfin ! Ca va y être... ! Aujourd'hui, dimanche, 27 janvier, nous avons appris que le 2e tirailleurs mixte venait nous relever ce soir. Cette fois c'est la relève et la bonne ! Nous ne savons si nous devons nous en réjouir ou en être fâchés, car en effet, nous quittons un bon secteur pour aller au repos, mais ensuite, où irons-nous ? Y resterons-nous longtemps à ce repos ? La belle saison ne tardera pas à venir, nous apportant son cortège d'offensives à grande puissance, d'attaques, de contre-attaques, et coups de main... Pour le moment, nous laissons aller les choses ! A huit heures, la relève terminée, la compagnie se rassemble à la cote 208 et nous filons. La marche doit se faire, en effet, par compagnie, sans s'inquiéter autrement des autres unités. A deux heures et demie du matin nous arrivons à Griscourt, où nous logeons dans une grange. Nous y sommes gelés et pas moyen de faire du feu, car nous brûlerions la paille qui est dedans. Nous y passons une journée à nous reposer, puis un sergent ayant été se plaindre, nous quittons ce lieu malsain pour une baraque Adrian. Nous y transportons de la paille et nous occupons de monter un poêle... oh ! bien rudimentaire ! Nous avons repéré au passage près d'une popote un grand récipient cylindrique empli de vieux os. A la nuit nous allons le chercher. Nous le débarrassons de son contenu dans un fossé, et revenons avec notre prise : système D... Il y a un trou circulaire en haut. Quelques coups de baïonnette dans le fond, puis une sorte de grillage à mi-hauteur avec du fil de fer et nous avons un... poêle ! 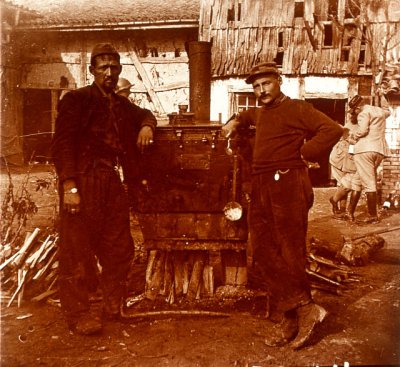 Comme outil, je possède une hachette. Je pars illico, malgré la nuit, avec un camarade, en dehors du pays, et nous abattons un petit sapin que nous ramenons près de la baraque. Nous l'ébranchons et le rentrons. Le lendemain matin, nous allons chercher une scie à la cuisine et, en deux temps et trois mouvements, nous avons notre bois prêt à flamber... Ce qui ne tarde d'ailleurs pas. En calfeutrant bien toutes les issues, nous avons une chaleur relativement suffisante... Pendant quatre jours, nous menons la vie rêvée du troupier : le repos complet ! Mais le quatrième jour, soit le premier février, déménagement à sept heures du matin, avec la Bretelle de Saint-Jacques, comme point de direction. Cet endroit est ainsi appelé, car le secteur forme là un arc de cercle. Nous logeons dans une sape de sept ou huit mètres de profondeur, mais humide... un rien ! C'est une sape neuve et l'eau nous coule sur le nez à travers les poutres. Mais il y a moyen d'y remédier. Nous sommes au milieu de pièces d'artillerie de 155, et à droite et à gauche dans le bois, se trouvent des cagnas abandonnées.  Je m'y rends et j'y trouve du carton bitumé en quantité, ainsi que des clous. Je me mets au travail, car nous avons repos toute la journée, notre travail ne commençant que le trois, et j'ai vite fait de me construire une sorte de baldaquin, qui me protège parfaitement. Ainsi que nous avions été prévenus, notre travail commence le trois février. Départ à sept heures quarante-cinq. Nous nous rendons à cinq kilomètres de là, derrière une crête; notre travail consiste à poser trois cent cinquante mètres de long sur dix de large, de réseaux de fil de fer barbelé, pour la compagnie, composée de soixante-dix équipes de deux travailleurs. A une heure la tâche est finie et nous rentrons tranquillement... Le 9 février, nouvelle qui devient habituelle maintenant. Nous déménageons demain matin. Cela m'embête rudement, car voici deux jours que je suis malade : j'ai une diarrhée épouvantable. Le lendemain matin, nous dormions profondément, lorsque des cris nous réveillent en sursaut... Nous n'avons que vingt minutes parait-il pour nous préparer, c'est-à-dire nous chausser, montre notre sac et boire le jus. L'habitude aidant, nous sommes prêts à l'heure, mais moi, j'aurais bien voulu me soulager avant le départ, chose impossible. Il est cinq heures, il fait encore nuit. Nous nous mettons en route. Mais au bout d'un moment je suis obligé de m'arrêter. Cela m'embête rudement, car nous ne sommes pas encore à Saint-Jacques et là il y a une bifurcation. Mais il n'y a pas à discuter : la nature parle. Je m'arrête donc. Lorsque je peux me remettre en route les poilus sont loin. Arrivé à la fourche de Saint-Jacques je me renseigne près de la sentinelle. Elle vient d'arriver, elle n'a rien vu... Je ne sais par où passer ! A tout hasard je prends la route de gauche. Je pense qu'en marchant bon train, je ne serai pas long à rattraper la colonne... Je marche... Je marche, toujours personne. Je fais ainsi trois ou quatre kilomètres, puis me décodant, je fais demi-tour et reviens à Saint-Jacques. Il y a une cuisine où les poilus préparent le jus. Je m'y renseigne. L'un d'eux me dit qu'il a vu passer la colonne sur la route par laquelle j'étais parti primitivement. Je m'y relance donc, décidé à la suivre jusqu'au bout. ...Enfin, me voici heureux ! J'aperçois devant moi, une colonne que je ne tarde pas à rejoindre... Zut... Flûte... Putréfaction ! C'est un autre régiment ! Néanmoins les derniers, à qui je m'adresse me disent avoir vu une colonne partir sur la droite, par une route qui monte la crête. Je m'y engage et marche toujours !... La route traverse une plaine. Pas un chat. Encore heureux que la veille au soir, j'ai entendu parler de Pont-à-Mousson et de Martin-Fontaine. Je sais donc à peu près que le régiment va vers Pont-à-Mousson. Arrivé là je me renseignerai. Je rencontre un patelin, où sont cantonnés des chasseurs. En le traversant, je me renseigne à nouveau. Personne n'a rien vu. Il est vrai qu'ils viennent de se lever. Bonne excuse, mais qui ne fait pas mon affaire ! Je suis décidé à poursuivre ma route. J'ignore totalement où je vais, il n'y a pas de poteau indicateur, nulle part. Tant pis, je verrai bien ! Je fais deux ou trois kilomètres, puis avisant un camion arrêté au bord de la route, je demande au conducteur s'il va vers Pont-à-Mousson. Sur sa réponse affirmative, me disant qu'il traverse ce pays et va à Dieulouard, je lui demande la permission de monter, permission qui m'est accordée. J'en suis heureux car voilà bien quinze kilomètres que je fais sans m'être arrêté cinq minutes... Voilà l'auto qui file. Elle me débarque au milieu de Pont-à-Mousson. Je vais voir le major de la garnison, lequel est représenté par un noble bibi de deuxième classe. Il est très gentil, mais ne peut me fournir aucun renseignement. Néanmoins en consultant un plan directeur on trouve le nom de Saint-Martin-Fontaine, placé au-dessus de Jézainville, pays qui est à deux mille cinq cent mètres de Pont-à-Mousson. Encore un effort et je repars. Je passe à Blénod, arrive à Jézainville, et enfin une heure après, je rejoins la section en haut de la crête, au camp de Saint-Martin-Fontaine, dans la forêt de Puvenelle. Je n'ai qu'une heure de retard sur les copains et pourtant ils n'ont fait que dix kilomètres, n'ayant pas pris, loin de là, le même chemin que moi. Heureusement que j'ai eu ce camion, qui m'a fait faire six kilomètres en dix minutes et m'a avancé pas mal ! L'après-midi je répare mon falzar qui en a bien besoin : les genoux, le derrière et entre les jambes... il s'en va de partout ! ...Nous sommes à quinze cents mètres seulement des premières lignes, mais comme nous sommes au milieu du bois, bien camouflés, nous sommes aussi tranquilles qu'à l'arrière... Le 11 février à midi, commence notre travail. Nous faisons des abatis, c'est-à-dire que nous plions des petits arbustes, dont nous attachons le sommet à la racine du voisin et ainsi de suite. Nous constituons ainsi une défense naturelle épatante. En semant là-dedans quelques rouleaux de barbelés il faut huit jours pour s'en sortir... à moins que l'artillerie lourde ne mette tout en pièces !... Nous devons travailler six jours sur sept. Repos le samedi après-midi pour le lavage du linge et le dimanche pour descendre au pays, si le coeur nous en dit... Telle est pendant quelque temps notre tâche quotidienne. Puis le 23, on demande trois poilus pour faire les terrassiers. Comme c'est de travail à exécuter près de la baraque, j'en suis. Je n'aurai toujours pas les trois ou quatre kilomètres à m'envoyer, pour se rendre au chantier d'abatis. Il s'agit de creuser une tranchée sur la pente est, afin de s'y réfugier en cas de bombardement... Nous sommes trois par section. La troisième est représentée par Landréat, Jobin et moi. Nous sommes à la tâche. Nous en jetons un coup et réussissons à finir les premiers.  Le lendemain, dimanche repos, et le surlendemain, nous remettons ça... Nous nous débrouillons et à midi notre tâche est finie. ...Aujourd'hui, 27, il m'a pris fantaisie d'aller au bureau consulter le tour de départ des permissionnaires. Je suis le premier à partir. S'il en rentre un aujourd'hui, je fiche le camp demain... A quatre heures, je m'installe en observation à l'entrée du camp, et mon espoir n'est pas déçu, car un poilu, musettes au coté se présente. Je partirai donc demain soir. Le lendemain, je me prépare tranquillement. Je me nettoie consciencieusement et je monte mon sac. Je me rends à Griscourt, où je passe la nuit dans l'abri réservé aux permissionnaires. Je me réveille au jour, gelé comme pas un, mais je passe avant de partir, à la roulante de la C.H.R. (compagnie hors rang). A huit heures trente, nous montons en groupe à Villers-en-Haye, le patelin qui se trouve de l'autre côté du ravin, sur une deuxième crête. Nous y attendons les camions qui doivent nous emmener à la gare du chemin de fer départemental de Meurthe-et-Moselle, de Manoncourt... Débarquement, embarquement... Nous filons sur Toul. Une heure trente d'arrêt, et en route sur Vaire-Torcy et Paris... ...Je comptais passer une permission tranquille. Ah, fichtre ! Tiens... Mais oui... Quelle erreur... que j'ai dû déchanter ! Le troisième jour que j'étais là, sirènes ! Ce sont les Gothas. Mes parents prennent leur petit banc, leurs petites affaires, moi je prends un bouquin, et nous descendons à la cave... Il s'y fait un foin là-dedans ! J'essaye de lire, mais toutes ces conversations me troublent... Les bruits du barrage parviennent jusqu'à nous. Ce sont des exclamations, des cris ! Un 75 fusant éclate pas bien loin. Aussitôt, dans la cave : "Ah, une bombe !" Si c'en était une, il se ferait secouer le pucier autrement que ça ! A la fin, ça m'énerve, j'en ai assez. Je laisse là, tout le ba-ta-clan et je vais dans la rue. Il y a un bonhomme en train de s'intéresser aux éclatements des fusants. Je fais comme lui ! Au bout d'un moment, le barrage s'apaise et les pompiers passent, sonnant la berloque... ...Deux jours plus tard, je pars, après déjeuner, avec ma mère voir une amie. Nous prenons le tramway Cours de Vincennes-Louvre, rue de Turbigo. Arrivés place de la République, nous entendons un coup sourd. Le tramway s'arrête... Nous entendons sur la place des gens crier ! les gothas ! les gothas ! Tout le monde se précipite vers la portière du tramway. Ma mère veut en faire autant : je l'oblige à rester assise : "Ne cours pas ! Rien ne presse !" lui dis-je. Lorsque tout le monde est descendu et que nous ne craignons plus la bousculade, nous descendons à notre tour. La place de la République est déjà aux trois quarts vide. Les derniers passants se précipitent vers les caves en gueulant : les avions ! Vlà les avions ! J'en vois qui regardent en l'air. Machinalement, j'en fais autant et je scrute le ciel... En me retournant, je vois un nuage immense de fumée épaisse monter au-dessus des Magasins Réunis. Voulant rassurer ma mère, je le lui montre : "Tiens, regarde ! Ce n'est sûrement pas une torpille qui a fait ça ! C'est plutôt un dépôt de munitions qui a sauté !" Ah, bien ! Moi qui croyais la tranquilliser, je n'ai pas mal réussi ! Elle n'écoute pas même mes explications, et la voilà partie en sanglots convulsifs, précurseurs d'après moi, d'une crise de nerfs... Je ne sais plus que faire, d'autant plus qu'en mettant le pied sur le trottoir, le globe d'un lampadaire électrique descend à nos pieds, de même que la vitrine d'un teinturier, en même temps que, coup sur coup, deux détonations se font entendre... Ma mère est dans tous ses états... Elle ne pense pas à elle, ni à moi, mais elle ne fait que répéter : "Mon pauvre homme !... Ma pauvre petite Daisy !... Mon pauvre homme qui est chez nous !" Et moi : "Mais ce ne sont pas les gothas ! ce ne sont pas les gothas !" Je ne me suis jamais trouvé avec une femme, dans des circonstances pareilles : je ne sais que dire ! Alors en désespoir de cause, la portant presque, je la force à descendre dans la première cave venue, me disant que ne voyant et n'entendant plus rien, elle finira pas se calmer ! Quatre ou cinq minutes plus tard, on nous annonce (de quelle manière l'ont-ils su ? Je l'ignore !) que c'est une usine du Bourget qui vient de sauter. Ma mère commençant à se calmer, nous sortons, et je l'emmène dans le premier café qui s'offre à nous. Je la fais asseoir et la force à avaler un vulnéraire, qui la remet d'aplomb... ...C'est l'usine de la Courneuve qui vient de sauter, quelques millions de grenades ont fait explosion... Nous continuons notre course et pouvons alors juger de la violence du choc : ce ne sont partout que vitrines en miettes... Avenue Ledru-Rollin, au retour, nous voyons la boutique, dont la vitrine est en morceaux grands chacun d'un centimètre carré, et pourtant, elle avait au moins un centimètre d'épaisseur ! Nous rentrons chez nous, après cette émotion, et je ne souhaite pas me retrouver avec une femme... en cas de bombardement. ...Le lendemain soir, visite des gothas ! Décidément, j'aurais eu toutes les émotions pendant ma permission... Enfin, c'est la dernière que j'ai à ressentir ! ...Le dimanche 17 mars, je quitte Paris à neuf heures trente du matin, et j'arrive le lendemain, à quatre heures de l'après-midi, au cantonnement, où j'avais laissé la compagnie quelques jours auparavant. Repos le 19, et le 20, je retourne au travail... ...Le 25, nous étions partis depuis sept heures trente, lorsqu'à midi, arrive un ordre d'alerte. Nous rentrons aux cabanes, et l'on nous dit de monter nos sacs afin d'être prêts... Mais rien ne vient, et nous nous couchons en attendant. Le lendemain matin, à quatre heures réveil, mais départ à six heures trente, seulement. Il était bien inutile de se lever si tôt ! Nous ignorons où nous allons, mais la marche sera longue, car des dispositions sont prises pour plusieurs étapes... Nous quittons la Lorraine dans un état d'esprit difficile à décrire : joie de changer d'air... ennui de marcher, peut-être longtemps... et appréhension vague, quant à l'avenir ! Combien de ceux qui partent pourront revenir ici plus tard ?... ...Enfin, tel le Juif Errant, s'enfonçant dans les Ténèbres, nous marchons... nous marchons encore... ...Quo Vadis ?... Chapitre premier. La somme. Pendant quatre jours, le régiment étale son ruban d'hommes sur la route. Nous passons nos nuits successivement à Rozières-sur-Haye, Grandmesnil, Mesnil-la-Horgne et Trouville-en-Barrois. Dans ce dernier pays nous obtenons une journée de repos. Repos, c'est beaucoup dire, car nous faisons un exercice d'attaque, à l'issue duquel le commandant Lantuéjoul nous fait un speech patriotique : "Les boches viennent d'attaquer au nord, nous allons probablement marcher d'ici peu. Mais en attendant ne vous en faites pas ! On les aura ! Vive la France et mort aux boches !" Ce cri résonne longtemps dans notre tête car il est l'indice d'un espoir foi, irréalisable nous semble-t-il, puisque, d'après les journaux, les boches marchent comme ils veulent. Enfin, le lendemain matin, nous remettons ça. Nous poursuivons notre route à raison de vingt-cinq à trente kilomètres par jour... Nous nous reposons tour à tour à Beuray (un pays où le 155 a cantonné en juillet 1917) où nous passons deux jours de repos, puis à Saint-Eulien... En arrivant dans ce dernier pays nous nous dirigeons vers la gare... Nous embarquons en wagons à bestiaux et en route vers cinq heures... Nous roulons toute la nuit et à six heures le lendemain matin, nous débarquons à Verberie, derrière Compiègne. De là, en suivant la grand'route Paris-Compiègne, nous gagnons la Croix-Saint-Ouen, où nous devons passer la nuit. Le lendemain à midi, nous faisons treize kilomètres pour gagner Rémy... Nous passons la nuit tranquille, et, au jour rassemblement en tenue d'exercice... Quelques camions sont là. Nous y montons et partons faire un exercice d'attaque avec les tanks.  Nous rentrons ensuite à Rémy. Le lendemain matin, départ et point de direction : Sant-Just-en-Chaussée. Une heure de pause et remise en marche. Enfin, arrêt définitif dans une ferme au-dessus de Plainval. Nous y profitons d'une journée de repos. Je suis appelé au bureau pour donner un coup de main à arrêter les livrets de pécule, qui sont ensuite délivrés à leurs propriétaires. Le 10 avril, départ à sept heures trente. Nous faisons six kilomètres et une grand'halte à Sains-Morainvillers, situé en avant de Montdidier, occupé actuellement par les boches. Au moment où nous sommes près d'arriver, un avion boche passe au-dessus de nous et à l'aide d'un jeu de fumée artificielle suit les sinuosités de la route... Nous avons l'intuition que nous allons prendre quelque chose... Mais rien ne vient et nous poursuivons tranquillement notre route. Après avoir mangé notre soupe, nous nous remettons en route et faisons encore quatre kilomètres. Nous sommes alors en plaine : des trous de tirailleurs sont creusés à droite et ç gauche. Je remplace Jobin, permissionnaire, comme premier pourvoyeur et je suis en équipe avec Dubois et Blin... Nous héritons d'un trou pour nous trois : ceux qui étaient là avant nous se sont bien débrouillés, car ils ont recouvert le trou avec des portes et ça nous fait une sorte d'abri, sous lequel nous sommes très bien. Nous sommes là à ne rien faire, nous n'avons qu'à regarder ce qui se passe... Nous voyons devant nous, la ville de Montdidier au fond de la plaine, et plus près, un peu à gauche, un petit patelin. La cannonnade tape un peu, surtout que derrière nous, dans un boqueteau, se trouve une pièce d'artillerie lourde... Nous passons une nuit tranquille. Le lendemain, dans l'après-midi, le temps étant superbe, les avions sont sortis nombreux. Au-dessus de Montdidier, nous en voyons une demi-douzaine de chez nous, formant une ligne. Au-dessus d'eux, à leur légèreté de marche, nous reconnaissons des avions de chasse... Puis brusquement, la scène change : nous aéros ont fait demi-tour, puis se disposent à une manoeuvre, voulant former, semble-t-il, une sorte de pince, et, en faisant plus attention, nous distinguons un autre avion qui se replie devant cette ligne, montant, descendant, tournant, cherchant à s'échapper : un boche voulant regagner ses lignes, mais la ligne d'avions français lui barre la route... Alors d'un seul coup, l'aéro qui planait au-dessus de cette scène, descend et par un virage, arrive derrière le boche... Quelques coups de mitrailleuses... L'avion ennemi prend feu et descend en tournoyant...  Le lendemain, nous apprenons qu'il s'agissait d'une victoire de Fonck, le successeur de Buynemer. L'après-midi se passe paisiblement. La nuit vient, aussi tranquille que la précédente, quant à notre travail. Mais au point de vue artillerie ce fut plus intense : les lignes devant nous ne cessèrent de s'illuminer de fusées rouges, vertes, jaunes, blanches à une ou plusieurs étoiles, le tout accompagné de tir d'artillerie. C'était très joli... Le lendemain matin, 12 Avril, à sept heures, en plein jour, par conséquent, nous sommes relevés par la deuxième compagnie et nous nous rendons à Sains-Morainvillers pour y passer la journée et la nuit... En arrivant dans le pays nous avons encore l'occasion de voir deux avions aux prises : le français tournoie au-dessus du boche, qui descend en feuille morte et qui va s'abattre derrière un bois, nous cachant ainsi la fin du drame... Une demi-heure plus tard, nous voyons passer les deux officiers boches, sur une civière, tous deux blessés sérieusement, parait-il. Le lendemain matin, une heure de marche et nous arrivons à Gannes. La maison que nous habitons, est occupée par une vieille femme et ses deux petits-fils. Les anglais, en battant en retraite, ont pillé les meubles et vidé les armoires, malgré la présence de ces trois personnes. D'ailleurs, dans le pays, nous trouvons des traces du passage des Anglais : des vêtements, des armes, des munitions traînent ça et là. Il y a même sur le bord de la route, un camion de munitions d'artillerie, abandonné là : des obus tout chargés et prêts à partir le garnissent; ce n'est plus une retraite, c'est une débandade ! Heureusement que les Français sont venus ! ...Nous y restons deux jours que nous passons à faire l'exercice, en piétinant les récoltes, en foulant indifféremment le blé, l'avoine, le seigle, etc... Les paysans doivent nous bénir. Quant à nous nous n'avons rien à dire : c'est l'ordre du lieutenant-colonel Lequeux, commandant le 155e régiment d'infanterie; une belle figure d'abruti, soit dit en passant... Le 19 avril, à quatre heures trente, réveil en sursaut. Nous repartons pour aller à Lavarde-Mauger, distant d'une vingtaine de kilomètres, environ. Nous y arrivons vers deux heures du soir. ...En cours de route, nous avons traversé les villages de Bacouel, Breteuil et Paillard... A la sortie de ce dernier pays, nous faisons la grand'halte... De l'autre coté de la route, s'alignent une dizaine de tombes fraîches, commencement d'un cimetière que l'on fait pour les morts de l'hôpital installé à Paillard. ...En attendant la roulante, nous allons voir les inscriptions et j'ai la surprise de trouver un nom connu, sur la deuxième croix de bois : Faille André. C'est un petit gars de la classe 1917, que j'ai eu avec moi au 164 et au bataillon de marche du 155 à Baudricourt. Je savais qu'il était au 355, mais je ne m'attendais pas à le trouver sous ce tumulus... ...Cela m'a causé une surprise douloureuse, mais l'insouciance faisant le fond de mon caractère, ça ne m'a pas empêché de manger ma soupe avec appétit, dès l'arrivée des bouzines. ...Nous restons quelques jours à Lavarde-Mauger, occupés à travailler au nettoyage des routes, des bêtises destinées à nous faire passer le temps. Le 24 avril, à onze heures trente du matin, nous venions de manger la soupe, lorsque l'adjudant Jayet, notre chef de section, arrive en coup de vent : "Montez vos sacs en vitesse... Défense de sortir, le cantonnement est consigné." Heureusement que nous sommes habitués à ces sortes d'alertes, sans quoi ça pourrait nous causer une forte émotion... Nous exécutons l'ordre donné, et attendons. Mais comme il y a un mois, à Saint-Martin-Fontaine, rien ne vient. Le soir, nous démontons nos sacs et allons nous coucher. A quatre heures du matin, le poilu de jus nous réveille à grand renfort de beuglements, en nous annonçant le départ pour cinq heures. A l'heure dite, nous démarrons. Encore une douzaine de kilomètres à faire à pinces et nous voici à Estrées-Noyes. Mais le pays est petit et les hommes nombreux. Il n'y a pas de places pour tout le monde. La section doit coucher à la belle étoile, sous les tentes, dans le jardin d'une maison. Nous nous réunissons à quatre et nous montons notre cabane. Puis, nous partons visiter le pays... En revenant de faire notre tour, nous voyons sur la place une compagnie du premier bataillon en tenue de départ. Nous nous informons auprès des poilus, qui nous apprennent que nous déménageons. Nous piquons alors un fameux pas gymnastique vers notre gourbi de toile. La section est déjà presque prête. Nous arrachons notre tente et à toute allure, nous montons nos sacs. C'est ce qui s'appelle opérer en vitesse. Enfin, nous réussissons à être prêts presqu'en même temps que les copains. Jobin est rentré de permission et a repris sa place de premier pourvoyeur. Je suis donc redevenu simple grenadier-voltigeur, armé du fusil. Le déménagement a pour cause l'exiguïté du logement et par conséquent, la facilité, pour les avions boches de repérer les tentes groupées autour du pays. Aussi allons-nous les réinstaller dans un bois, à douze ou quinze cent mètres d'Estrées. Nous nous mettons à quatre et montons notre gourbi comme nous l'avions fait auparavant. Mais ça dérange le juteux qui veut que l'on se mette par escouade. Nous sommes obligés de redémonter notre ouvrage, mais comme mon escouade., la dixième, a déjà construit sa maison et que les poilus ne marchent pas pour remettre ça, ça me fout en rogne et je laisse tout en plan, avec l'espoir de trouver autre chose. J'avise un peu plus loin une grande voiture, elle constituera mon abri. A la nuit, je prends mon sac et mes couvertures et je m'allonge dessous, la tête sur le sac comme oreiller et bien enveloppé. Mais je suis long à m'endormir, car le bois est farci de pièces d'artillerie qui tirent sans arrêt et, naturellement, font un vacarme de tous les diables. Enfin, la fatigue a raison de moi et je m'endors du sommeil du bienheureux... Mais il fait à peine jour que je me réveille gelé, transi, engourdi et mouillé des pieds à la tête. Il a plu toute la nuit, et le terrain étant en déclivité, l'eau a coulé, trempant mes couvertures, et moi, par dessus le marché. Je fais un peu de marche pour me réchauffer, puis je vais voir le cuistot qui est en train de faire son feu pour chauffer son jus, dont j'avale un grand quart sitôt prêt. Une cigarette là-dessus et me voilà retapé. Si je pouvais me débarbouiller, ça me ferait du bien, mais il n'y faut pas songer, il n'y a pas d'eau, et je n'ose pas m'éloigner, de peur qu'un ordre arrive pendant ce temps. J'aurais pu néanmoins y aller car cet ordre n'arrive à quatre heures de l'après-midi. Nous montons nos sacs et nous allons chercher une journée supplémentaire de vivres de réserve et à sept heures, en route. Nous montons en ligne dans la Somme, secteur d'Hangard-en-Santerre, le vendredi, 26 avril. Nous parcourons les premiers kilomètres tranquillement... Mais à un moment, la route longe une pente et les boches bombardent le haut de la crête. On voit parmi les lueurs d'éclatement des poilus qui se sauvent, d'autres qui descendent, enfin d'autres qui montent. Puis le tir s'allonge et les boches bombardent un pays dans le fond : les obus passent en sifflant au-dessus de nos têtes et vont éclater autour du pays, quelques-uns vont au but. Nous marchons toujours. Chemin faisant, nous croisons une relève d'anglais, cigarettes au bec, et chantant Tippérary. Les boches ne tirent pas dessus, c'est plutôt bizarre. Si nous faisions une relève dans de semblables conditions, qu'est-ce que nous dégusterions ? Mais nous arrivons bientôt à proximité des lignes, nous sommes alors obligés de mettre nos masques, car les Frigolins balancent quelque chose comme obus à gaz. Pour arriver au point terminus de notre relève, nous devrions traverser deux villages : Domart et Hourges, l'un suivant l'autre et séparés l'un de l'autre par une centaine de mètres. Mais ils sont en train de déguster quelque chose et les gros noirs rappliquent dur et ferme. Impossible de passer : on recevrait une maison sur la tête !... Nous ne pouvons pas couper au court : il y a un grand marais entre les lignes et nous, du coté droit des pays. Il n'y a que le coté gauche qui soit libre... libre est une façon de parler, car les obus tombent un peu partout. Mais enfin, nous avons le terrain ferme et ce n'est pas repéré comme les pays. Nous obliquons donc à gauche et, en faisant un grand détour nous venons devant Hourges, pays dans lequel doit s'installer le P.C. du capitaine et devant les dernières maisons duquel passent les tranchées. Nous prenons contact avec les poilus du 7e régiment d'infanterie. La demi-section s'installe en partie derrière un grand tas de betteraves dans lequel a été creusée une sorte de fosse, de la même longueur que le tas de légumes, large de un mètre cinquante et profonde de un mètre, à peine. Heureusement que le tas est surélevé devant nous, sans quoi nos jambes seuls, seraient cachées... Le restant de la demi-section est dans un petit élément de tranchée contournant une meule de paille. Le tout est réuni par un commencement de boyau qui a à peine quarante centimètres de profondeur et qui se prolonge vers la droite, où en certains points il a environ un mètre cinquante, constituant ainsi une tranchée de première ligne.  Je ne crois pas que ce coin soit bien le filon. La première maison du pays où se trouve le P.C. du capitaine est à une cinquantaine de mètres à notre gauche, un peu en arrière. Devant nous, une crête boisée s'étend à environ six ou sept cents mètres... Là sont les lignes boches. Les poilus du 7e nous disent que les boches n'ont jamais envoyé de magoniaux dans ce coin, que nous serons tranquilles... Enfin, ils croient nous rassurer et... fichent le camp vers l'arrière... Nous examinons alors notre trou plus attentivement : ce n'est rien de fameux ! Comme grenadier-voltigeur, je me colle au bout de la tranchée, du coté du pays. Là, il ne va pas plus loin. La ligne est interrompue et devant Hourges ce sont des trous de tirailleurs, distants l'un de l'autre de trois ou quatre mètres... Un gars de la compagnie relevée a sapé la terre à l'endroit où je me trouve et formé ainsi une sorte de niche pouvant tenir un poilu allongé... Mais il y a bien cinquante ou soixante centimètres de terre au-dessus de soi et cette terre ne me parait pas bien solide, car il n'y a naturellement aucun étai, rien qui puisse la soutenir... Enfin, il n'y a rien à craindre puisque c'est le coin tranquille ! Je colle donc toutes mes affaires dans ce coin, après avoir démonté mon sac, puis je prends la garde comme les copains. Il n'y a qu'à regarder en passant la tête au-dessus de nos betteraves. Enfin, la nuit passe et sitôt le petit jour venu, je me glisse dans mon trou où je ne tarde pas à m'endormir d'un sommeil lourd car je suis bien fatigué... ...Je ne sais pas s'il y a bien longtemps que je dors, lorsque je me réveille en sursaut... Il me semble vaguement qu'il se passe quelque chose de pas ordinaire... En me réveillant, je me sens une envie d'uriner, pas ordinaire... Je sors alors de mon trou, afin de faire dans une gamelle destinée à cet usage, lorsqu'un bruit de locomotive en marche, me fait baisser la tête... C'est un 210... J'ai l'impression, dans le sifflement de la chute qu'il est pour nous... Il s'abat à cinq ou six mètres derrière nous, faisant un entonnoir énorme, et projetant la terre de tous les cotés... En même temps... vlan !... voilà ma cagna qui s'écroule, ensevelissant mon sac, mes couvertures, mon outil portatif et mes musettes sous deux ou trois mètres cubes de terre... Eh bien, à cet instant, je remercie mon envie de pisser... Sans elle, je serais enterré et comme il faut !... ...Mais je n'ai pas le temps de me désoler sur la perte de mon fourbi qu'un deuxième sifflement annonce son obus... Vlan ! encore un !... En plein sur la meule de paille !... Les bottes voltigent à droite et à gauche, et en place du bel édifice qui se dressait là, il ne reste plus que de la paille semée sur un rayon de cinquante mètres !... Nous pensons alors aux poilus qui étaient derrière... Qu'est-ce qu'ils ont dû prendre !... Mais les 210 rappliquent toujours... Il en éclate un autre près de notre trou... Nous nous concertons alors avec deux autres poilus de l'escouade : Mulé et Noël : "On va pas rester là à se faire buter ! Il faut trouver moyen de se tirer des flûtes !" Oui, mais par où partir ? Du coté où je suis la tranchée s'arrête, et à l'autre bout elle n'a que quarante centimètres !... Ma foi, nous nous décidons à tenter la chance, et voyant que le tir ne s'arrête pas, nous faisons un bond hors de la tranchée et nous filons vers le pays ! Nous faisons le tour d'une maison et voyant une entrée de cave, nous y descendons... Elle est assez profonde, l'escalier est bon, en maçonnerie, mais la cave elle-même n'est pas achevée : elle ne forme qu'un trou sans maçonnerie, ni étai et où l'on ne tient qu'à trois ou quatre hommes couchés. Nous l'adoptons néanmoins et y passons la journée... A la tombée de la nuit nous regagnons tous trois notre trou. En arrivant, nous apprenons ce qui s'est passé : un poilu, Le Ray, qui logeait derrière la meule de paille, curieux de voir ce que faisaient les boches, s'était montré à découvert... Les boches croyant que cette meule cache un nid de mitrailleuse, tirent... Résultat : cinq poilus enterrés par l'obus qui est tombé dessus... On a réussi à en tirer trois... Mais Neveu et Meslet sont restés dessous... D'où, par l'imprudence d'un imbécile, on a deux morts à déplorer... Sitôt rentré dans mon trou, je m'arme d'une pelle et je me mets en devoir de déblayer l'amoncellement de terre qui se trouve sur mes affaires, et ce n'est qu'au bout d'une heure de travail que je réussis à retirer mon sac, puis ma toile de tente et mes couvertures, et, enfin, mes musettes. Quant à mon fusil, pas moyen de le retrouver... Il reste où il est. J'en trouverai un autre... A dix heures, je pars à la corvée de soupe. Nous sommes quatre pour la section, un homme par escouade : Paillard, pour la neuvième, Dubois pour la dixième, Giacobetti pour la onzième et mois, pour la douzième. Nous nous rendons tout d'abord au P.C. du lieutenant, où doit s'opérer le rassemblement des hommes de corvée pour la compagnie... Chemin faisant, nous voyons les brancardiers qui emmènent le corps de Meslet que l'on vient de déterrer... Nous arrivons à la cagna, où le fourrier Roqueplo, nous dit d'attendre les représentants de la quatrième section qui ne sont pas encore là... Nous allons pour nous mettre en route, dès que la corvée est rassemblée, lorsque les boches se mettent à bombarder Domart Roqueplo, jugeant que nous ne sommes pas à deux minutes près, nous fait descendre dans la cave afin d'y attendre un moment, qu'il y ait une accalmie. Enfin, au bout d'un moment comme le tir se ralentit, nous prenons le départ... Entre Hourges et Domart, nous avons environ cent cinquante mètres à parcourir à découvert... Mais à peine étions-nous engagés sur ce morceau de roue, qu'un projecteur s'allume, dont la lueur vient balayer l'endroit où nous nous trouvons, en même temps qu'une mitrailleuse se met à cracher, et certainement, les deux engins sont réglés l'un sur l'autre, car les balles suivent le rayon de lumière... Nous nous sommes mis à plat ventre, puis, en rampant, nous gagnons le coté opposé de la route et celle-ci se trouvant en remblai, nous nous trouvons un peu à l'abri. Dès que le projecteur a cessé de nous éclairer, nous reprenons notre route. Nous traversons Domart, accompagnés tout le long, par les sifflements et les éclatements des 88 qui tombent sur, et autour des maisons. Mais par bonheur il n'en tombe pas sur la route. Le malheureux patelin ! qu'est-ce qu'il a dégusté ! Il n'y a déjà plus une maison intacte, et bien certainement il y en a bien les trois quarts qui sont à plat. Enfin, nous sortons du pays sans incident, et nous continuons notre chemin sur la route. Nous faisons environ trois kilomètres puis nous tournons à gauche, à un carrefour qui doit être bien sonné, à en juger par les huit ou dix bourrins qui sont étendus là. Les roulantes viennent tout juste d'arriver. Nous nous approchons de la notre et nous nous appelons pour nous rassembler par section... J'appelle Dubois qui me répond de suite. Sitôt réunis nous voulons appeler Paillard et Giacobetti, mais pas de réponse : "Tu vas voir qu'ils ont foutu le camp ! me dit Dubois. - Penses-tu, ils sont blessés plutôt. - Oh ! tu sais, je n'ai guère confiance en Giacobetti, et, quant à Paillard, c'est un vieux, il est à moitié excusable. - Bah, nous verrons bien en arrivant. Mais le hic c'est pour emporter la bectance !" En effet, nous n'avons à nous deux que deux bouteillons. Encore heureux que nous ayons chacun notre toile de tente et quelques bidons : "Enfin, dis-je à Dubois, on va se démerder pour en emporter le plus possible !" Nous commençons par prendre le pain et les casse-croûtes. Puis, nous faisons remplir nos bidons avec le pinard. Quand nous avons pris tout notre vin pour la section, il ne nous reste plus que deux ou trois bidons, c'est-à-dire un compte insuffisant pour emporter tout le jus. Nous faisons néanmoins remplir ce que nous avons de disponible et nous prenons notre viande. Comme il y en a deux morceaux par poilu, nous ne pouvons pas prendre beaucoup de légumes. Nous pressons le tout avec nos mains pour en faire entrer le plus possible : si la Duchesse de Broglie nous voyait, certainement la brave femme serait dégoûtée ! Enfin, nous nous chargeons et lorsque nous sommes prêts à partir, nous avons à porter chacun le ravitaillement pour dix-huit poilus, soit neuf boules de pain, de multiples boites de conserves, une dizaine de bidons et enfin un bouteillon de cinq litres archi-plein de viande et de légumes. Au bout d'un kilomètre, nous ne pouvons souffler : les courroies des bidons nous pressent la poitrine et la toile de tente passée en sautoir, nous étrangle... Nous marchons quand même. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui me manque de me reposer un peu. Mais je pense aux copains qui attendent impatiemment le becqueter et je file... C'est déjà suffisant que nous n'ayons pas tout, et je pense à la tête de nos zigoteaux quand ils vont savoir qu'il y a, à peine, un quart de jus par poilu et presque pas de légumes. Enfin, ce n'est pas de notre faute, nous avons fait ce que nous avons pu et c'est déjà bien gentil de notre part d'avoir pris tout le pinard, tout le pain et tous les casse-croûtes Nous retraversons Domart, que les boches ont cessé momentanément de bombarder, puis Hourges, et à la cagna du lieutenant, le cortège se dissout, chaque groupe se dirigeant vers l'emplacement de sa section respective. Dubois et moi, nous dirigeons vers l'endroit où le juteux a installé son abri. Il fait assez sombre, et de la tranchée, on ne distingue que vaguement nos silhouettes. L'adjudant, apercevant des bouteillons au bout de nos bras, nous reconnaît néanmoins : "Eh bien, d'où venez-vous ? Puisqu'il n'y a pas ravitaillement vous ne pouvez pas rentrer avec vos camarades ? - Comment, lui dis-je, il n'y a pas ravitaillement ? Eh bien, et ce que nous avons sur le dos, vous croyez que ça ne se mangera pas ?" En, en même temps, nous nous déchargeons. Il n'en revient pas : "Comment, mais Giacobetti et Paillard sont rentrés, il y a longtemps, en nous disant qu'il n'y a pas ravitaillement ! - Oh ! C'est bien simple. Comme ça bombardait, ils sont revenus, ils ont eu les jetons, et nous nous sommes tout envoyé avec Dubois. Oh ! Ce sont de bons copains ! Mais, vous savez, mon adjudant, ils mériteraient qu'on ne donne rien du tout à leur demi-section et qu'ils reçoivent une bonne raclée de leurs copains; ça leur servirait de leçon." J'étais en rogne, de m'être envoyé trente-cinq kilos sur le dos, pendant cinq kilomètres, par la faute de deux fainéants, qui avaient reculé, en voyant un bombardement à deux kilomètres de là. Mais, en cet endroit les colères tombent vite, et une fois la tambouille avalée, je n'y pense plus. Je prends ma garde tranquillement et dès le petit jour, je me renfonce dans mon trou... Mais vers neuf heures, nouveau réveil en sursaut... Les artilleurs boches recommencent à s'amuser : les 210 rappliquent à nouveau... Nous n'attendons pas bien longtemps, et, voyant qu'ils semblent en vouloir au tas de betteraves, nous faisons, les trois mêmes que la veille, la même manoeuvre... Nous retournons dans la cave... Mais, Messieurs les Frigolins ont dû nous voir, car voilà qu'un gros noir siffle... et vient s'abattre à une trentaine de mètres de la maison... un deuxième arrive et éclate à coté de l'entrée de la cave... et, enfin, un troisième... au but... L'escalier se remplit instantanément de fumée, de poussière... des briques dégringolent dans la cave... et il y fait noir comme dans un four... J'ai l'impression que l'obus a dû tomber en plein sur l'entrée... faire tout ébouler... et que nous sommes enterrés là-dedans... Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de faire connaître mon impression aux deux autres : "Ce coup-ci, nous sommes foutus." leur dis-je. Mais au bout de deux minutes, nous nous rassurons en voyant un petit carré de jour apparaître... La fumée de l'explosion se dissipe et nous voyons alors que l'escalier de la cave n'a pas souffert... Mais nous craignons que le boches ne remettent ça, et réussissent mieux leur coup... Aussi, dès que nous pouvons sortir librement, nous filons... Nous voyons alors que l'obus est tombé sur la maison. Elle était à deux étages et presque intacte. Maintenant il n'y en a plus qu'un : le grenier est venu tomber sur le lit du rez-de-chaussée. Quelle destruction ! Les artilleurs ennemis doivent être contents ! Mais nous ne perdons pas de temps à examiner en détail ce tableau, et nous filons au pas de course nous rejeter dans notre trou. Nous racontons aux rares copains restés là, ce qui vient de nous arriver, et comme le tir sur le tas de betteraves a cessé, nous comptons bien passer une journée tranquille... Elle continue de cette façon, jusqu'à cinq heures du soir, environ. Mais à ce moment, d'un seul coup, un barrage terrible, se déclenche, et ils nous ont bien repérés, car les 88 éclatent juste à hauteur de la ligne de défense. Dans notre coin, ils rasent les betteraves, et plus d'une fois, nous en recevons une sur la tête... Ils éclatent sur le parapet du coté opposé, à un mètre du bord ! Nous nous blottissons au fond du trou. Garnier et Brisse, eux, ont une espèce de petit abri qui les protège des éclats et même peut-être d'un 88, car il y a pas mal de terre dessus, et comme ces obus sont à fusée très sensible, certainement ils éclateraient avant de traverser. Aussi leur est-il facile de donner des ordres : "Veillez... Veillez... Regardez si les boches viennent !..." Un poilu passe la tête de temps en temps, mais il n'y reste pas bien longtemps. D'ailleurs avec la fumée on ne distingue rien, et ce n'est guère agréable d'avoir le crane près du parapet, lorsqu'un 88 vient éternuer à coté !... Garnier s'en prend à un poilu : "Roland, regarde si tu vois quelque chose... veille ! Bon dieu !!" Roland, un type de la dixième escouade se laisse asticoter une fois ou deux, puis il envoie promener Garnier le plus carrément du monde : "Tu me fais chier, à la fin !... Veille si tu veux !... Moi, je m'en fous... si les boches viennent, eh bien, on sera fait et vlà tout !..." Ses paroles résument l'état d'esprit général... Nous sommes esquintés par la longue marche que nous avons faite avant de monter en ligne, et par les deux bombardements du matin. Nous sommes tous de son avis, si les boches viennent, nous nous rendons sans rouspéter... Un poilu, même, a déjà commencé à se déséquiper !... Mais au bout d'un quart d'heure, le tir de barrage se ralentit, puis cesse totalement... Nous regardons... rien ne vient... fausse alerte... Un quart d'heure seulement... Il nous semble que ce sont des heures qui viennent de s'écouler !... A la nuit Brisse m'apporte un revolver, celui de Neveu, qu'il a pris dans son étui. Je trouve un fusil à peu près propre dans la tranchée, me voilà remonté. Je pars à la onzième escouade, à l'équipe Verdier, comme deuxième pourvoyeur, en remplacement de Meslet.  Nous avions été bien servis pour nos deux premiers jours de ligne...! Secteur tranquille !! Nous tenons pendant neuf jours dans ce coin. D'ailleurs les sept derniers se sont passés à peu près tranquilles... Quelques avions dans le jour... un petit bombardement, un matin, et c'est tout. ...Une nuit que j'étais de ravitaillement, nous étions partis tranquillement et nous croyons être en retard, mais surprise ! Les roulantes n'arrivèrent qu'au bout d'un long moment... Tout en déchargeant leurs sacs, les cuistots nous racontèrent qu'ils avaient été sonnés en passant un coin de route; qu'un obus était tombé près de la voiturette à mitrailleuse, transportant le pain et le vin, renversant le tout... Le tonneau de pinard s'était à moitié vidé, et au lieu de trois quarts que nous aurions dû toucher, nous n'en aurions qu'un. Mais cela nous touche moins que la blessure du caporal d'ordinaire, Uyttersprot, qui a reçu un petit éclat d'obus à la cuisse... Tels sont les seuls incidents qui nous distraient pendant notre neuvaine... Enfin, dans la nuit du 5 au 6 mai, date anniversaire de ma blessure, nous sommes relevés et nous filons à Berteaucourt-les-Thennes, en réserve de régiment. Deux bataillons sont en lignes devant Hourges et devant Thennes, et le troisième bataillon, en réserve à Berteaucourt. Le premier et le troisième se relèvent tour à tour, devant Hourges et le deuxième fait sa relève par compagnie, devant Thennes et ces relèves, tous les neufs jours. Sitôt installé dans une cave, je pars avec les copains, pour le ravitaillement. Ici, il est moins loin, à quinze cent mètres. La distribution se passe sans incident et nous rentrons casser la croûte dans notre cave. Nous passons une journée tranquilles et le soir venu, nous partons au travail : ce n'est guère agréable. Il faut aller au carrefour, où se faisait le ravitaillement alors que nous étions en ligne... Il y a là une dizaine de chevaux tués, depuis plusieurs jours, déjà, et on a attendu spécialement, la première compagnie pour les faire enterrer. Nous avons pour la section, deux fosses à creuser pour enterrer deux des carcans... Pour que le travail aille plus vite, nous faisons notre trou contre le dos du bestiau, de telle sorte, qu'il n'y ait, le travail achevé, qu'à faire tourner le bourrin, et il tombe ainsi, d'un seul coup, dans son trou. Cela nous évite de le traîner quelques mètres. D'ailleurs ça nous serait peut-être, impossible : en tirant sur une patte, elle nous resterait dans la main, car ils sont plutôt faisandés ! Nous en jetons un coup, la proximité de ces cadavres en putréfaction, nous y incite afin d'en être débarrassé en vitesse ! A onze heures nous avons fini et nous rentrons à Berteaucourt, où nous mangeons la soupe, car deux poilus de la section restent là la nuit pour le ravitaillement.  La nuit suivante, nous montons sur la crête, au-dessus du cimetière de Berteaucourt pour commencer à creuser un boyau. Nous sommes toujours à la tâche, aussi nous dégrouillons-nous de manière à être rentrés pour minuit au plus tard. Dans le jour, nous nous levons vers dix ou onze heures et nous faisons des manilles à n'en plus finir... toujours dans notre cave, car l'extérieur nous est interdit en plein jour. La nuit du 8 au 9 mai se passe tranquille pour moi, car au lieu d'aller travailler, je pars au ravitaillement avec un copain, ce qui demande moins de temps. Sitôt que nous avons touché notre nécessaire, nous rentrons en vitesse à notre gourbi, y attendre la rentrée des poilus tout en fumant une cigarette. La nuit suivante, repos pour tout le monde. Encore une bonne journée à tirer à ne rien faire ! Elle nous parait longue, nous étant levés de bonne heure, frais et dispos de notre nuit entière à rouspiller. Les boches deviennent nerveux. Ils s'en prennent maintenant au pays. Des bombardements de temps en temps, par 105 et 150... Les sorties de nuit deviennent dangereuses même et il faut faire vite lorsqu'on va au travail... Ils sont du repérer quelqu'allée et venue dans le patelin et ils se doutent qu'il y a quelqu'un dedans.  La nuit suivante, cinq poilus sont détachés par section, pour l'enterrement des bourrins. Nous filons au carrefour et activons la besogne. Notre carcan se trouve juste sur le bord de la route, et c'est bien embêtant car elle est prise d'enfilade par les batteries boches... qui en profitent... ces rosses-là ! On veut faire vite, mais nous n'y réussissons pas, car nous étions occupés de faire descendre notre grand cadavre dans le trou quand brutalement, quatre magoniaux viennent s'aligner sur et à coté de la route. Nous nous jetons dans notre trou en nous y faisant le plus petit possible... Encore heureux que ces messieurs d'en face n'aient pas attendu que l'on ait comblé, car je ne sais trop où nous nous serions fourrés. Les obus continuent à tomber dur, puis le tir se ralentit au bout de cinq minutes... Puis cette tout à fait... un tir de surprise inefficace, espérons-le ! L'adjudant rassemble ses vingt poilus, puis fait l'appel. On s'aperçoit alors qu'il y a un manquant : Mathurin, de la première section. Nous nous mettons à sa recherche, et le retrouvons au bout d'un moment dans le fossé de la route, râlant... il n'en a plus pour longtemps... Gonnord veut lui faire un pansement, mais à peine a-t-il trouvé son paquet, qu'il devient inutile, car le pauvre diable vient de rendre le dernier soupir... Nous laissons là notre boulot et emmenant Mathurin, nous reprenons le chemin du retour, bien tristement... En effet cela nous fait quelque chose de penser que ce pauvre diable est mort en enterrant des chevaux crevés... Se faire tuer en rendant service à un copain, c'est très joli... mais en faisant une corvée aussi bête, c'est trop pénible... Enfin, tant pis : c'est malheureux, mais il n'y a rien à faire. La Destinée est là qui veille sur nous !... Nous apprenons en rentrant que les fritz ont bombardé le patelin et que les gaz commencent à produire leur petit effet. Il y a parait-il, plus de cent vingt malades au bataillon ! Chez nous ça va à peu près : personne ne se plaint pour le moment. Le travail continue. La nuit suivant la mort de Mathurin, j'ai été au ravitaillement, et pour rentrer, il nous a fallu faire un grand détour, les boches étant dans un moment de mauvaise humeur, et bombardaient le pays. Nous rentrons malgré ça sans aucun mal. La nuit d'après je vais au cimetière, au travail... La vie commence à devenir intenable dans Berteaucourt. A tous moments du jour et de la nuit les frigolins bombardent tant et plus, avec les calibres dont ils disposent. Le matin du 14 mai, en se réveillant quelques poilus se plaignent de maux de tête. Moi, je ne ressens rien. Le plus malheureux, semble-t-il est Pihan, le cabot de la douzième. Il ne fait que geindre, il a d'ailleurs très mauvaise mine. Aussi vers deux heures, comme il se plaint de plus en plus je pars avec lui en rasant les murs, afin de l'accompagner jusqu'au poste de secours, puis je rentre en vitesse. Mais à peine suis-je redescendu dans la cave, qu'un mal de tête fou me prend et que je me mets à rendre tripes et boyaux devant la porte de la cagna... boum ! ça y est me voici pris à mon tour !... Le soir même, je me fais porter malade : on me prend ma température : 38°9. Le toubib me met exempt de service. Pihan et Giacobetti sont évacués. Je retourne me coucher dans mon gourbi. Il n'y a plus que deux poilus dans la cave qui soient à peu près bien portants. Ils vont à la corvée de soupe et en rentrant, engloutissant, à eux deux, tout le pinard qu'ils ont touché et que nous ne voulons pas. Aussi après ce coup-là sont-ils saouls à ravir ! Si le vin immunise, ils n'ont rien à craindre, ils ne seront pas malades ! Le lendemain, comme ça ne va pas mieux, je retourne voir le major avec trois autres poilus de la cagna. Il nous évacue tous quatre. Nous revenons chercher nos affaires, car nous devons tout emporter en partant... Vers onze heures, une petite automobile américaine de la croix-rouge, nous emmène à toute vitesse, jusqu'à Bauve, où nous laissons notre barda, ne gardant que nos affaires personnelles. Cela me rappelle ma première évacuation et je me vois déjà dans le train, en route vers Paris ! De Bauve, une grande voiture à deux chevaux nous conduit à Sains-en-Amiennois, où se tient l'ambulance divisionnaire. On me fait entrer dans une grande tente de la croix-rouge, où un infirmier m'affecte un lit. Je passe une bonne nuit tranquille. Vers neuf heures, le major passe : "Quinine et antipyrine !" Certainement, ça va me remettre d'aplomb ! J'aimerais mieux un bon beefsteack, car quoique ayant de la fièvre, je sens l'appétit me tortiller l'estomac. Dans la journée, je me lève et, dans le jardin où est établie notre ambulance, je retrouve Pihan et Corrier (ce dernier était dans ma cave et a été évacué dans le jour, un peu avant nous). Sur onze que nous étions dans notre cave, nous avons été évacués huit : Pihan et Giacobetti, l'avant-veille, Corrier, un instant avant nous, nous quatre, et, enfin, le sergent Roux, évacué par le toubib du troisième bataillon, où il s'était fait porter malade en allant reconnaître les emplacements du troisième bataillon que nous étions près de relever. ...La nuit est coupée par la visite des avions boches qui viennent nous balancer quelques bombes, dont une qui tombe juste au bout du jardin... Le lendemain matin, comme j'ai un peu moins de fièvre, le médicastre me met sortant... Eh bien ! Je n'y aurai pas moisi à leur ambulance !... On ne pourra pas m'appeler pilier d'hôpital !... Cela ne me déplait pas car je commençais déjà à me barber, et puisque je ne peux pas aller plus loin (les médecins ayant reçu des ordres de n'évacuer qu'en dernière ressource), je préfère sortir de cette cabane de toile. On me donne l'ordre après la soupe de dix heures de rejoindre le T.C. (train du combat) du 155 et on me dit qu'il se trouve à Rumigny, pays situé à trois kilomètres de Sains. En arrivant dans ce patelin, nouveau tuyau : ce n'est pas le T.C. qui est là, mais le T.R. (train régimentaire) et le sergent-major m'explique que le T.C. se trouve à la ferme de la Racineuse, au milieu d'un bois à trois kilomètres de Rumigny. Comme une voiture de fourrage est prête à y partir, je grimpe dessus et en route ! Sitôt arrivé, je vois le chef de la première compagnie, le sergent-major Gellenoncourt, qui m'indique une place pour y passer la nuit. Je vais chercher un peu de soupe à la roulante de la C.H.R. qui est là, et je me couche. Le lendemain matin, renouveau tuyau. Le chef m'apprend que je suis affecté à la quatrième compagnie du C.I.D. à Rumigny. Me voilà donc reparti à destination de ce pays. Je me présente en arrivant au sergent-major de la quatrième, Vigreux : "C'que vous venez foutre ici ? vous", me demande-t-il, aimablement. Je lui explique mon cas. Il me répond qu'il n'a pas d'ordre pour me recevoir et que je n'ai qu'à aller au T.R. à l'autre bout du pays. Je m'y rends et j'y retrouve quelques copains. Nous nous débrouillons pour trouver un logement pour y passer la nuit. Le lendemain matin, comme ils m'ont dit que je devais avoir un équipement et un sac et que j'aurais dû prendre tout cela avant de sortir de l'ambulance, je saute dans un camion et je m'en vais à Sains. Je rentre dans le magasin, choisis tout ce dont j'ai besoin et m'en retourne... En rentrant, rerenouveau tuyau ! Nous allons à la Racineuse, au T.C. Je crois qu'ils se foutent plutôt de nous, à nous faire marcher ainsi ! Enfin, nous mettons sacs au dos, et en route ! Le doublard Gellenoncourt, ne sachant que faire de nous, va voir l'officier-payeur, qui lui dit de nous faire remonter en ligne... Ainsi soit-il ! Nous remonterons, mais pas ce soir, nous ne marchons pas nous voulons un peu de repos. Nous installons nos toiles de tente et passons ainsi la nuit. Au jour, nous démontons tout et laissons passer le temps tranquillement... Dans l'après-midi, alerte ! Nous allons filer avec les voiturettes de mitrailleuses qui vont aux roulantes, se charger du pain et du vin, et qui les accompagnent jusqu'au lieu de distribution aux compagnies. Nous collons nos sacs et nos personnes sur les voiturettes et nous voilà partis. En un rien de temps, nous sommes aux cuisines. Elles sont installées contre le remblai d'une voie de chemin de fer. Il nous faut attendre la nuit avant que les roulantes ne soient prêtes, puis nous prenons le départ. Chemin faisant, nous croisons quelques avions boches qui viennent envoyer leurs colis quelque part à l'arrière... Vers minuit nous arrivons au lieu de distribution. Nous y trouvons les délégués de la section. Exclamations, poignées de main : "Tiens ! Cambounet ! Déjà toi ! Ils t'ont foutu à la porte ! Ah, tu voulais t'embusquer et ça n'a pas pris !" Enfin, sitôt le ravitaillement touché, nous filons retrouver la section qui a regagné les premières lignes... Mais nous ne sommes plus tout à fait aux mêmes emplacements que la première fois. Alors que nous étions à la gauche de la compagnie, nous en occupons maintenant la droite. C'est une tranchée perpendiculaire aux boches.  C'est dire que dans le jour, il ne faut pas s'y tenir debout. Ceux qui nous ont précédés, ont creusé des trous dans la paroi, sous le parapet... Je n'aime pas beaucoup ce genre-là, car j'ai gardé un triste souvenir de mon trou du tas de betteraves. En arrivant, je serre la main au juteux, qui me dit de prendre une place, car il y a encore un trou disponible... J'y vais, je pose mes affaires sur le parapet et entre dans mon diminutif de gourbi à quatre pattes... Mais je pose la main sur quelque chose de mou et de gluant... ça me semble bizarre... Je porte la main à mon nez... Pouah ! Cela sent la m...e et, comme il faut ! Mon prédécesseur devait se servir de sa maison comme latrine !... Bah ! Un coup de pelle-bêche et mon trou est nettoyé. Je rentre mon fourbi dedans et je suis paré : je peux prendre la garde, après avoir toutefois, cassé la croûte. Je passe, dans ce coin, cinq journées calmes, du 21 au 25 mai. Enfin, dans la nuit du 25 au 26, nous sommes relevés par une autre compagnie. Nous filons en colonne par un et en vitesse. En cours de route, au moment de traverser la route Berteaucourt-Bauve, nous sommes salement sonnés, car les boches continuent à bombarder Berteaucourt et ses alentours. Nous passons l'endroit dangereux au pas gymnastique et sans mal. Nous arrivons bientôt dans le parc du château de Thézy... Il est magnifique... Nous devons nous installer sous les arbres. Mais, en quittant la première ligne nous tombons de Charybde en Scylla, car nous trinquons encore plus que dans nos trous ! La troisième compagnie, notamment, a reçu un magoniau en plein dans sa liaison. Le capitaine est blessé ainsi que quelques agentes de liaison et parmi ces derniers, il y a un tué. Enfin, nous sautons sur nos outils et nous mettons en devoir de commencer nos trous, afin d'être à l'abri des gros noirs qui viennent siffler rudement au-dessus de nos têtes et s'écraser autour du château qui est éloigné de nous d'une centaine de mètres. Mais dans la soirée nous abandonnons notre travail, car un tuyau vient de passer qui parait sérieux : la première section et une demi-section de la troisième, doivent déménager. Mais ce dernier article nous intrigue. Quelle sera la demi-section qui fichera le camp ? Cette question est intéressante, car ce serait pour aller sur une contre-pente, en arrière, occuper des sapes d'artilleurs. Enfin, au bout d'une heure, l'adjudant Jayet, nous avertit que notre demi-section est désignée pour le déménagement. En mois de cinq minutes, nous rassembles nos hardes et nous fichons le camp, au milieu des exclamations de mécontentement des poilus de l'autre demi-section : "Ah ! On les voit, les chéris ! - Ce sont toujours les mêmes qui ont les bons filons ! - Ils savent se démerder, ceux-là !" Enfin, un tas de réflexions aussi gentilles, les unes que les autres... Mais nous nous en foutons comme de notre première baïonnette, et heureux comme des rois, mieux même que des rois, nous allongeons le pas... Nous arrivons rapidement au nouveau logement. Je crois que nous serons très bien. Ce sont des sapes d'artilleurs environnant un emplacement de batterie. Lorsque les pièces étaient là, au bout de peu de temps elles avaient été repérées et les hommes, obligés de ficher le camp. Depuis que la position est abandonnée, le coin est tranquille. Les boches bombardent simplement Cottenchy et Dommartin. Dans le fond de la vallée, coule un ruisseau : l'Avre. En face de nous, sur l'autre pente, et de l'autre coté du ruisseau : Cottenchy. A gauche, à deux kilomètres de ce pays, et à cheval sur le ruisseau : Dommartin. De temps en temps, les obus passent au-dessus de nos têtes et s'abattent sur ou à coté des pays. Nous passons la journée du 27 mai, dans une délicieuse tranquillité... Il fait un temps magnifique... et, comme au-dessus de nous, sur la crête, un avion français se trouve abattu là, nous allons, Dubois et moi, l'examiner.  Les tubes de cuivre du moteur me suggèrent l'idée d'en dévisser pour faire des briquets. Aussitôt dit que fait. Nous nous installons à la besogne, Dubois ayant décidé de faire comme moi. Nous y allons doucement, sans secousse, car il y a encore deux petites bombes à ailettes accrochées après le fuselage, et elles ne nous inspirent qu'une confiance très relative, car elles ne nous paraissent pas bien accrochées, elles brandouillent salement ! Après une bonne heure de patience, j'ai réussi à l'aide de mon couteau, à dévisser deux tubes qui me feront deux briquets épatants. Dubois en a fait autant alors que nous n'avons pas d'outils ! Il est trop tard pour aller à la découverte, nous irons demain. Dans la nuit, vers deux heures du matin, nous sommes réveillés par des poilus qui appellent à la porte de la cagna. Nous reconnaissons des voix et nous sortons. C'est le reste de la compagnie qui vient nous rejoindre.  Le lieutenant Troutot a réussi à se débrouiller pour faire venir tous ses poilus ici, car ils ont été sonnés, la nuit passée dans le parc, et il doit y avoir quelques tués et blessés au bataillon... Comme il n'y avait personne pour conduire la deuxième demi-section à son emplacement que je connais je m'offre de guide. Leur sape est à une cinquantaine de mètres de la notre. Chemin faisant Brisse qui commande cette fraction, m'apprend qu'il a vu un radio disant que les boches avaient attaqué avec succès entre Soissons et Reims... Il a entendu parler, d'autre part, d'un ordre du jour de Foch, recommandant aux poilus de prendre patience et de comprendre pourquoi on ne les envoyait pas plus souvent au repos. Nous nous en apercevons bien, puisque voilà déjà trente-deux jours que nous sommes en ligne et qu'il n'est toujours pas question de relève ! Le lendemain matin, sous prétexte de corvée à la coopérative régimentaire, installée à Cottenchy, je suis descendu, avec Dubois vers le pays. En passant près du ruisseau, nous nous sommes mis nus jusqu'à la ceinture, et nous nous sommes nettoyés. Nous en avions bien besoin, car ça faisait environ trente-quatre ou trente-cinq jours que pareille chose ne nous était arrivée ! Sitôt retapés, nous allons à Cottenchy. Notre intention est de chercher dans ce pays déserté par ses habitants, quelques outils qui puissent nous servir pour faire nos briquets. Mais nous ne trouvons rien, et nous nous préparons à regagner nos cagnas, lorsqu'en passant le pont près de la rivière, une idée me vient : "Dis donc, Dubois, si nous allions jusqu'à Dommartin ? Ce n'est pas loin et peut-être aurions-nous plus de chance ? - Si tu veux. Suivons le ruisseau." Ainsi faisons-nous et en peu de temps, nous sommes arrivés aux premières maisons de Dommartin. La vue de la première nous donne quelque espoir. C'est une scierie actionnée par l'eau de l'Avre. Nous visitons toutes les pièces les unes après les autres, et nous avons trouvé, une fois notre visite achevée, trois ou quatre vieilles limes, qui nous rendront néanmoins quelques services... Tout heureux, nous rentrons pour nous mettre au travail. Vers midi, Fritz tape dans la vallée. Dans l'après-midi, nous remarquons que nous avons oublié de chercher un marteau. Nous nous décidons à redescendre. Mais stupéfaction ! En arrivant c'est en vain que nous cherchons, dans l'amas de ruines qui est devant nous, des traces de la scierie !... Un 210 est tombé en plein dessus et les murs nagent maintenant dans l'Avre !... Notre pensée commune, à Dubois et à moi est que les boches ont bien fait d'attendre midi pour bombarder ! Deux heures plus tôt, qu'est-ce que nous prenions !  Pour rentrer nous passons près du cimetière de Dommartin, labouré par les obus. Les tombes sont éventrées, les croix arrachées et les quelques rares caveaux aplatis! Quelle destruction !... Dans la nuit, nous allons travailler dans la plaine, au-dessus de Berteaucourt, nous amorçons un boyau. Au cours de notre travail, quelques 105 atterrissent sans faire de mal à personne. Au petit jour, le signal de rentrer est donné. En passant la route Thézy-Cottenchy, nous prenons le pas de course, car c'est un endroit réputé dangereux, et en effet nous n'en sommes pas à deux cents mètres, qu'une belle rafale venait y atterrir ! Nous nous couchons en rentrant et pouvons dormir tranquilles toute la matinée. L'après-midi et une partie de la nuit, car nous n'allons pas au travail, se passent dans la fabrication des briquets. Le lendemain, 31 mai, nous faisons nos préparatifs de départ, car nous sommes relevés ce soir. Dans la matinée, nous avons l'occasion de voir un journal. Ils marchent bien, les boches ! Les voilà à Septmonts, Chacrise, Ambrief, pays que je connais bien puisque j'y ai logé l'an passé. Le soir, à onze heures, branle-bas et départ. Nous marchons rapidement, sans sentir la fatigue, pourtant très réelle... Nous marchons pendant quatre heures couvrant environ quatorze kilomètres. Nous faisons une grand'halte, alors que le petit jour se montre timidement. Puis nous nous remettons en route et arrivons à Saleux, un petit pays usinier assez populeux. Ce doit être notre cantonnement de repos. Nous logeons dans un corps de bâtiment d'une tisserie. Le pays est partagé entre nous et les Anglais. Ils y ont une coopérative, où dès la première heure, nous apprenons que nous pourrons nous approvisionner, à profusion en cigarettes. Tant mieux, car la crise de tabac sévit un peu. Le patelin est traversé par un cours d'eau assez profond. Je me repose un peu, puis avec deux copains : Noël et Dubois, nous filons prendre un bon bain qui nous remet d'aplomb vigoureusement. Nous rentrons une heure après, pour la soupe, puis nous sortons en ville, faire la visite domiciliaire obligatoire ! Nous rentrons de bonne heure nous coucher et ne tardons pas à nous endormir d'un sommeil de plomb. Le lendemain 2 juin, nous faisons la grasse matinée. Comme on trouve tout le ravitaillement désirable dans le pays, je m'offre un déjeuner un peu plus substantiel que celui de la roulante. DAns l'après-midi, nouveau bain... Je rentrai tranquillement vers quatre heures, lorsqu'un agent de liaison vient annoncer que nous ayons à monter nos sacs en vitesse, car nous partons à six heures... Aie... Aie... quelque catastrophe !... La moitié des poilus sont saouls, et ceux qui ne le sont pas tombent de fatigue. Voilà une marche qui promet d'avoir du succès. Le rassemblement s'opère tant bien que mal, plutôt mal que bien ! Les types saouls poussent des jurons, parce que ça les faits... chier ! Ceux qui n'ont pas bu, râlent aussi, parce qu'après une journée de repos, il faut déjà remettre ça ! Enfin le départ est donné. Mon sergent, Gonnord, fait une marche serpentine. En arrivant à Vers, il s'allonge, entraîné par le poids de son sac. Je l'agrippe par son équipement et veux le remettre debout, mais il n'est pas sur ses jambes que, vlan ! une seconde bûche accompagne la première ! Je le remets droit, il se cramponne à mes musettes et ainsi il peut continuer à marcher ! ...En traversant le pays, un sergent qui soutient un poilu malade, voyant un rais de lumière filtrer sous une porte, y frappe : c'est le curé qui vient ouvrir. Un colloque rapide s'engage : "Pardon, Monsieur, demande le sergent, voudriez-vous donner de l'eau à ce pauvre diable qui est malade ? - Foutez-moi le camp, répond gentiment le curé, quand vous aurez rendu l'Alsace et la Lorraine, on vous donnera de l'eau !" Là-dessus il ferme sa porte au nez du sergent stupéfait. Encore un qui a de la chance que nous soyons en marche, car autrement nous nous chargerions avant de lui livrer l'Alsace et la Lorraine sur un plateau, de nous servir nous-mêmes la flotte demandée !... Enfin, nous continuons notre route. Première pause. Nous jetons nos sacs et tombons lourdement à terre. Je sens mes yeux se fermer. Ce n'est pas la boisson qui me fait cet effet-là car je n'ai pas bu, ayant préféré aller prendre un bain, mais bien ce dernier qui m'a éreinté. Le train de combat continue son chemin. Lorsque les caissons de munitions passent devant nous, Touraud, un vieux de la classe 98, qui n'arrête pas de gueuler, attrape son fusil par le canon et le colle sous la roue d'un caisson tout en hurlant : "Bande de vaches ! Le vlà vot'fusil ! Vous me faites chier avec votre guerre ! Merde, moi, j'marche pus !" Le sergent-major essaye de s'interposer : "Toi, nez sale ! M'emmerde pas !" Là-dessus l'autre n'a qu'à se taire ! Lorsque le coup de sifflet de reprise de la marche retentit, c'est avec un mal infini que nous nous remettons en route. Mes pieds trempés par l'eau, me font un mal inouï. Je marche néanmoins car je ne sais pas où nous allons, et je ne tiens pas à faire cinquante kilomètres inutilement ! La colonne s'allonge lamentablement, de plus en plus. Nous marchons à une allure de tortue, la seule qui nous convienne en ce moment. Après deux pauses encore, je n'en peux plus, et en repartant je me sens si las, que je ralentis le pas encore davantage. Je suis rejoins au bout d'un kilomètre par Marchand, le caporal-fourrier qui tient son godillot gauche à la main et marche sur sa chaussette. Nous faisons route ensemble. Il m'apprend que nous allons à Fransures qui n'est plus qu'à deux kilomètres. La tête de la colonne y est arrivée, environ trois quarts d'heure avant nous. Nous n'avons donc pas beaucoup de retard. Le pays a l'air bien misérable. On nous alloue une grange pour la section et nous nous empressons de nous débarrasser de tout notre fourbi. Toute la journée, les retardataires arrivent. Les derniers nous apprennent que le drapeau a passé la nuit au milieu d'un champ, son officier ne pouvant plus le porter, car il était saoul comme la bourrique à Robespierre ! Comme défilé de régiment, c'est joli ! Qu'est-ce qu'on va prendre ! Cela ne manque pas. Le lendemain matin, un renfort de la classe 1918 arrive et le lieutenant voulant les voir, nous rassemble pour le rapport. Il nous passe un de ces savons ! Malheureusement tout le monde en prend pour son rang et c'est ainsi que moi et quelques copains qui n'avions pourtant pas bu, nous en avons pris autant que Rouaud, par exemple, un fusilier-mitrailleur qui a perdu tout son fourniment, tellement il voyait peu clair ! "Bande de saligauds, dit le lieutenant, vous me dégouttez ! J'ai honte de commander une bande d'acrobates comme vous !" Pour la réception des bleus ça a fait très bien ! Le lendemain, 4 juin, je vais au Bosquet, un petit patelin voisin, pour avoir du pinard, car à Fransures, il n'y en a pas plus que d'eau, et, comme les deux puits sont à cent et cent-dix mètres de profondeur, que l'on juge ! L'après-midi, rassemblement pour la compagnie. Nous allons à quatre kilomètres du pays prendre un bain. Cela fait le quatrième que je prends en quatre ou cinq jours ! Si je ne suis pas propre après ça ! Puis, la vie de repos commence avec les alternatives de revues d'armes, de vivres et de munitions, exercices et jeux. Jobin étant évacué, je prends sa place de premier pourvoyeur à l'équipe Dubois-Blin, deux bons types. Le premier est de Longpont, dans l'Aisne, et le deuxième est de la Marne... Voici bien des fois que je change. Finirons-nous la guerre ensemble ? Nous le désirerions autant l'un que l'autre, car nous nous entendons parfaitement, mais les hommes... proposent, les généraux... s'opposent et la Destinée... dispose !... Dans l'Oise. Le 9 juin, vers trois heures du matin, tout le monde repose tranquillement, lorsque Chièze, l'agent de liaison arrive : "Alerte ! Tout le monde debout !" Nous nous levons, buvons notre jus et attendons. A dix heures, nous montons nos sacs et formons les faisceaux de manière à être prêts à partir au premier signal. Mais ça fait le coup de Lavarde-Mauger le 24 avril. Nous attendons comme soeur Anne et ne voyons rien venir. Enfin de guerre lasse, le soir nous nous couchons tranquillement. Le lendemain matin, rassemblement, comme d'ordinaire pour l'exercice. Nous allons à la sortie, reconnaître des emplacements de combat. Cela sent mauvais ! Et, comme dit un poilu, du moment qu'on nous fait prendre ces précautions, nous allons partir ! Il fait un temps horrible... Cela ne rate pas ! A neuf heures on vient nous chercher, ordre est donné de rentrer. Nous montons nos sacs. Que se passe-t-il du coté du Front ? Nous n'en savons rien car nous n'avons pas les journaux. Nous sommes moins bien renseignés que les gens de l'arrière ! Dans la journée, rien de nouveau. Mais, vers dix-huit heures, on entend un bruit bien connu : celui des moteurs d'autos, une foule de camions nous passent devant le nez, et vont s'arrêter à la sortie du pays. "Sac au dos ! En avant marche !" On nous entasse à raison de seize par camion. Lorsque tout le monde est paré, zou ! En route ! Jusqu'à vingt-trois heures passées, nous roulons ainsi. Puis, nous nous arrêtons sur la route, non loin d'un pays que l'on distingue à un kilomètre environ. Il y a là un mouvement de troupes, phénoménal ! Nous voyons les poilus du 287 et du 154. Toute la division est donc réunie ici. Des tanks sortent du pays, et s'en vont tranquillement par un petit chemin, dans la direction des éclairs d'artillerie qui nous signalent les lignes. Nous avons formé les faisceaux, dans un champ, en dehors de la route et attendons... Au bout d'une grande heure, les fourriers reviennent et nous fichons le camp. Ils nous indiquent nos emplacements pour la nuit. Nous cassons la croûte, comme tout bon poilu qui se respecte. Nous nous déchaussons et nous couchons. Tout à coup, je suis réveillé par un gueulement ! "Tout le monde debout ! prêt à partir !" Les bougies s'allument, comme par enchantement. Il n'y a pas deux heures que nous dormons. En maugréant, nous enfilons nos godasses... Boum ! Cinq minutes après, Chièze rapplique : "Tenue d'assaut ! Portez les sacs au bureau !" Les poilus qui avaient déjà monté leurs sacs rouspètent. Moi, je m'en fous ! J'ai mon sac bourré de quatre cent cartouches, je le garde. Je n'ai donc pas à le démonter ! Puis troisième apparition de Chièze : "Sergent de jour aux cartouches !" Cela sent de plus en plus mauvais ! Nous croyons bien que nous montons en ligne... à moins que nous n'allions défendre le camp retranché de Paris ! Au moment de partir, distribution de grenades et du rabiot de cartouches. Moi, comme pourvoyeur de F.M., je laisse choir tout ça, dédaigneusement. J'ai mon compte ! ...Enfin, nous nous mettons en route... Il est environ trois heures du matin. Nous marchons bons pas et faisons ainsi une quinzaine de kilomètres. Nous arrivons alors à une voie ferrée, et commençons à nous apercevoir que nous sommes en ligne. Des cadavres, ça et là, en témoignent... Nous suivons la voie, passons devant la station de Ménévillers, poursuivons notre route encore en bout de temps, puis nous arrêtons... Une petite pause, et nous franchissons le remblai...  Nous voici en ligne de demi-sections par deux, dans un champ de blé... Nous allons jouer un rôle dans la contre-attaque française du 11 juin... Les boches doivent déclencher une offensive contre Compiègne, nous allons la déjouer, en attaquant avant eux !... Ah mais !... Nous faisons cent mètres, puis nous arrêtons... Les tanks traversent la voie ferrée et viennent défiler devant nous, pour gagner leurs postes de combat. Nous avons hâte qu'ils soient passés, car nous craignons que les boches ne les repèrent et les bombardent; dans ce cas, naturellement, nous recevrions des éclaboussures ! Il en passe ainsi une vingtaine, puis le défilé se termine. Les tanks s'éloignent et se forment en ligne, plus loin, avec le 287 qui doit marcher avec eux, car nous, ne sommes que réserve de division. Pourtant c'était notre tour d'être première vague. Mais, il parait que les poilus du 287, dans la Somme, auraient jeté des pierres, sur l'auto du général Caron, commandant la division. Au bout d'un moment, la canonnade tape dur, en première ligne. Nous avançons par bonds successifs... Cinquante mètres en avant... dix minutes d'arrêt... De nombreux avions français sillonnent le ciel. Peu de boches, car ils les combattent par canons... Dans la matinée, un fusant éclate en plein dans un appareil, qui tombe en morceaux, les ailes d'un coté et le fuselage d'un autre. On distingue même très bien, l'aviateur piquant du nez, à une vitesse vertigineuse... A ce moment arrive une escadrille boche et le combat s'engage... Les balles incendiaires tracent leur sillon blanc dans le ciel... Mais personne ne descend et ils font demi-tour... Les blessés de chez nous et les prisonniers boches commencent à affluer. L'attaque semble réussir... Puis vers trois heures de l'après-midi, le combat devient acharné... Les mitrailleuses boches crachent comme des enragés... Les tanks sont pris à partie par les 210 et on en voit brûler plus d'un... Enfin, vers seize heures, nous arrivons à une route neuve, toute blanche, le long de laquelle nous nous installons... Nous n'irons pas plus loin pour aujourd'hui. Nous posons sacs à terre. Presqu'aussitôt, les caporaux demandent un volontaire par escouade, pour aller au ravitaillement. Je m'offre à y aller pour la dixième. La corvée se rassemble auprès du fourrier et nous partons nantis de bidons et de notre toile de tente. Nous refaisons, en sens inverse, le chemin parcouru dans la journée. Nous pouvons dénombrer les cadavres étalés dans la plaine. Il y en a des morts... Des tirailleurs... des fantassins... des chasseurs... des morts... des morts... il y aura quelque chose comme croix de bois, d'ici peu !...  Nous suivons notre chemin tranquillement. L'artillerie boche s'est tue. Elle est sans doute occupée à s'installer sur de nouvelles positions. Nous allons à Ménévillers. Mais les roulantes ne sont pas encore arrivées. Nous sommes obligés de faire une longue pause... Sitôt les cuistots arrivés et la distribution achevée, nous repartons... Nous voyons dans un ravin, les tanks qui se disposent à repartir en arrière. Vingt-quatre heures d'attaque et les voilà qui filent !... Avisant un sac par terre, je l'ouvre. Il est plein de fusées éclairantes et de fusées signaux. Avec la pointe de mon couteau je retire la bourre de l'une d'elles : le parachute est en soie. J'en prends une autre et je mets les deux parachutes dans ma poche. Je les enverrai dans une lettre ou les porterai en allant en permission... En rentrant, nous mangeons notre frichti, nous nous enroulons dans nos couvertures et hardi ! petit ! nous nous endormons, avec les cailloux de la route comme matelas. Nous passons ainsi la nuit... Vers trois heures, l'adjudant Jayet nous réveille : "Allez, préparez-vous. Montez vos sacs. Nous partons." Et, en effet, sitôt l'exécuté, nous nous mettons en route. Nous allons ainsi jusqu'au pied d'une grande crête, le long de laquelle grimpe un boyau occupé par les poilus du 154. Nous restons en bas un bon moment, puis nous grimpons en suivant le boyau, qui, pour le moment sert de tranchée de première ligne. Un peu avant le sommet de la crête, nouvel arrêt : on nous fait préparer nos armes... Je prépare mon revolver dans sa gaine, et, dans mon sac, je prends quatre chargeurs que je dois tenir à la main, prêt à les passer à Dubois. Sitôt ces préparatifs achevés, nous partons. On nous annonce que nous devons prendre un patelin : Saint-Maur, qui se trouve alors devant nous à douze ou quinze cents mètres. Cela me fait un drôle d'effet d'entendre ça : une compagnie à l'assaut d'un pays si éloigné... Je ne fais pas de réflexions, préférant les garder pour moi. Nous nous formons en ligne de demi-sections par deux à vingt pas d'intervalles et, en avant ! Mais nous n'allons pas loin. Nous n'avons pas fait cinquante mètres que des mitrailleuses placées au-dessus de Saint-Maur se mettent à cracher... Les balles arrivent à nos pieds. Nous nous couchons, sauf le lieutenant Troutot, qui, lui, reste debout, sans broncher. Et pourtant, le tir est bien ajusté. C'est miracle que personne ne soit mouché ! Troutot voyant qu'il n'y a rien à faire, et comprenant bien que ce n'est pas avec une compagnie, que l'on prend un pays, à quinze cent mètres, sans préparation d'artillerie, nous fait obliquer à gauche et nous nous dirigeons vers le prolongement du boyau suivi tout à l'heure. Il n'y a personne à cet endroit, nous y descendons pour attendre les évènements... Vers midi, alerte ! Nous distinguons une ligne grisâtre, à droite de Saint-Maur qui vient vers nous. Troutot suit à la jumelle, et reconnaissant les boches envoie une fusée : demande de barrage... A peine est-elle en l'air que nos 75 et nos 155 se mettent à cracher, comme il faut. Leur tir est bien ajusté. Les obus explosent devant la ligne de tirailleurs boches... Nos mitrailleuses et nos fusils-mitrailleurs se mettent de la partie... Les frigolins font demi-tour et regagnent leurs positions en vitesse...  Le tir s'apaise et cesse... Dans le ravin, au-dessous de nous, sont installés les tirailleurs... L'artillerie boche se réveille : leurs obus suivent le ravin... Nos pauvres kakis prennent quelque chose, surtout que juste derrière eux, se trouve la ferme de la Garenne, facilement repérable, et les boches ne se gênent pas pour taper dessus. Le temps est magnifique. Les avions sortent en quantité. En voici une escadrille de chez nous, de vingt-cinq d'un seul coup. Les fusants font rage... Dans la quantité, ils réussissent à en attraper un qui se met à brûler, tombe et explose en touchant le sol. Vers vingt heures, arrive l'ordre de nous tenir prêts pour une reconnaissance dans la direction de Saint-Maur. Toute la section en est. Il faut que nous sachions si le pays est occupé ou non. Nous partons vers onze heures... Nous marchons par petits bonds courts et successifs... Mais la petite pointe de grenadiers qui marche devant nous, fait un potin infernal avec ses baïonnettes. Aussi, ça ne loupe pas. Il arrive bien ce qui était prévu. Nous ne sommes plus qu'à une centaine de mètres du pays quand brusquement, les mitrailleuses se mettent à cracher et les fusées vertes voltigent en l'air... Le barrage va rappliquer !... Il rapplique !... Deux ou trois 88 viennent nous péter au derrière. Voilà là-dessus, la section entière qui fait demi-tour au pas gymnastique, et houp ! en moins de rien, nous avons regagné notre tranchée !... En tout cas, nous sommes fixés : le pays est occupé, nous nous en sommes aperçus ! Il est deux heures du matin. Nous nous arrangeons pour la garde et à tour de rôle, nous prenons un peu de repos... Au petit jour, voilà que brusquement les boches déclenchent un tir d'artillerie dans la vallée ! En un rien de temps, elle est remplie de fumée. Les tirailleurs envoient une fusée demandant le barrage. Aussitôt le lieutenant en envoie une autre, et comme hier, la réponse ne se fait pas attendre ! Bing ! Zing ! Bing !... Bing ! Zing ! Bing ! Nos 75 crachent dur et ferme. Quant à nous, nous nous tenons sur nos gardes. Les fritz peuvent venir : ils seront reçus comme il faut. Ce tintamarre dure une heure environ, puis comme toujours, ça se calme, puis s'arrête totalement. Vers quatre heures, il fait déjà grand jour, et nous devons aller relever les tirailleurs dans le ravin... Car ce sont des troupes qui sont de toutes les attaques, mais au lieu de se payer des trente ou quarante jours de lignes, comme nous, ils n'y restent que vingt-quatre heures et sont relevés. Dans la nuit, ils ont travaillé, et, en arrivant nous trouvons un élément de tranchée. Nous attrapons nos outils portatifs en vitesse et avec Dubois et Blin, nous nous faisons un trou pour nous trois. Sitôt que nous jugeons qu'il a une profondeur suffisante, nous essayons de roupiller. Mais l'envie est vite coupée, car les 88, malgré la relève, continuent à rappliquer, et il fait plutôt chaud ! Nous avons de la veine : personne n'est touché dans notre coin. Il n'en est pas de même à la première section, car nous voyons quelques poilus ficher le camp en vitesse. Dans l'après-midi, on nous fait passer quelques grenades, en cas d'attaque boche. Dubois, pendant ce temps me fait une théorie sur le F.M. que je connais à peine, afin que je sache m'en servir en cas de besoin. Au bout d'un moment je suis en état de tirer convenablement... Si le fusil veut bien marcher !... Puis, nous admirons le panorama. Les Rimailhos tapent dur sur Saint-Maur. Je crois que les boches qui y sont doivent avoir chaud au cul... les pôvres ! Dès la tombée de la nuit, nous déménageons. La compagnie étend son front vers la gauche afin de pouvoir relever la dixième compagnie du 154, où il ne reste plus que vingt-huit poilus. Quelle purge pour eux ! Nous nous installons dans des embryons de trous de tirailleurs, sur la crête : la cote 117. Nous nous mettons de suite à la besogne : à trois, ça va assez vite, et au jour nous avons un trou potable. Nous sommes éreintés : peu de repos et beaucoup de fatigue, depuis trois jours, ça nous a crevés. Aussi nous endormons-nous d'un sommeil de plomb. Vers midi, je me réveille en sursaut, en m'entendant appeler : "Eh, Cambounet ! - Qu'est-ce qu'il y a ? - Mulé est tué ! - Hein ? Sans blague ? - Oui ! Un 88 est tombé dans son trou !"  C'est Roland, un breton de la dixième qui m'annonce ça et il m'explique : il dormit dans son trou, lorsqu'il reçoit une boite à masque sur la tête. Croyant que quelqu'un lui faisait une blague ou l'appelait de cette façon, il passe la tête et voit la capote de Mulé, étendue sur le parapet. Il sort et en rampant, vient vers le trou de Mulé. Il voit alors le malheureux, le ventre arraché, empli de terre, et comprend ce qui s'est passé : un malheureux obus, lâché par hasard, qui est tombé juste à cet endroit. Nous n'avons rien entendu, et, pourtant il n'y a pas plus d'un mètre entre nos deux trous, c'est dire si nous dormions. Dubois et Blin se sont réveillés également et nous causons du pauvre copain. Nous le plaignons sincèrement, car c'était un très bon camarade. Il avait fait la Somme en 1916, l'Aisne et Verdun, en 1917, sans une égratignure. Cette fois, il n'avait pas été raté ! A la nuit, avec une pelle, on débarrasse son corps de la terre qui le recouvre, et deux brancardiers l'emportent dans une toile de tente. On ne peut pas le transporter autrement, car son corps plie, les deux tronçons n'étant reliés entre eux, que par la colonne vertébrale et un peu de chair du dos... ...Il va aller rejoindre les sept ou huit cent tués, qui sont dans le ravin, un peu en arrière, où l'on forme un cimetière, intitulé : le cimetière du ravin des réserves !... Le lendemain matin, 15 juin, les boches font un tir de harcèlement, sur nos positions, avec des 88 et des 130, et sur la ferme de la Garenne, avec des 210, à fusée à retard... La terre tremble du fait de ces derniers !... Mais tous ces obus font plus de bruit que de mal, et les boches se lassant plus vite que nous de ce jeu, arrêtent leur tir. ...Pendant deux jours, nous restons là-dedans, assez calme malgré quelques obus, tombant à droite ou à gauche... Nous pleurons après la relève !... Les tuyaux les plus imprévus circulent : retour au grand repos... relève par une division marocaine... etc... Dubois est très déprimé; les boches sont dans son pays et il n'a plus de nouvelles de chez lui. Il ne sait pas ce que sont devenues sa mère et sa soeur... Blin et moi, nous essayons de ranimer son courage chancelant, mais sans grands résultats... ...Enfin, le 17 juin, vers dix heures et demie du soir, la relève arrive... Nous filons bride abattue, car nous voudrions déjà nous sentir à l'abri des balles boches ! Aussi, ne sommes-nous pas longs à arriver au ravin des réserves. Les poilus qui étaient là, avant nous avaient commencé des trous... J'en prends un et bonne nuit !... Le lendemain matin, aidé de Biet, un poilu de la dixième, j'aménage mon trou. J'ai dégotté des planches, qui iront mieux que la toile de tente... ...Nous venions de finir notre trou, lorsqu'un coup de revolver claque... Je regarde... Dubois est affalé, blanc comme un linge, sur le parapet de son trou... Je me précipite... Il vient de se tirer, involontairement, une balle dans le pied... En nettoyant son pistolet, il avait laissé une balle dans le canon et en appuyant sur la détente, le coup est parti. On lui enlève sa chaussure et sa chaussette, on lui fait un pansement et le voilà parti. Le poste de secours est tout près d'ici. Il y va et ne tarde pas à monter en auto, pour filer à l'arrière... Allons, encore un qui sera mieux qu'ici !... Le sergent vient me trouver et m'annoncer que je passe tireur à la place de Dubois, avec Blin comme deuxième pourvoyeur, et Jay, de la classe 18, comme premier pourvoyeur. Avec Blin, ça va, mais en Jay, je n'ai guère confiance. Enfin, ça n'a pas d'importance, à nous deux, nous sommes assez...  ...Nous apprenons aujourd'hui, une nouvelle qui fait plaisir à tout le monde : la nomination du lieutenant Troutot au grade de capitaine. Nous en sommes bien contents car c'est un chic type, bon et brave... ...J'étais bien installé, l'après-midi, dans mon trou, quand, vlan ! l'ordre arrive de changer de place : ce n'est pas pour aller bien loin, à cinq cent mètres, à peine, de là, mais enfin, il faut quitter la place. Je prends mes planches, que j'ai eu tant de mal à trouver et en route ! Là où nous allons, de l'autre coté du ravin, il y a bien des trous, mais ce sont des vulgaires trous de tirailleurs, creusés pendant l'attaque, le 11, par des poilus, pendant leur avance. Au petit jour, un copain m'annonce que les boches ont bombardé pendant la nuit, mais je dormais tellement que je ne les ai pas entendus. Mais il y a une preuve : il y a un 105 qui s'est enfoncé en terre, sans éclater, à cinquante centimètres du trou d'un sergent. Sitôt le jour venu, aidé de Biet et munis de bons outils, nous nous faisons une cagna pépère : un mètre cinquante de profondeur, deux mètres de coté, cinq ou six marches pour y descendre, et, en bas de l'escalier, un puisard recouvert de deux ou trois planchettes, et, enfin deux mètres de terre par là-dessus. Nous ne craignons pas sinon les obus, du moins les éclats. Dans la soirée, un orage épouvantable éclate. Les trous des copains sont remplis d'au moins trente centimètres d'eau, en un rien de temps. Comme nous pouvons tenir trois dans notre cagna, nous recueillons Noël un bon copain, qui partagera notre habitation avec nous. Nous sommes un peu serrés. Mais après avoir été un peu travailler dans la nuit, nous élargissons notre trou avec notre pelle-pioche. Malheureusement, dans la journée, grande déception : nous n'aurons pas le plaisir de profiter de notre installation, car nous montons en ligne, ce soir. La compagnie est réserve de bataillon. Nous nous installons dans une tranchée. Mais nous n'avons plus le courage de refaire une installation : nous avons subi trop de déceptions depuis deux jours. Aussi nous contentons-nous de placer une tôle ondulée, avec un peu d'herbe dessus, pour nous servir de camouflage et voilà le P.C. du fusil-mitrailleur installé ! Dans la nuit, nous allons travailler : corvée de fil de fer barbelé... Le lendemain soi, nous devons aller au boulot : commencer une tranchée de repli, derrière la tranchée de première ligne, qui passe à hauteur de Belloy. Mais ça ne va pas tout seul. Le matin, au petit jour, les boches se sont emparés par surprise, d'un bout de tranchée, dans lequel était installé un de nos petits postes, et, tandis que nous travaillons, la section franche s'occupe de le reprendre. Les boches ripostent et quelques 88, viennent nous cracher à la figure. En repartant pour regagner notre position, ça fait la même chose. Nous suivons un petit chemin qui mène à Merry et que les Fritz ont repéré. Aussi, en passant, sommes-nous obligés de piquer un petit pas gymnastique. Les éclats, rouges, tellement ils sont chauds, nous rasent le nez. Mais enfin, nous faisons vite et passons sans mal. Au jour, nous apprenons que le coup a réussi, et qu'il y a deux feldwebels et une dizaine d'hommes faits aux pattes. Dans la nuit du 23 au 24, nous redéménageons pour aller dans une sorte de grand fossé, derrière le château de Belloy. Il y a là des cagnas toutes prêtes. Donc pas de travail ! La nuit suivante, nous filons au boulot : comme je suis tireur de F.M. je n'emporte pas d'outils, car, au lieu de travailler, je vais en avant, installer mon tacot, afin de protéger les travailleurs, en cas d'alerte. Dans la matinée, je vais avec Bier, à la coopérative, acheter quelques oeufs. Nous avons ramassé du bois très sec, afin de ne pas faire de fumée, quand bing ! bing ! bing !... les obus arrivent dans notre trou ! Les éclats sifflent dur ! Je suis alors placé dans cette alternative : ou laisser mes oeufs brûler ou risquer un éclat quelque part... Bah ! tant pis, je penche du coté de la deuxième alternative : tout plutôt que laisser perdre mes oeufs ! Aussi, je fais tranquillement cuire mes oeufs au bruit du tam-tam, puis sitôt ma tambouille achevée, je la mets à l'abri, ainsi que ma petite personne... Dès que la rafale est achevée, nous nous envoyons, Biet et moi, le plus tranquillement du monde, nos huit oeufs !... Dans la nuit du 28 au 29, déménagement. Nous allons en réserve de division, le long de la voie ferrée, un peu à gauche de Ménévillers... J'allais m'installer dans un trou avec mes pourvoyeurs, lorsqu'on nous annonce que les F.M. s'en vont à sept ou huit cents mètres, en avant dans une tranchée. Nous y voilà partis. Ma foi, nous y serons très bien. Pas de gradés avec nous ! La tranchée est au milieu des blés, et par conséquent elle ne doit pas être repérée. Tout est pour le mieux ! Dans la nuit, les poilus de la compagnie vont au travail et nous, nous restons tranquillement à notre poste : pour une fois, nous avons le filon ! ...Jusqu'au 3 juillet, le temps passe ainsi tranquillement, sans s'en faire... Nous admirons les saucisses françaises qui descendent à une moyenne de une tous les jours; nous allons dans les jardins de Ménévillers chercher des légumes avec lesquels nous faisons de bonne soupe. Nous nous rendons visite de P.C. à P.C., car chaque équipe est distante de cent mètres environ, l'une de l'autre... Dans la nuit du 3 au 4 juillet, nous partons à Beaupuits, en réserve de corps d'armée. Ici, c'est plus dur, car nous allons travailler du côté de Vacquemoulin et il y a bien six kilomètres à faire, pour y arriver... Nous passons ainsi une partie de la nuit et dans la journée, repos... Dans le jardin de la maison où nous sommes, il y a de très belles pommes terre nouvelles. A chaque repas, j'en arrache quelques-unes et les mets à frire dans du beurre... Cela allonge le menu !... Le dimanche, 7 juillet, nous partons vers vingt-une heures, pour aller relever le 287, devant Saint-Maur. La compagnie se trouve un peu à gauche de ce pays. Les premières et troisièmes sections sont détachées, un peu en avant, aux petits postes, un par demi-section. Le F.M. du 287 me passe les consignes, puis fiche le camp. Nous voici installés pour quatre jours, nous a-t-on dit. Vers trois heures du matin, sur la droite, du coté de la ferme Porte, se déclenche un tir de barrage. Nos poilus attaquent. Les boches ripostent et tirent même un peu de notre coté. Quelques 88 et 130 viennent souffler à vingt ou trente mètres de notre trou. Mais ça n'est rien... Néanmoins, j'ai hâte d'avoir quitté ces petits postes : ils ne m'inspirent pas confiance... Nous sommes à demi-pente. A trente mètres devant nous, se trouve un chemin creux, en contre-bas du terrain, de un mètre cinquante environ : les fritz pourraient arriver là sans qu'on les voie, d'autant plus que le ravin est couvert par un champ de blé très haut... Malgré ça, nos quatre jours se passent tranquillement, et dans la nuit du 11 au 12 juillet, nous sommes relevés par le deuxième bataillon... Nous filons sur la plaine en arrière, dans une tranchée de résistance. Dans la matinée, je file jusqu'à Moyenneville; j'enlève une porte d'une maison et la porte à mon emplacement... Je creuse un trou, pose ma porte dessus. Voilà mon appartement !... ...Le 14 juillet est fêté par une distribution d'eau gazeuse, intitulé champagne, à raison d'une bouteille pour quatre ! Cela ne nous empêche pas de travailler la nuit : à l'intérieur on fait peut-être la foire, mais ici le service ne perd pas ses droits ! Dans le jour, les fritz nous canardent un peu à l'aide des 105 fusants... Le 18, en allant à la coopérative, surprise ! Un obus est tombé dessus et a anéanti la cabane dans laquelle elle était installée ! Donc, grande ceinture ! Nous travaillons encore pendant deux nuits, puis repos dans la nuit du 20 au 21. Car nous devons aller reprendre position en première ligne, et il s'agit d'être d'attaque ! Mais cette fois, ce sont les deuxième et quatrième sections qui iront aux petits postes. Nous, nous restons en première ligne : une tranchée crayeuse, dans laquelle en moins de rien, nous sommes devenus tout blancs ! ...Il y a deux jours que nous sommes là, lorsqu'on nous alerte. Parait-il que les boches doivent faire un coup de main, suivant une communication téléphonique, interceptée par les nôtres. La section franche monte en ligne, faire la chaîne entre les petits postes... En même temps nous apprenons un autre tuyau : c'est que la compagnie reste six jours en ligne, au lieu de quatre. Pourquoi ? Nous n'en savons rien, mais tels sont les ordres, ne cherchons pas à les comprendre !... Malgré l'alerte, la nuit se passe calme... Dans la nuit suivante, la franche monte encore, mais rien ne se produit. Nouvelle : comme il y a six jours à tirer, nous irons, ce soir, relever la quatrième section aux petits postes. Nous comprenons bien pourquoi : le lieutenant qui la commande s'est démerdé, et, comme nous n'avons qu'un adjudant, nous n'avons rien à dire ! A dix heures, nous démarrons et descendons au même petit poste que la fois précédente... Comme je suis de ravitaillement, je file aussitôt. Je croyais en chemin rencontrer les poilus de la section franche, mais comme ça fait deux jours qu'ils se dérangent pour rien, les cuistots nous disent qu'ils ne monteront pas ce soir, pensant que les boches ont abandonné leur idée. Dès que la distribution est achevée, nous nous en retournons. En arrivant, on nous dit de ne pas faire de bruit, car il a été entendu des bruits suspects dans le ravin. Le petit poste est commandé par deux sergents : Brisse et Ronteix, et par un caporal, Després, mon fameux cabot du 164. Comme poilus, nous sommes trois de l'équipe de F.M. et cinq ou six grenadiers... Nous mangeons la soupe en vitesse et silencieusement... ...Puis nous écoutons... J'ai préparé soigneusement mon tacot, avec des chargeurs à portée de la main... ...Le trou est aux trois quarts recouvert avec du gros camouflage d'artillerie : c'est gênant et ça nous supprime de la place... Il n'y a pas une demi-heure que le rata est mangé, qu'un violent tir de barrage se déclenche derrière nous, nous coupant la retraite vers la première ligne... Ronteix... à genoux dans le trou, car il a peur, effroyablement peur... envoie une fusée éclairante... ...Grâce à cette lueur fugitive, j'entrevois une ligne d'ombres qui arrive sur notre droite, à vingt-cinq mètres du petit poste... Je n'attends pas plus longtemps, et commence mon tir, pendant que les grenadiers, debout sur le parapet envoient quelques grenades...  ...Le tacot m'aveugle et m'assourdit : je ne distingue plus rien devant moi, et j'entends tout juste la voix de Brisse, sur le parapet, au-dessus de ma tête, qui gueule comme un putois : "En avant ! En avant !" Il espère sans doute intimider les boches !... Je passe un chargeur comme une lettre à la poste... En deux secondes, j'en place un autre et je continue mon tir... ...Mais, crac ! Je tire une dizaine de cartouches et mon fusil s'arrête !... N'ayant plus cette lueur devant les yeux, je distingue des silhouettes à l'autre bout du trou, à une dizaine de mètres de moi !... Je devine aisément que ce sont les boches... D'autant mieux que je n'entends plus rien !... ...Je ne perds pas de temps.. J'attrape mon instrument de musique, et, faisant un rétablissement, je saute sur le parapet, et me mets à courir... ...J'entends un pétard claquer derrière moi. Mais je ne perds pas de temps à me retourner... Je cours... Je cours éperdument... Je ne suis pas long à rattraper Brisse, qui est parti peu de temps avant moi... Je suis convaincu que j'ai quitté le trou le dernier. ...Nous courons de concert, en remontant vers la crête, lorsqu'en arrivant au-dessus du petit poste de la deuxième demi-section il fait un à-droite brusque et y descend... Je me prépare à le suivre, lorsque, à la lueur des fusées, je vois des poilus courir, en venant vers nous. Je reprends donc ma course, vers le haut, sans plus m'occuper de Brisse, et je ne tarde pas à rattraper le reste de la section. A ce moment, nous faisons une bêtise. Au lieu de rester entre le barrage et les petits postes, nous nous engouffrons résolument sous les obus... Cela pète dur et sec, car ce sont des 88 et des 130 à fusées très sensibles : à peine ont-ils touché terre, qu'ils éclatent... ...Aussi, ça ne tarde pas. Je reconnais la voix de Després, qui gueule à perdre haleine : "Oh, mon bras ! Oh, mon bras !" Un éclat lui a labouré l'avant-bras gauche. Puis c'est Gonnord, qui se met à hurler : "Merde ! Ils me font chier ! J'fous l'camp ! J'suis blessé !" Et, le voilà qui court à bride abattue vers le haut. Enfin, un troisième Verdy, un engagé de la classe 1919, qui nous annonce qu'il a reçu une balle de mitrailleuse dans l'Aisne, car les boches font du tir indirect, en même temps que leur artillerie. Enfin, à bout de souffle, nous dépassons le barrage, et arrivons à la première ligne, où nous sommes un peu plus tranquilles et où nous pouvons souffler ! La première des choses que fait l'adjudant, c'est l'appel. Nous nous appelons mutuellement, et, alors en plus des trois blessés que nous connaissons, nous constatons l'absence de Brisse, Ronteix, Noël et Blin. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. J'explique à l'adjudant, ce que j'ai fait et vu. Je suis donc à peu près sûr que Brisse est prisonnier... Quant à Ronteix, en réfléchissant bien, il a dû avoir peur et rester dans son trou... Il doit être prisonnier, également... Pour ce qui est de Noël, tireur de la deuxième équipe, Verdier nous dit qu'il est monté avec lui, puis qu'il est redescendu d'un seul coup. Il est sans doute prisonnier aussi... Quant à Blin, personne ne l'a vu ! Une fois toutes ces formalités terminées, l'adjudant va trouver le capitaine Troutot afin de savoir ce qu'il y a lieu de faire. La réponse ne tarde pas à revenir : "Redescendez occuper les petits postes !" Nous nous préparons en ligne et commençons notre mouvement... PEndant la pause, là-haut, j'ai flanqué mon chargeur en l'air et j'en ai pris un autre. Je suppose que, maintenant mon tacot marchera. Garnier, le cabot descend à coté de moi. Cette fois, j'ai mieux pris mes précautions. J'ai placé mon revolver tout chargé et armé, dans la poche de ma capote. Ainsi, en cas de surprise, je suis paré : s'ils m'ont, ce ne sera pas sans mal !... Nous sommes dix, en groupe, en partant. Mais chemin faisant, les poilus se dispersent et, lorsque nous approchons du but, nous ne sommes plus que deux : Garnier et moi... En arrivant, nous constatons que les boches se sont montrés "gentleman" et n'ont pas trop esquinté notre trou. Néanmoins, il y a un trou dans le camouflage. Probablement un boche qui est passé en travers. Mais ils ont respecté nos bidons et nos bouteillons. C'est parfait !... Nous rétablissons l'ordre là-dedans. Pendant ce temps, les autres poilus arrivent. Une patrouille passe, venue de la première section. Roux, le sergent nous apprend qu'ils ont trouvé le corps de Blin. Le malheureux a été tué d'un éclat d'obus qui lui a traversé la poitrine de part en part... En descendant dans le trou, Biet s'aperçoit que son sac a été littéralement broyé par le pétard qui est tombé au moment où je partais... Les parois de la tranchée sont criblés d'éclats et une pelle-bêche qui était sur le sac de Biet est en loque... ...Je reconnais alors que mon fusil m'a sauvé la vie : s'il ne s'était pas enrayé, j'aurais été dans mon trou, au moment où les boches ont envoyé le pétard, et, sans ce hasard, je prenais quelque chose comme éclats dans le bas des reins ou ailleurs !... Enfin, maintenant, l'alerte est passée : personnellement, je m'en tire à bon compte, mais ça nous fait tout de même sept pertes à la section ! ...La journée se passe dans une nervosité extrême : nous avons hâte de voir la nuit arriver, car nous n'avons plus que celle-là à passer ici... Un poilu émet l'opinion que les boches vont remettre ça : "Mais non, lui dis-je, le but de tout coup de main est de faire des prisonniers. Ils en ont trois, dont deux sous-officiers. Ils vont s'estimer heureux avec ça et resteront tranquilles !" Et, en effet, les évènements me donnent raison. La nuit et la journée suivante sont bien calmes... Néanmoins, c'est avec un plaisir sans mélange, que nous acceptons la relève qui vient le soir. C'est le premier bataillon du 154 qui prend notre place et nous, nous allons du coté de Vacquemoulin, derrière le remblai d'une route, le long d'un petit ruisseau. Nous devons aller travailler de nuit, à la construction d'un petit boyau pour la pose d'un fil téléphonique, à coté du P.C. de l'infanterie divisionnaire... Le 4 août, nous quittons ce coin, pour aller à coté de Moyenneville, dans un ravin... Là, pour la première fois depuis que nous sommes dans le secteur, j'ai une cagna toute prête. Rien à y faire ! Les tuyaux d'attaque deviennent de plus en plus forts : d'après eux, on ferait une attaque en masse de notre coté, de façon à percer le front allemand... Mais rien n'est encore précis ! Ce n'est que le 8 août, au matin, qu'on nous fait nettoyer consciencieusement nos armes, et ensuite distribution de cartouches, grenades et vivres de réserves... Un moment après, nous filons à Vacquemoulin, y porter nos sacs. Moi, je garde le mien, car je trouve ça plus pratique, pour y mettre ce dont je suis embarrassé. ...Mon équipe se compose ainsi : moi, comme tireur et Gouguet, comme premier pourvoyeur, un type de la classe 18, de la Charente, un peu bête, mais qui marchera bien, je crois... Quant au deuxième pourvoyeur, il est de sortie, je m'en passerai... En allant porter nos sacs, nous voyons les pièces d'artillerie s'installer, il y en a quelques-unes !... Des 75 et des 155, installés sous de vulgaires camouflages, dans la plaine. Des 220, placés derrière le remblai de la voie ferrée... Quand tout ça, va se déclencher, ça va faire un beau barouf !...  ...D'après les derniers tuyaux qui circulent, nous devons faire cinq kilomètres et être relevés, en cours de route, par la division marocaine. Mais ce n'est qu'un tuyau et rien d'officiel ! Seulement, comme on est porté à croire tout ce qui est bon, nous prenons ça comme évangile !... ...Dans la soirée, contre-ordre ! Les grenadiers rendent leurs engins. Ils les retoucheront demain, car l'attaque est reculée de vingt-quatre heures. La journée du 9 août se passe dans le calme... Je vérifie, une dernière fois, mon instrument de fauchage, et, écris une lettre à mes parents... ...Le capitaine Troutot nous rassemble pour nous donner quelques renseignements sur l'attaque. Elle se déclenchera demain matin, à quatre heures vingt. Nous serons à Belloy. Point de direction : la droite de Lataule. Arrêt dans le verger de Lataule, puis en route sur Cuvilly, que nous devons visiter et nettoyer. Le capitaine ajoute quelques recommandations au sujet de la marche, des avions... etc... ...Nous passons l'après-midi à faire des manilles sans nombre, puis lorsque la nuit vient, nous nous couchons, afin de nous reposer un peu... A minuit, les caporaux nous réveillent... ...Comme caporal, j'ai Meunier, un drôle de type, qui passe les trois quarts de son temps à se pomponner. Il est arrivé en renfort il y a quelques jours, et il appartenait, auparavant, à la mitraille. ...Nous nous préparons en vitesse, puis, en route. La marche se fait difficilement. Les boches ont dû avoir vent de quelque chose, car ils tirent comme des damnés, surtout des obus asphyxiants. Pendant près d'une heure, nous sommes obligés de conserver notre masque en marchant... ...Enfin, nous arrivons dans la parallèle de départ, en avant de Belloy. Le 287, qui s'y trouve, fiche le camp en arrière... ...Vers trois heures et demi, nous sommes prêts. A ce moment, un fait bizarre, retient notre attention : l'artillerie boche s'est tue... mais complètement tue... Il n'y a plus une seule pièce qui tire !... La camarde passe... ...Trois heures quarante-cinq... quatre heures... quatre heures quinze... je suis la marche des aiguilles sur ma montre. Il fait un temps bizarre... De la brume... un jour blafard se lève bien doucement... A quatre heures quinze, l'adjudant s'aperçoit que le réseau Brun qui est devant la tranchée, est mal coupé; Garnier, le caporal, grimpe sur le parapet, et, en deux coups de cisaille, tranche les fils qui gênaient le passage... ...A quatre heures vingt, très précises, un coup de canon... un coup de 155, claque sec... ...L'obus n'est pas arrivé, que d'un seul coup, sur toute la ligne... 75... 105... 155... 220... entrent en action et instantanément sur toute la ligne devant nous, se forme une ligne de feu et de fumée... En même temps que ce barrage se déclenche, un ordre est crié : "En avant !..."  Nous sautons sur le parapet, et en route ! Nous marchons en ligne, tranquillement. Gouguet est à coté de moi, flegmatique, tenant en mains, ses quatre chargeurs, qu'il tient prêts à me faire passer... Je crois qu'à nous deux, nous ferons du bon travail, si l'occasion s'en présente... ...Brusquement, derrière nous claquent des coups de feu; la première vague gueule tant et plus : "Tirez pas ! bandes de c... ! Il y a quelqu'un devant vous !" Mais les coups de feu continuent... Nous sommes bien placés : boches devant et imbéciles derrière !... J'en ai assez : je me tourne vers Gouguet : "Tu parles d'une bande de fourneaux ! s'ils continuent, je leur flanque un chargeur au cul !" Mais c'est inutile, car le tir cesse... Nous continuons à marcher... Les obus sifflent drus... De suite devant nous, les 75 font le barrage roulant... Les 155 tirent un peu plus loin, et les 220, tout là-bas à l'horizon : on voit dans la brume, éclater les magoniaux et les éclats filer en l'air... Cela fait un véritable feu d'artifice !... Par endroits l'herbe brûle : ce sont les lance-flamme qui y ont mis le feu... ...Les grenadiers jettent quelques engins à droite et à gauche, pour nettoyer si les boches s'y trouvent... ...Un peu plus loin, dans un emplacement de minenwerfer, nous extrayons cinq "pleins de poux" de leur trou. Il y en a quatre qui en jettent un coup et filent vers l'arrière; mais le cinquième veut s'attarder à discuter avec nous... Mais il a affaire à des types qui ont trop souffert de leur faute, aussi n'est-il pas ménagé... Une dizaine de poilus se sont formés en cercle autour de lui et lui foutent des balles dans les jambes... Jeu idiot, car un poilu peut ainsi blesser celui qui est en face de lui; mais personne n'y pense... A un moment donné, le fritz veut se sauver, mais un des poilus qui sont là, attrapant son fusil par le canon, lui en assène un coup sur le crâne !... ...Le pauvre boche tombe sur les genoux, à moitié assommé, puis brusquement, il se lève, et fiche le camp à bride abattues... Nous poursuivons notre chemin, et sommes arrivés bientôt, dans le verger de Lataule... Nous devons y faire la pause... La première section s'étend vers la droite... Les 155 doivent faire un tir de deux heures sur Cuvilly, afin de foutre le trac aux boches et de détruire les îlots de résistance... Mais il y a une bon dieu de pièce qui tire trop court et la première section prend quelque chose comme purge... En deux minutes nous apprenons la mort d'un sergent et de deux caporaux. Il y a aussi quelques poilus blessés... ...Les fusées "rallongez le tir" s'élèvent mais rien à faire. Nous nous replions un peu en arrière, et attendons que les deux heures soient passées... ...Pendant ce temps, de chaque coté de Cuvilly, les vagues d'assaut continuent leur avance... Les prisonniers affluent en quantité. Je cause à quelques-uns : ils m'annoncent qu'ils s'attendaient à l'attaque, qu'ils sont heureux d'être prisonniers, car il y a quatre jours qu'ils subsistent sur leurs vivres de réserves, le ravitaillement n'arrivant pas en ligne, à cause de notre bombardement... ...Nous sommes visités par un avion boche, volant à faible altitude... Nous tirons dessus à coups de mitrailleuses, de fusils-mitrailleurs, de fusils... Il fait un virage et s'en retourne. ...Enfin, le tir du 155 cesse... Nous avançons sur Cuvilly. 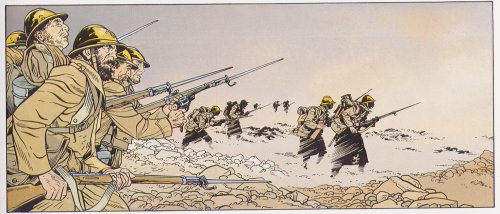 La première section passe à droite, la deuxième à gauche, et la troisième dans le pays. La quatrième est en réserve de compagnie et marche avec le capitaine. Nous entrons dans le patelin. ...A peine avons-nous commencé notre visite que nous nous disloquons : chacun va de son coté, entrant dans les maisons, dans les caves. A droite et à gauche apparaissent des fritz, encadrés d'un ou deux français... Le pays est constitué de maisons construites sur le bord de deux routes en croix. En arrivant au carrefour, je me trouve seul avec Biet, nous marchons de concert. J'ai perdu Gouguet, qui a dû, comme les autres s'attarder à visiter des caves, pendant que je continuais à marcher... Je regarde le coté gauche : le pays s'étend assez loin de ce coté. Je propose à Biet d'aller visiter ce coin. Nous nous engageons donc dans cette route et commençons à avancer. ...Nous n'avons pas parcouru cinquante mètres, que nous voyons accourir un fritz, agitant les bras... J'ai mon tacot sous le bras, m'attendant à tout, car on nous a prévenus qu'il pourrait se trouver des mitrailleuses, fauchant la rue par des soupiraux des caves... Pour éviter toute surprise : un boche nous sautant sur le paletot, au coin d'une rue, par exemple, nous marchons au milieu de la route... ...Le boche arrive vers nous : il porte une vaste paire de lunettes, et a sur le dos son sac et ses musettes. J'ai mis mon fusil sur l'épaule et tient mon revolver à la main. Biet en a fait autant... Le fritz est essoufflé par la course qu'il vient de fournit. Il ne peut que haleter : "Kamerad ! Kamerad !..."  Il conserve ses bras levés, nous palpons ses poches afin de nous assurer qu'il n'a pas d'armes. Puis je me mets en devoir de l'interroger. Il me raconte qu'il y a des copains à lui, qui nous attendent dans une cave, à l'école, au bout de la rue. Je lui demande alors : "Wieviel sind sie ? (combien sont-ils ?) - Zwanzig ! (vingt !)" Je regarde derrière moi, personne ! Nous ne sommes que nous trois ! C'est bien embêtant. Je consulte Biet : "On y va ? hein ? - C'est peut-être un bobard, qu'il nous sort là, le frère ! - Bah ! allons-y toujours. On verra bien... Si c'est un casse-cou, on trouvera toujours bien un moyen de lui foutre une balle dans la peau avant d'y passer !" Sur ce, encadrant le poilu, nous nous mettons en route... C'est assez loin, car l'école se trouve tout au fond du patelin, presqu'aux dernières maisons... Enfin, nous voici dans la cour... Nous entrons dans le vestibule. Il y a là, appuyée contre le mur, une mitrailleuse... Je dis rapidement à Biet de se tenir à la porte du vestibule... Je pose mon tacot à coté de la mitrailleuse et faisant passer fritz devant moi, je m'approche de la cave. Il se plante devant l'entrée, et gueule : "Die franzosen sind da ! (les français sont là !)" C'est aussitôt, dans la cave, un concert de hurlements à n'en plus finir; on ne s'entend plus, on ne comprend même pas ce qu'ils hurlent. Aussi, je me mets en devoir de les faire taire; je me présente à l'entrée de la cave à coté de mon boche, et crie : "Still ! hinein ! (silence, là-dedans !)" Ma foi, une douche d'eau glacée, tombant sur le crâne d'un dingo, ne produit certainement pas plus d'effet, car il se fait aussitôt un silence impressionnant... Je leur commande alors de monter un par un... ...C'est un défilé de bonshommes de toutes sortes : des jeunes, des vieux, en un mot des types de tous âges... Au fur et à mesure qu'ils passent, je leur palpe les poches, et ils doivent connaître l'art et le manière de se rendre, car ils tiennent les bras levés en se présentant et ne soufflent mot... Au cinq ou sixième qui se présente, je vois devant moi, un vieux, d'au moins quarante-huit ou cinquante ans, à cheveux blancs et l'air jovial... J'approche ma main pour tâter sa poche, mais lui, croyant sans doute que je veux serrer la sienne, prend les devants et me donne une très amicale poignée de main : "Ach ! gut Franzouse ! Ich bin sehr zufrieden ! Es gibt Fleisch da ! Hier ist eine Offizierküche ! (Ah ! bons Français ! Je suis très content ! Il y a de la viande ici ! C'est une cuisine d'officier !)" Il m'a l'air bien gai, ce vieux-là ! Puis, le voilà qui se décoiffe et me présente son calot retourné. Il y a dedans une douzaine de cigarettes et cinq ou six superbes cigares... Ma foi, je les prends sans vergogne, et l'envoie rejoindre ses copains que Biet se charge de rassembler dans la cour... Mais il a été remarqué par les congénères qui le suivent, et, les uns après les autres, ils me serrent la main et m'offrent des cigarettes et des cigares... J'en fais ainsi une ample provision. J'ai de quoi fumer pendant plusieurs jours... Ils ont tous l'air heureux d'être prisonniers, et je n'en suis pas fâché, car la chose aurait pu mal tourner, attendu que nous en avons extrait vingt-cinq de la cave et que nous ne sommes que deux. Lorsque le dernier est sorti, je fais signe à Biet d'ouvrir l'oeil et je descends dans la cave voir un peu ce qu'il y reste. Plus un chat. Je prends mon temps et examine les lieux. C'est une popote : dans un coin, il y a une grande cuisinière, dans laquelle il y a encore du feu, et dans un coin se trouve toute une cuisse de boeuf, et, enfin, par terre, il y a un fouillis inextricable de sacs, de bidons, de couvertures, de godasses, de boules de pain KK, etc... Je fouille dans le tas et je réussis à trouver une paire de jumelles ordinaires et un revolver, très gentil. Je flanque ça, dans les poches de ma capote, et je remonte. Dans la court, je rejoins Biet, et voilà le cortège en route, pour retrouver les autres poilus. En apparaissant dans la rue, nous la voyons toute peuplée. Les types se sont amenés et ils ont visité les maisons les unes après les autres. Ils ont eu du succès car nous voyons tout un groupe de boches, au moins une cinquantaine, qui les accompagne. Nous les rejoignons, et nos boches se réunissent avec les autres. Ils ont tous un air réjoui qui fait plaisir à voir. Ils ont hâte d'être à l'arrière pour manger. En marchant, j'ai causé avec quelques-uns qui m'ont réédité, ce que m'avaient dit les premiers. Ils ont même ajouté quelques renseignements particuliers sur le vieux si jovial : il est rentré de permission, la veille au soir, saoul comme une bourrique, et nous l'avons éveillé, à peine dégrisé. C'est pour ça qu'il se montrait si jovial ! L'aspirant Belun, de la deuxième section, que nous voyons à ce moment, prend note de notre prise, en nous disant qu'il en référera au capitaine... Nos fritz foutent le camp, accompagnés de quelques poilus... Je redescends dans une autre cave, où je ramasse encore deux revolvers. J'y trouve également un gros saucisson que je place dans une de mes demi-lunes, sorte de cartouchières à chargeurs de F.M. que l'on porte sur le ventre, pendues aux bretelles de suspension de l'équipement. Je me réserve d'y goûter plus tard ! Les sections se rassemblent peu à peu. Maintenant nous ne savons plus ce que nous allons faire... D'après les tuyaux précédents, nous devrions être relevés ici, mais ça n'a pas l'air de venir vite. Effectivement, on nous fait avancer encore. Nous allons nous présenter à la sortie du pays, lorsque : tacata, tacata, tacata, une mitrailleuse boche entre en action. Nous nous collons derrière un mur de clôture, lequel est percé de trous, par où nous pouvons voir ce qui se passe en avant. Le poste de mitrailleuse est là, à cent mètres, devant nous, au bord de la route... A un moment, un des boches veut venir vers nous, bras levés, mais une autre mitrailleuse, qui est placée beaucoup plus loin vers la droite, lui tire dessus, et en entendant les balles lui siffler au derrière, fritz fait demi-tour et rentre dans son trou. La section franche est avec nous... Après avoir laissé s'écouler une heure environ, afin de dérouter les boches, ils se glissent à quelques-uns le long du fossé qui borde la route, puis lorsqu'ils sont suffisamment près, ils balancent quelques grenades dans le trou... Les engins produisent leur effet, car on voit aussitôt, une demi-douzaine de fritz, qui émergent, comme un diablotin de sa boite, et se dirigent de notre côté à toute vitesse... Enfin ! le chemin est libre ! Nous reprenons notre avance. Je me suis débarrassé d'un de mes trois revolvers, en le donnant à un cabot... Nous nous arrêtons un peu plus loin, dans un élément de tranchée, en attendant le retour d'une patrouille de cavalerie qui est partie reconnaître le terrain en avant... Elle ne tarde d'ailleurs pas à revenir et nous apprend, que jusqu'à trois kilomètres, au moins, il n'y a plus de fritz ! Nous nous remettons en marche. Nous traversions Orvillers-Sorel sans incident... La section passe à droite du pays. Il s'y trouve quelques emplacements de pièces, dont nous visitons les cagnas. J'y trouve un superbe revolver de gros calibre, pouvant former mousqueton : je l'adopte immédiatement, naturellement ! Enfin, continuant notre marche, nous arrivons à Conchy-les-Pots. C'est là que nous devons passer la nuit. Nous parvenons dans les jardins des dernières maisons du pays, dans lesquels l'artillerie française a creusé des entonnoirs énormes. Nous nous mettons une dizaine dans chacun de ces trous, et voilà notre logement. Avant de m'endormir, je range mes prises de guerre dans mon sac, en me félicitant de la bonne idée que j'ai eu de le garder, car s'il me fallait porter tout ce que je possède dans des musettes, je ne le pourrais pas. ...En effet, en plus de mon fusil de dix kilos, j'ai ma musette spéciale, contenant quatre chargeurs, emplis chacun de vingt cartouches et de la trousse à nettoyage, puis deux musettes, garnies l'une de mon linge et l'autre de mes vivres; plus mon ceinturon et mon revolver, et enfin mon sac... Celui-ci vaut la peine qu'on en parle. Extérieurement, il comporte la couverture, la toile de tente et la pelle-pioche. Intérieurement, il y a deux revolvers de calibre ordinaire, un revolver de gros calibre, une paire de jumelles, deux obus de 37, complets, une douille de 37 ouvragée, un calot boche et de la correspondance ainsi que des brochures. J'en ai ma claque, mais enfin, du moment que je pouvais marcher, tout était pour le mieux. Je disposais tout ça avec art dans mon sac, afin que tout y entre, puis je m'endors, doucement bercé par la voix du canon grondant à droite et à gauche. De notre côté, calme plat. La nuit est bien tranquille. Je dors du sommeil de l'innocence, d'autant plus que je suis bien fatigué et pas fâché de reposer mes pieds qui me font bien mal, surtout qu'au pied gauche, un furoncle est poussé et ça ne va pas mieux. Mais ça n'a pas d'importance : il guérira tout seul ! Dans la matinée du dimanche 11 août, nous ne bougeons pas. Ce n'est que vers une heure de l'après-midi, que l'on nous apprend qu'on doit attaquer en avant de Conchy-les-Pots. Nous ne nous en ressentons pas beaucoup. C'est que les quelques tanks légers, qui sont restés une demi-heure avec nous, hier matin, sont invisibles aujourd'hui et que de plus nous n'entendons pas un coup de canon, ni d'un coté, ni de l'autre.  Mais on doit attaquer, on attaquera !... Nous voilà partis, lorsqu'en débouchant d'un boqueteau, sans rime ni raison apparentes, on nous fait faire demi-tour, et nous rentrons dans Conchy-les-Pots que nous traversons. Nous en ressortons sur la droite, et comprenons alors : au lieu de se faire de face, l'attaque se fera de flanc... Nous avons la voie ferrée, à droite et nous la suivons dans la plaine, à une certaine distance... Nous marchons en ligne de demi-section par deux. Le calme revenu, car il n'y a pas l'air d'avoir de boches, on n'entend rien ! Mais nous avons à peine parcouru huit cent mètres, que, brutalement, coup sur coup, viennent éclater quatre gros noirs... C'est aussitôt la pagaille ! Les poilus se dispersent à droite et à gauche, pas trop en arrière. Ma section qui se trouve le plus à droite, oblique et va se placer le long de la voie ferrée... Je cherche Meunier, mon cabot, mais pas plus de bonhomme que dans le creux de ma main; je me rends compte alors que je ne dois pas compter sur lui... Un obus, et... pfuitt !... le voilà qui file !... J'en prends bonne note et m'en souviendrai à l'avenir... Nous continuons notre marche en avant et arrivons à une tranchée dans laquelle nous descendons et que nous suivons. Au bout d'un instant, arrêt brusque ! Nous nous apercevons alors que nous sommes dans une position moins qu'intéressante. Les magoniaux rappliquent drus autour de la tranchée, et, en un rien de temps, les blessés ne tardent pas à filer vers l'arrière... Nous passons là, l'après-midi, nous attendant à chaque minute à recevoir un gros noir entre les deux yeux... Sitôt que la nuit est venue, en avant ! Nous suivons le boyau et rejoignons ainsi la voie ferrée, le long de laquelle nous nous installons, en bas du remblai... Un poilu par section est détaché en haut, sur la voie, pour monter aux gaz... A deux heures, c'est mon tour. Je grimpe sur la voie et m'installe là-haut... Pourvu qu'un train ne passe pas !... Mais en fait de train, ce sont des gros asphyxiants, qui viennent foirer sur le talus... Dès que je sens l'odeur de l'ypérite, je me précipite en bas pour réveiller la section... Mais tous les poilus dorment comme des souches, et avant que j'en ai réveillé quelques-uns qui, eux-mêmes réveillent leurs copains, il est trop tard pour mettre mon masque !... J'ai avalé une bonne quantité de poison et me voilà parti à rendre tripes et boyaux... En même temps je m'asseois sur le cul, ne pouvant plus me tenir, pendant qu'un tremblement, impossible à réprimer, me prend tout le corps... J'avertis l'adjudant Jayet, qui m'envoie vers le capitaine Troutot. Je vais voir ce dernier : "Mon capitaine, lui dis-je, je suis pris par les gaz. J'ai été obligé de prévenir les camarades et je n'ai pas eu le temps de mettre mon masque, ça ne va pas du tout. Est-ce que je pourrais aller jusqu'au poste de secours, prendre quelque chose ? - Bah ! Avale un bon coup de pinard, ça se tassera !"  ...Ces trois derniers mots constituent son argument favori, quand il a dit ça, il a tout dit ! Ma foi, ses paroles me redonnent du courage. Mais je ne me sens pas en train pour boire du vin. J'ai du jus dans mon bidon, je préfère ça. Je m'en verse un quart. Il est bien frais et me ragaillardit... Néanmoins pendant un grande heure, ça ne va pas mieux, puis ça s'apaise et me revoilà d'aplomb... Je prépare une cigarette pour fumer, dès qu'il fera jour... Vers quatre heures, on nous fait préparer, nous allons remettre ça pour la troisième fois en trois jours. Cette fois, il nous faut le bois des Loges... Je prends le temps d'allumer ma cigarette avant de démarrer... Le capitaine est en haut du remblai. Il inspecte l'avant... La compagnie est réserve du bataillon, et, par conséquent, marche en deuxième vague. Il faut du doigté pour la conduire... ...Attention... Le capitaine lève le bras. Un signe !... En avant... Nous grimpons le remblai, traversons les voies au pas gymnastique et dégringolons de l'autre coté... Il était temps !... Nous n'avons pas fait cinquante mètres que le barrage boche se déclenche en plein sur la voie. Quelques obus viennent bien s'aplatir autour de nous, mais nous n'avons toujours pas le gros du barrage à traverse... Maintenant, ce sont les mitrailleuses qui s'en mêlent... Gouguet ne me lâche pas d'une semelle... Là où on me voit, on est sûr de le trouver... Les fritz nous font un barrage à coup de gaz. Nous sommes obligés de mettre notre masque. Je fais comme les autres, mais je le garde l'espace d'une minute, puis voyant que je ne peux pas respirer en courant, et que de plus, il m'empêche de finir ma cigarette, je le retire ! L'attaque a l'air d'être dure, mais nous avançons quand même : c'est le principal... Nous arrivons enfin à une tranchée dans laquelle nous descendons. Je tiens mon fusil à pleine main, la crosse appuyée par terre. Je suis à peine descendu que je sens une piqûre sur le dos de la main droite. Je regarde : une goutte de sang perle. Un éclat minuscule a du me toucher... Mais ce n'est rien. Je lèche le sang avec ma langue et l'affaire est faite... Nous nous déployons un peu. Je suis placé, en ma qualité de F.M. auprès d'un ponceau qui passe sur la tranchée. Je dois prendre le chemin qui est devant moi, d'enfilade. Je mets mon tacot en batterie et j'examine le terrain... Devant nous, à huit cent mètres, le bois des Loges. Je crois que nous ne sommes pas prêts de l'avoir, car les boches ont l'air de faire de la rouspétance ! Néanmoins, une compagnie y est arrivée; d'après les bruits qui circulent, ce serait la neuvième... A un certain moment, tout le monde gueule avec ensemble : "Les boches ! attention ! Vlà les boches !" Je regarde attentivement, mais je ne vois rien, il est probable qu'il en est de même des autres. Je me tiens, néanmoins, dans l'expectative, mais rien ne vient, quoique d'après les bruits qui se font en avant, les boches ont du déclencher une contre-attaque. Devant nous, à une cinquantaine de mètres, un blessé geint. Il pousse des hurlements à fendre l'âme : "Venez à mon aide ! Je ne peux pas marcher ! Ne me laissez pas là ! Achevez-moi !" Je n'ai pas le droit de me déranger, sans quoi j'irai bien. Mais deux autres poilus se décident et vont à son secours. Ils le ramènent. Le pauvre diable doit sérieusement souffrir, car il a les deux pieds arrachés par un obus. Ils ne tiennent plus à la jambe que par des lambeaux de chair. Le poilu est blanc comme un mort... dont il ne vaut guère mieux, d'ailleurs, car je crois qu'il n'a plus longtemps à vivre... Les poilus lui font un pansement bien sommaire, puis sont obligés de le laisser là, car nous allons nous déplacer... En suivant la tranchée, et en enfilant un bout de boyau, nous allons dans une autre, parallèle à celle que nous venons de quitter. Mais elles est beaucoup plus moche : un mètre cinquante de profondeur et au moins trois mètres de large dans le haut. Il est vrai que nous n'y restons pas. Nous nous dirigeons vers un boyau qui file droit vers le bois des Loges. Le commandant fait monter une patrouille sur la plaine, avec mission de se rendre compte de ce qui se passe en avant. Le sergent Kervégan la commande... Les poilus montent sur le parapet et entament leur mouvement... Les boches les laissent avancer, puis, lorsqu'ils sont à bonne portée, déclenchent dans le tas, un tir de mitrailleuse.  Les poilus sont obligés de se replier, laissant un tué, sur le carreau : Latournerie, un agent de liaison de la compagnie... Le commandant en aurait pleuré : "C'est de ma faute, c'est de ma faute !" répète-t-il. Nous, nous sommes restés dans le boyau en attendant le résultat de la patrouille. Mais il est pris d'enfilade par les Fritz, qui, nous ayant laissé nous avancer, se mettent à nous tirer dessus à coup de 88... Le commandant Lantuéjoul donne alors l'ordre de se replier et de prendre position dans la tranchée... Le coup est loupé... Le bois des Loges n'est pas pour nous, aujourd'hui, du moins... Mais les Frigolins ne veulent pas en rester là. Sans doute ont-ils repéré notre tranchée, car voilà qu'ils font un violent barrage de 88 et de 105 percutants et fusants sur notre malheureux trou. Qui se fera jamais une idée de la souffrance morale endurée à ce moment par des hommes avachis par la fatigue et ayant à supporter une avalanche de fer tombant en plein but ! Ecouter les râles des mourants et les cris de souffrance des blessés, ne rien pouvoir y faire, c'est terrible !... ...Quelques poilus sont touchés : Armange est tué d'un éclat d'obus dans la tête, c'était le cousin de Meslet : voilà une famille bien éprouvée !... Puis c'est Chièze qui a un éclat dans la poitrine... Héritier, un signaleur, un éclat dans la cuisse. ...Puis le tir s'apaise et s'arrête. J'en suis quitte pour l'angoisse... Il fait un temps superbe. Nous veillons... Trollet, le cabot de la douzième, a trouvé une jumelle prismatique Zeiss, qui me fait envie. Nous nous entendons : je lui donne un des deux revolvers boches qui me restent et la paire de jumelles ordinaires qui sont en ma possession, et il me remet la sienne. J'explore le terrain : je fais ainsi la découverte d'un petit poste installé à la lisière du bois des Loges... Ils ont l'air bien calmes, ces messieurs ! Mais, vers sept heures du soir, alors que les poilus de corvée prennent leurs dispositions pour partir, voilà que l'artillerie française se met à faire un tir de barrage dans la plaine devant nous... Fritz prend peur et, illico, les fusées vertes à deux feux s'élèvent des lignes ennemies, et, en moins de deux minutes, voilà que comme tout à l'heure, le barrage boche, nous arrive sur la tirelire. ...Roland, un poilu qui se préparait à partir à la soupe, tombe comme une masse. Il a été touché aux jambes... De deux coups de couteau, nous lui ouvrons sa culotte... Un éclat assez gros, lui a fait une forte blessure à la cuisse gauche, et il en a une autre au mollet droit, mais insignifiante... Du sang noir et épais coule de cette ouverture... Il geint comme un malheureux et se voit foutu... Tout en lui faisant son pansement, j'essaye de le raffermir : "Allons, mon vieux, t'as de la chance, tu coupes au ravitaillement, et, en douce, t'as le filon. Tu vas aller passer un bon moment à l'hôpital, et, d'ici que tu sortes, la guerre sera peut-être finie ! - Penses-tu, me répond-il, si je m'en sors, j'aurai une guibole de moins... Oh ! que je souffre !" Breton, un sergent qui m'aide, a, à ce moment deux doigts de la main gauche fauchés par un schrapnell, qui vient de foirer, à deux mètres à peine de haut... après Roland, c'est à lui que nous devons faire son pansement... Nous nous voyons dans une foutue position, d'autant plus que malgré les 88 qui rasent le parapet, il faut veiller toujours. Sur notre droite, à la quatrième section, il y a encore un tué. Comme le premier, ce tir cesse assez rapidement. Le barrage français a fini également. Nous pouvons, enfin, respirer. Mais, il y a du boulot pour les brancardiers. A peine sont-ils revenus de porter un blessé qu'il y en a un autre à emporter... Enfin, la nuit vient. Heureusement, car nous pouvons enfin, nous reposer tranquillement, convaincus qu'il ne se passera rien. ...Et, il ne se passe rien, en effet... Nous apprenons qu'il y a eu deux tués et une quinzaine de blessés, pour le moment, et, comme tuyau, que la relève n'aura lieu que lorsque le bois des Loges sera pris... En moi-même, je pense que nous sommes là pour un moment, et qu'il y aura pas mal de croix de bois, d'ici qu'il soit pris, car les Frigolins ont l'air décidé à se défendre. ...Au petit jour, l'artillerie française, histoire de se réveiller, recommence son petit jeu de la veille, et déclenche son barrage dans la plaine... Que d'obus perdus pour rien ! Pour rien ? Non, car il y a un résultat : celui de faire déclencher le barrage boche illico presto ! Une vingtaine de minutes de bombardement et ça s'arrête. Personne de touché, à la section : une véritable chance ! ...Le soleil darde dur, d'aplomb sur notre tranchée. Il fait une chaleur insoutenable. Plus rien à boire, tous les bidons sont vides; l'odeur de la poudre donne soif et la chaleur aidant, nous avons séché tout ce que nous possédions... Quelqu'un parle d'aller chercher de l'eau, mais c'est une rude corvée : il faut aller jusqu'à Conchy-les-Pots, et il y a bien cinq kilomètres. Mais là, n'est pas le plus dur. Ce qui nous embête davantage, c'est l'avalanche de 150 et de 210 qui tombe en arrière, sur le 154 qui est établi à quinze cent mètres derrière nous ! ... Mais la chaleur est trop forte, et, à un moment n'y tenant plus, et tirant par trop la langue, je me décide. On n'a pas le droit de s'éloigner des lignes, sans autorisation; aussi vais-je voir le commandant Lantuéjoul, afin de le questionner. Il est dans un trou avec le capitaine Troutot : "Pardon, mon Commandant, je viens vous demander la permission d'aller avec un copain, chercher de l'eau pour la compagnie. Nous n'y tenons plus : il fait trop chaud ! - Oui, eh bien, vas-y, mon garçon. Mais ne soit pas longtemps. Tiens, prends donc mon bidon, tu m'en rapporteras un peu à moi, aussi !... - Merci, mon Commandant !" Ma foi, il m'aurait donné son porte-feuille que je n'aurais pas été plus heureux que de cette permission accordée. Je prends son bidon et je retourne à la section. Je demande qui veut venir avec moi, et, naturellement c'est Gouguet qui s'offre. Je m'y attendais, car les autres sont trop peu courageux pour se risquer ! Nous ramassons des bidons à droite et à gauche, j'y joins les deux miens, et en route !... Nous suivons un bout de tuyau, d'une centaine de mètres, puis il faut se glisser de trou d'obus en trou d'obus jusqu'à la contre-pente. Ensuite, plus rien à craindre : les boches ne peuvent plus nous voir. Nous descendons alors tranquillement. Nous suons à grosses gouttes; la tête bout et fermente sous le casque, qui est lui-même, bouillant... Enfin, nous voici à Conchy. Là est une source qui coule constamment, dans un tonneau, enfoncé en terre, plein jusqu'au bord, et dont le surplus s'en va dans le fossé de la route... ...J'ai tellement soif que je ne prends même pas la peine d'enlever mes bidons. Je me jette à plat ventre et bois à longs traits. Ce n'est qu'à bout de souffle que je m'arrête... Cette eau fraîche m'a fait du bien... J'enlève mon casque et je me plonge la tête dans le tonneau pour calmer l'agitation qui fait bouillonner mon cerveau. Gouguet en fait autant, puis nous nous mettons en devoir de remplir nos bidons. Nous en avons une douzaine chacun : soit vingt-quatre litres d'eau... Une fois que nous les avons réunis sur le dos, nous en avons notre charge, car nous avons au minimum trente kilos sur les reins, et pour monter la côte, nous suons sang et eau ! Pour comble de malheur, le voyage qui s'était effectué tranquillement à l'aller, est troublé au retour par un violent bombardement à coups de 210 sur les positions du 154. Il nous faut alors bondir entre deux éclatements, d'un trou à un autre, avec nos douze bidons, nous ballottant autour du corps, recevoir la terre sur la tête, en un mot, un tas de petits inconvénients bien gênants. Ce n'est pas sans mal que nous poursuivons notre route, et nous sommes bien heureux lorsque nous arrivons en haut. Il n'y a plus alors que trois cents mètres à parcourir, dont deux cents, en plaine. Zut ! pour les précautions. Nous prenons notre élan et nous parcourons les deux cents mètres en un rien de temps... Nous nous jetons dans le boyau... Enfin, nous voici arrivés !... Je vais tout d'abord porter le bidon au commandant et lui rendre compte que je suis rentré à bon port. Son merci m'enlève toutes mes fatigues, car il a l'air tellement heureux que c'est tout ce que je demande. Je distribue ensuite les bidons à droite et à gauche; quelques engueulades parce que j'ai donné le bidon de l'un à l'autre, et... pas un merci !... Heureusement que ce n'est pas pour ça que je me suis dérangé, mais seulement pour le plaisir personnel de rendre service aux copains ! Les poilus se jettent sur leur flotte comme des joueurs sur leurs cartes; ils sont contents, c'est tout ce qu'il me faut ! ...Vers six heures du soir, les français demandent le barrage sur notre droite. L'artillerie se déclenche aussitôt, mais ces imbéciles d'artilleurs qui n'en font jamais d'autres, l'étendent devant nous, et fritz pour ne pas manquer à son habitude, répond du tac au tac, et comme le matin, comme la veille, 88, 105 et 130 rappliquent à foison ! Nous nous étendons à plat ventre dans le fond de la tranchée et laissons passer l'orage... Sintorin, un cabot de la première mitraille, est tué net, à sa pièce... Cadiot, le cabot de la onzième a le mollet traversé en séton, par un schrapnell... Enfin, nous n'avons pas trop de mal, ce coup-ci et ça se termine assez rapidement... Les blessés fichent le camp en vitesse. Quant à nous, nous apprenons un tuyau qui nous fait plaisir : nous sommes relevés par le 154 cette nuit... A onze heures, les poilus de relève arrivent, et nous filons à toutes jambes, en réserve de division. Nous nous trouvons dans le boyau au-dessus de Conchy-les-Pots, où nous avons passé la nuit du 11 août... La journée se passe dans des alternatives de quiétude et d'embêtements. En effet, les boches bombardent toujours les réserves, et ils emploient à cet effet des obus à gaz; aussi presque toutes les demi-heures, sommes-nous obligés de mettre le masque. Cela devient rasoir !... Dans l'après-midi, nous apprenons que Maunont, un grenadier de la neuvième escouade, s'est blessé d'une balle de revolver, qui lui a traversé un doigt... Encore un qui fiche le camp ! Le soir, je vais au ravitaillement. C'est assez loin, dans un ravin, sur la droite de Conchy, et j'en ai ma claque en rentrant ! Le lendemain se passe de la même façon : quelques gaziers qui viennent foirer sur le parapet. Pas de mal, nous commençons à nous y habituer, maintenant. Mettre le masque, l'enlever, devient une seconde nature ! Dans la nuit, corvée de munitions : on rapporte des grenades, des fusées, des cartouches... Mauvais présage !... La nuit se passe tranquille... Dans la matinée du 16, des tuyaux circulent : Poincaré, serait, dit-on venu à Conchy, s'entretenir avec Caron, au sujet du bois des Loges, et le général lui aurait répondu : "Je vous jure sur mon honneur que ma division prendra le bois des Loges." Il promet, lui, mais il faut que ce soit les poilus qui tiennent !... Vers quinze heures, nous sommes alertés. Distribution de fusées et de grenades. Mais le départ n'a lieu que vers dix heures trente. Les poilus du ravitaillement s'en vont à leur corvée, pendant que nous prenons la direction de l'avant. Leurs affaires nous ont été distribuées, afin qu'ils ne soient pas trop chargés. Nous filons dans les boyaux, puis à travers la plaine et nous nous arrêtons, un moment, dans une tranchée qui vient d'être abandonnée par le 287. Nous devons y attendre la soupe, mais elle ne vient pas vite. Les poilus ont dû se perdre, car ils devraient être là depuis longtemps... Enfin, il est trois heures passées, lorsque deux poilus arrivent avec des bouteillons. Ils sont partis en avant, nous disent-ils, car ça ne marchait pas. Le cabot qui commande la corvée courait pour commencer et semait ses poilus à droite et à gauche; aussi a-t-il été forcé de revenir en arrière les chercher. D'où, perte de temps, et c'est pour ça que la corvée est en retard. Ce n'est que lorsqu'il ne reste plus qu'un quart d'heure, à peine, que tout notre ravitaillement arrive ! Et c'est alors une discussion avec Meunier, mon cabot, pour la distribution... Il s'est blotti dans son trou, et n'en veut plus sortir, parce que les boches font un tir de harcèlement autour de notre position, et ce gradé... qui devrait donner l'exemple... chie terriblement dans sa culotte... Je vais à son trou, car il m'agace rudement : "Eh ! Meunier, tu viens faire la distribution ? - Oh ! Tu n'as pas besoin de moi ! Vous n'avez qu'à vous servir vous-mêmes ! - Mais non ! Tu es cabot. Tu ne vas pas au ravitaillement, tu peux faire la distribution. Tu es là pour ça !" Mais il ne veut absolument rien savoir, et l'adjudant Jayet, qui est dans un trou à coté, est obligé de lui secouer les puces pour le décider. Ce n'est pas sans regret qu'il quitte son trou, mais enfin, je suis heureux tout plein que ce bougre de fainéant ait été obligé de faire son service !... La distribution a lieu à une allure précipitée : nous nous partageons le pain, le vin et le casse-croûte. Quant aux légumes, barca ! Il ne faut pas songer à les emporter. On renverse le contenu des bouteillons sur le parapet, et il n'est que temps d'être prêt, car on va démarrer... A quatre heures l'artillerie française commence son tir, et le 287 s'élance... Des coups de fusil, de mitrailleuse, de grenade claquent... Les boches doivent résister sauvagement.. Nous, nous filons sur la gauche, par un boyau qui va vers le bois... A un carrefour, il faut piquer un fameux pas de course, car le coin est bien sonné... Enfin... nous sommes sur la lisière du bois des Loges ! Des poilus du 154 et du 287 ont déjà commencé à y pénétrer. Nous traversons le bois dans toute sa longueur, et chemin faisant, nous visitons les trous, les boyaux, les tranchées, et il y en a : c'est un véritable labyrinthe !  Nous rencontrons des poilus du 154 et du 287, puis plus personne ! Nous continuons, néanmoins notre avance, et nous arrivons relativement vite de l'autre coté du bois... Une vieille tranchée est là, à moitié comblée, qui descend dans la direction de Canny-sur-Matz, là-bas vers notre droite. Mais, nous ne voyons pas un poilu français, ni devant, ni à droite, ni à gauche !... Nous sommes isolés, nous avons perdu toute liaison... Mais le bois des Loges est pris ! Il est à nous... et, entre nous, nous nous demandons si ce n'est pas la première compagnie du 155 qui l'a pris... car, enfin, nous avons traversé le bois sans rencontrer personne, nous étions donc en première vague !... Comme réserve de division, c'est chic !!!... Nous nous installons dans la tranchée, en nous déployant vers le droite... Nous ne sommes pas nombreux, mais nous nous écartons le plus possible, afin d'occuper le plus de terrain que nous pouvons !... Le capitaine envoie une patrouille explorer le terrain vers la droite. Elle s'en va en prenant ses précautions et au bout d'un long moment, revient nous annoncer qu'il n'y a personne, sur un parcours d'au moins douze cents mètres, et que les premiers poilus rencontrés, sont des poilus du 28, qui sont en position derrière Canny-sur-Matz ! Les boches nous font un petit tir. La pièce qui nous embête ainsi, est placée dans un petit boqueteau, à deux kilomètres, environ, derrière les lignes boches. Mais elle ne nous ennuie pas longtemps, car une pièce de 155 la prend à parti... A la jumelle, je vois les obus s'écraser autour du boqueteau... puis dedans... et c'est la fin... la pièce boche s'est tue !... Poussant mon exploration, grâce à ma jumelle, je découvre un petit poste boche, en avant de Canny. Je distingue parfaitement, la mitraillette qui est sur leur parapet. A un moment, je vois un fritz qui grimpe, et en se baissant, va dans un trou d'obus, faire, sans doute, ses besoins. Il reparaît au bout de dix grandes minutes, et regagne son trou... Vers deux heures de l'après-midi, nos 155 et nos 175, déclenchent un tir de barrage roulant devant le patelin, et le 28e sort de ses trous... J'ai alors l'occasion de suivre une attaque à la jumelle. Je vois les poilus du poste boche se dresser et sauter sur leur mitraillette, mais... ce n'est pas pour se défendre. Ils l'attrapent à deux, un par la crosse et l'autre par le canon, et les voilà qui en jettent un coup à travers la plaine... Ils s'engouffrent dans un boqueteau, et on ne les voit plus... Canny est pris et les types du 28 sont placés à notre hauteur... Le front est rectifié... La soirée se passe tranquille. Nous apprenons, d'abord que les prisonniers boches, faits dans le bois des Loges, appartiennent au 13e régiment de la Garde, qui a relevé le 359, il y a deux jours; puis, comme second tuyau, on nous annonce la relève de la division par une division se trouvant à Conchy-les-Pots. Le 155 est remplacé par le 297 d'infanterie. Nous ne sommes pas fâchés d'aller nous reposer un peu tranquilles, car depuis le 11 juin, à part les premières lignes, les petits postes, les corvées, les travaux de nuit, et les attaques depuis le 10 août, nous n'avons guère eu de repos. Aussi, est-ce avec un soupir de soulagement que nous voyons arriver le 297, vers une heure du matin, et nous ne sommes pas longs à filer vers l'arrière, je peux même dire que nous en prenons la direction au pas gymnastique ! Le dimanche 18 août se passe dans la quiétude, la plus complète : nous nous trouvons dans le bois de Lataule, car tout le régiment n'ayant pu trouver place dans les villages de Cuvilly et de Lataulle, le premier bataillon se trouve campé dans les cagnas boches du bois... Ma foi, il fait beau temps, nous n'y sommes pas plus mal ! Dans l'après-midi, je vais à la coopérative, faire une corvée de pinard pour la section : j'en rapporte quelques bouteilles de cacheté, ainsi que des journaux. J'ai, en ma possession, le Petit Parisien, qui publie justement un article, intitulé : comment fut pris le bois des Loges, dans lequel il fait un éloge de la division, ajoutant que c'est ce même général, qui, le 11 juin, a passé les lignes, avec son auto, pour conduire ses poilus à l'attaque... Il fut un temps où les généraux et les maréchaux se servaient de chaises à porteurs ou de chevaux; maintenant, c'est l'automobile !... O modernisme, où nous conduis-tu ?... Quand les bouteilles de vin sont vides, histoire d'essayer mon pistolet boche, je les aligne contre un talus, et à vingt mètres, les unes après les autres, je m'amuse à les descendre ! Le 19, le repos est aussi complet. J'apprends que j'ai été proposé, avec trois autres poilus, pour le grade de caporal. Ce sont Tripier, Carré et Parison. Le lendemain matin, à quatre heures, réveil : nous devons changer de place. Nous nous équipons et le rassemblement de la compagnie s'effectue... Mais à six heures du soir, nous sommes encore là ! Nous rentrons chacun dans notre cagna et il n'est plus question de déménagement... Pendant deux jours encore, nous nous reposons dans la quiétude la plus complète... Les nominations sont revenues : seuls Tripier et Carré sont nommés cabots. Parison et moi restons sur le tapis. Bah ! ce sera pour une autre fois ! Chaque matin, je vais voir le major, sans me faire porter malade... En effet, avant le départ du 10 août, j'avais un furoncle au pied gauche, et n'ayant pu le faire soigner au cours de l'attaque, il s'en envenimé... Il y en a maintenant trois sur le pied gauche et quatre sur le pied droit ! je suis bien arrangé !... Le 23, il y a prise d'armes pour remise de décorations. J'y vais, quoique ayant de la peine à marcher, car on doit me remettre une étoile. Je suis cité à l'ordre du jour de l'infanterie divisionnaire, avec la citation suivante : "Excellent fusilier-mitrailleur. A fait preuve d'initiative et d'audace, pendant les affaires des 10, 11 et 12 août 1918. A assuré le nettoyage de Cuvilly et procédé à la capture de nombreux prisonniers ennemis."  Cette prise d'armes est le seul travail que nous fournissons pendant notre repos... Le lundi 26 août, on nous fait déménager, à six heures trente, pour avancer dans la direction des lignes. Nous nous établissons dans le parc du château d'Orvillers-Sorel... Le capitaine Troutot part en permission et le commandement est confié au sous-lieutenant Chardon... Dans la journée on nous supprime nos demi-lunes. Nous n'en sommes pas fâchés, car c'était rudement gênant pour s'asseoir, ces deux grandes cartouchières sur le ventre ! Nous n'avons plus maintenant que le ceinturon et le revolver... Nous passons la nuit sous la tente... Il y a deux jours, nous avons reçu un renfort du dépôt divisionnaire. A la section, il nous vient un cabot : Chevallier, qui remplace, à la neuvième escouade, Garnier, nommé sergent, et quelques poilus, qui sont répartis entre les quatre escouades. Nous sommes ainsi, en mesure d'affronter les lignes, à nouveau ! Vers neuf heures du matin, le lendemain, nous sommes alertés, défense de s'éloigner. Il paraîtrait que, d'après les observations d'avions, les boches se prépareraient à un recul. Aussi, comme conséquence, le 154 doit attaquer demain matin, et le premier bataillon du 155 sera à sa disposition, comme soutien. A vingt heures, sac au dos, et nous prenons en colonne par un, la direction des lignes. Cette fois, nous appuyons sur la droite, et au lieu de remonter vers le bois des Loges, nous allons sur Canny-sur-Matz. A minuit, la relève était finie, et nous pouvions prendre un peu de repos, avec le fond de la tranchée comme matelas... A quatre heures cinquante, l'artillerie française comme son tir par un barrage fixe de dix minutes... A cinq heures, il devient roulant... Le 154 sort à ce moment. Une demi-heure passe, puis nous démarrons. Nous commençons à marcher en colonne de demi-section par deux... C'est tranquille : pas un coup de fusil, ni de canon boches.  Un moment plus tard, nous voyons le caporal-tambour, chef de la liaison du colonel, qui vient réquisitionner la troisième section, pour en faire une chaîne de coureurs entre le commandant Lantuéjoul et le colonel Lequeux... Comme Lequeux s'avance, nous nous préparons à en faire autant, mais nous recevons l'ordre de rester là, et la chaîne change : nous servons maintenant de liaison entre Lequeux et le colonel Goybet, commandant l'infanterie divisionnaire de la 165. Cela dure comme ça jusqu'à midi, puis à ce moment comme Goybet avance son P.C., nous recevons l'ordre de rejoindre la compagnie. L'attaque marche très bien. Nous suivons la grand'route. C'est une véritable promenade militaire ! Nous croisons en chemin, des groups de prisonniers, et à un endroit, un boche qui est en train de pourrir là : il est déjà tout noir. Il a dû être touché par un obus. La tête plonge dans l'entonnoir et le derrière se dresse en l'air; ça a une allure sinistre, surtout si l'on ajoute au tableau, les mouches noires qui bourdonnent autour du corps ! ...Poursuivant notre route, nous approchons de Condor, un pays assez important. Mais les boches rouscaillent, et voyant les réserves approcher, ils envoient quelques 130 qui éclatent à droite et à gauche, sans grand résultat. Enfin, nous rejoignons la compagnie, juste à temps pour voir un obus tomber en plein, sur un groupe, formé de quatre brancardiers, emportant un blessé sur une civière. Les cinq poilus sont tués nets... Nous nous arrêtons au carrefour de deux chemins et j'en profite pour examiner le terrain. Dans le fond et encore assez loin, le canal du Nord, au bord duquel se trouve Cattigny. A notre gauche, Ecuvilly, et à droite : Condor, que nous venons de passer. ...Vers quatre heures, nous venions de recevoir des journaux par des agents de liaison et nous étions à cinq, adossés à un talus bordant un chemin, en train de lire le canard, lorsque, sans avoir rien entendu, nous sommes assourdis par une détonation en même temps qu'enveloppés par un nuage épais de fumée et de poussière... La terre me retombe sur la tête... Je me relève, et, constatant que je n'ai aucun mal, je jette un coup d'oeil autour de moi... Je vois deux brancardiers qui accourent, croyant avoir des morceaux à ramasser... Mais personne n'est touché, et pourtant l'obus est tombé à cinquante centimètres, à peine au-dessus de nos têtes !... C'est une chance et une vraie !!! Nous nous secouons et changeons un peu de place... Nous ne sommes pas mieux garantis, puisque, comme abri nous avons le ciel, mais enfin, nous sommes un peu éloignés de l'endroit où nous avons eu notre émotion, et c'est le principal !... Nous passons ainsi la nuit, adossés au talus. Je vais chercher la soupe à Condor. Au centre du pays, les boches ont fait sauter une mine sous la place, et il y a un entonnoir suffisamment grand pour y mettre une maison de deux étages ! Vers quatre heures du matin, nous avançons dans la plaine, avec l'espoir d'aller jusqu'à Cattigny, mais nous faisons à peine un kilomètre et nous nous arrêtons sous des pommiers qui parsèment la plaine... Sérandour, un poilu de la section, vient de recevoir une lettre dans laquelle, on lui annonce la mort de Roland, décédé des suites de ses blessures. Les boches bombardent fortement Ecuvilly, avec des 210, et les éclatements sont noirs ou rouges, suivant que l'obus est tombé sur une maison couverte en tuiles ou en ardoises... Les éclats reviennent jusqu'à nous... A un moment, Meunier en reçoit un sur le bras. Le voilà parti à gueuler comme un putois ! Il flanque son équipement et ses musettes en l'air. Il tient son bras ankylosé, on croirait qu'il est cassé... Il n'a rien : nous en ferions le pari, volontiers !... Puis, le voilà qui s'en va au pas de course, vers l'arrière... vers le poste de secours...  Nous lui crions bonne chance, et nous le pensons sincèrement, car, nous voudrions bien en être... débarrassés, surtout moi, car il me dégoûte comme pas un !... Mais il fallait s'y attendre, et au bout d'une demi-heure, nous le voyons revenir, l'air péteux, comme un renard qu'une poule aurait pris ! Ce n'est pas encore ce coup-ci qu'il débarrassera le plancher de sa personne ! Le restant de la journée se passe sans incident pour la section. Dans la nuit, nous déménageons, vers deux heures du matin, pour aller en avant remplacer le 154, qui a pris une forte purge ! Nous voilà devant Cattigny, que nous devons attaquer à cinq heures quatre... L'artillerie française doit faire un barrage fixe de quatre heures cinquante à cinq heures quatre, et roulant ensuite, comme le 28 Août. A l'heure dite, le pays est sonné par nos obus. L'un d'eux tombe sur une maison dans laquelle se trouve un dépôt de cartouches. Voilà la maison en feu. Les cartouches explosent et ça fait un crépitement ininterrompu... Les boches envoient quelques fusées vertes pour demander le barrage, et, à peine deux minutes après, voilà les zin-zin qui rappliquent dans la plaine autour de nous... Heureusement, il y a un endroit où ça tombe moins, et nous en profitons pour passer. Nous nous engageons dans le pays, mais il y a une bon dieu de mitrailleuse qui fait une sorte de barrage sur la route, et pas moyen de passer... Fortin, un sergent de la section, me voyant à côté de lui, me fait entrer dans la maison, dans le jardin de laquelle est installée la mitrailleuse. Une fenêtre est ouverte du coté du jardin; il me donne le conseil d'installer les pattes de mon tacot sur le rebord de l'ouverture pour tirer... Je regarde tout d'abord si je peux apercevoir l'endroit où tire la pièce, mais le jardin est garni de plantes, de hautes herbes et d'arbustes, et je ne vois rien ! J'allais me mettre en batterie pour tirer au jugé, lorsque des balles passent... Je me baisse et me défile à coté de la fenêtre... Mais ça m'intrigue : je me demande comment les boches ont fait pour s'apercevoir de ma présence et je constate alors que, exactement derrière la première, se trouve une autre fenêtre du coté de la cour... Tout s'explique ! Les fritz ont vu ma silhouette dans le rectangle de lumière, formé par ces deux fenêtres superposées et ils m'ont tiré dessus ! L'idée me vient de me glisser à plat ventre dans le jardin et de tirer de cette façon, mais comme j'allais passer de la pensée aux actes, j'entends un cri dans la rue : "Allez ! en avant !" Je sors aussitôt de la cour, et effectivement je vois les poilus qui avancent... Je me remets avec ma section et nous filons jusqu'à une place un peu plus loin. Des yeux, je cherche Meunier, mon cabot, mais barca ! pas plus de Meunier que sur la main ! Il a disparu sans laisser d'adresse ! Nous passons à coté d'un trou dans lequel sont deux boches : l'un est mort et l'autre blessé. Ce dernier gueule comme un putois : "Assassins ! Assassins !"... Une balle bien placée lui coup le sifflet... Encore un qui ne nous emmerdera plus ! Une petite pause de cinq minutes contre un mur, puis en avant... Nous prenons une rue à gauche et arrivons au canal du Nord. Il est à sec. Nous y descendons et allons nous appuyer contre le bord opposé... Mais les boches envoient là-dedans quelques obus bien placés, percutants et fusants. Ceux-ci éclatent à ras du sol... Un vieux de la classe 98, Moutardier, s'abat, touché aux jambes par des schrapnells. Le sous-lieutenant Chardon reçoit un éclat dans le pied. Il s'en va, en passant le commandement à notre adjudant : Jayet... Puis, nous voyons des boches qui se sauvent dans la plaine. Ils se dirigent vers Chevilly, un patelin qui se trouve en nid d'aigle, juste au-dessus de nous. En voyant les boches si bien placés, les poilus ne peuvent s'empêcher de leur tirer dessus, et c'est aussitôt un crépitement ininterrompu de coups de fusil, de fusil-mitrailleur, et de mitrailleuse... Mais un cri se fait entendre : "Plus de cartouches ! Faites passer des cartouches !" Les trois quarts des poilus ont tellement tiraillé, à tort et à travers, qu'ils ont usé toutes leurs munitions. Aussi le tir a-t-il presque cessé. Mais moi, j'en ai encore, des cartouches. Je flanque un chargeur plein dans mon tacot, et, voyant un groupe de quatre ou cinq boches, qui grimpent à Chevilly, je mets le tas en joue, et, zou ! je fauche tout !... Je les vois qui s'égaillent et se mettent à courir... L'un d'eux tombe comme une masse, son suivant se baisse à l'endroit où il est tombé, puis se relève et se remet à courir... Quant à celui qui s'est abattu, je ne le vois pas se relever. J'ai dû le toucher, mais je n'en suis pas sûr. Enfin, peu m'importe ! Nous restons dans le canal, deux heures, environ, puis on annonce que nous devons enlever Chevilly... Les français bombardent en avant et à l'intérieur du pays. Nous grimpons, croyant que l'artillerie va allonger son tir, mais rien à faire. Les 75, malgré toutes les fusées que l'on envoie, n'allonge rien du tout... A ce moment, je vois arriver Meunier, qui nous raconte qu'il a perdu la section... enfin, un formidable bobard que nous n'avalons pas du tout ! Il s'est planqué, comme un fainéant qu'il est, et voilà tout ! Comme le tir ne s'arrête pas, nous nous jetons dans une tranchée, placée un peu avant le patelin... Au moment où Croquet, un sergent nommé récemment et passé à la deuxième compagnie, allait s'engager dans le boyau, un 75 éclate juste à coté de lui. Le pauvre bougre s'abat, percé comme une écumoire. Il n'y a rien à faire pour le soulager... Enfin, le tir s'arrêtant, nous reprenons notre chemin. En passant devant Croquet, je constate qu'il a des éclats dans les jambes, dans la poitrine et dans les bras... Seule, la figure a été respectée... Les muscles de son cou se tendent et se détendent dans les convulsions suprêmes mais il est certainement mort... Nous entrons enfin, dans le pays... Comme premier cadeau, nous récoltons cinq prisonniers, dont un officier... En arrivant au centre du pays, nous prenons la route de droite du carrefour que nous avons devant nous, et nous allons occuper un boyau, derrière la contre-pente. C'est une sale position, car nous avons le réseau de barbelé derrière nous (puisque c'est une tranchée boche) et, de plus cette tranchée, ayant été faite, pour voir de l'autre coté, nous, nous apercevons tout juste la crête devant nous, à cinquante mètres... Tel est notre horizon : il est bien limité, comme on voit !... Nous occupons chacun un trou, creusé par Fritz pour s'abriter... Un peu après nous, défilé du 55e chasseurs qui va prendre position dans ce même boyau, mais plus à droite... Une heure après, un défilé en sens contraire commence : celui des blessés, qui fichent le camp en vitesse, vers l'arrière... Il y en a tellement qu'il nous semble que tout le 55 va redescendre de cette façon... En passant, ils nous disent que ce n'est pas le filon, que ça canarde terriblement vers la droite ! Nous nous en apercevons, rien qu'à voir la quantité d'esquintés qui passent... A un moment nous sommes alertés par un cri de; Vlà les boches ! Nous nous précipitons au parapet, fusil en main, mais rien ne vient ! Vers huit heures du soir, alors que la nuit commence à tomber on nous fait passer l'ordre de mettre sac au dos, car nous allons sur la gauche et se trouvant ainsi devant nous. Nous suivons le boyau pour atteindre la route, et nous ne sommes plus qu'à vingt mètres de celle-ci, quand nous entendons des gueulements dans le pays : "Hourrah ! Hourrah !" en même temps que des fusées éclairantes boches, partent dans toutes les directions, tirées de l'intérieur du pays ! Pas de doute !... Les boches contre-attaquent !... La tête active, et au pas gymnastique, nous gagnons la route... Les gueulements se sont encore rapprochés... Nous contournons le réseau de barbelé qui nous eut plutôt gêné qu'aidé, placé, comme il est derrière nous... Nous atteignons ainsi une tranchée dans laquelle nous voulons nous jeter, mais elle est occupée par les poilus du deuxième bataillon, dont le capitaine de l'une des compagnies nous engueule comme du poisson pourri : "Bandes de fainéants ! Repartez en avant, et en vitesse ! Tous des lâches, dans cette compagnie !" Enfin, pas moyen d'occuper le boyau... Mais nous ne voulons rien savoir pour regagner notre place primitive... Aussi, en nous avançant un peu, voyant une élévation de terrain, pouvant servir d'abri, nous nous installons derrière ce talus... Les balles sifflent... Une mitrailleuse est installée à l'endroit où nous étions, et commence à nous enquiquiner rudement ! Mais un sergent nous dit que nous sommes à peine une quinzaine de la compagnie, que nous n'avons plus de liaison avec personne ! ...Nous déduisons rapidement de tout ça que le restant de la compagnie est prisonnier ainsi que le commandant Lantuéjoul et sa liaison, installée dans une cave du pays !... A un moment, un cabot nous avertit : "Tirez en vitesse ! tirez bas ! un boche, juste devant nous !" Aussitôt, la quinzaine de fusils qui se trouvent là se met à cracher. Nous tirons au moins une moyenne de quinze coups chacun ! et, jugeant que fritz devait en avoir assez, nous arrêtons notre tir... Le cabot qui nous a avertis, va voir en rampant, ce qu'il est advenu de notre bonhomme, puis vient nous rendre compte qu'il est percé d'au moins cinquante balles dans le corps !... Donc, tout est bien... Mais avec tout ce haria, nous ne savons pas si nous devons aller au ravitaillement, et où aller. Personne n'est au courant. Enfin tant pis. Nous mangerons, cette nuit et demain, avec les chevaux de bois ! Tout à coup, surprise ! Quelques coups de canon français viennent siffler au-dessus de nous ! C'est la réponse à nos fusées de demande de barrage tout à l'heure. Il y a peut-être en tout, dix obus qui passent et c'est fini ! Drôle de barrage !  ...Vers minuit, Kervégan, un sergent qui se trouve là décide d'aller faire une patrouille sur la gauche pour savoir qui s'y trouve... Il demande un fusil-mitrailleur. J'y vais avec mon premier pourvoyeur et à nous s'ajoutent un poilu et Tripier, comme caporal... Nous partons tous les cinq. Nous allons tout d'abord en suivant la direction formée par nos lignes vers la gauche... Nous trouvons pêle-mêle des poilus du 154 et du 287. Il y a ici des fragments de toute la division !... On nous dit que la section franche doit se trouver en avant. Comme nous sommes au bord de la route, Kervégan décide de monter jusqu'au pays afin de savoir ce qu'il y a dedans. Nous passons à deux de chaque côté de la route, le sergent reste seul au milieu et nous avançons de cette manière... Nous ne sommes plus qu'à vingt mètres de la première maison lorsque de l'intérieur du pays, et venant dans notre direction, nous entendons un bruit de pas... Nous nous arrêtons le fusil en arrêt... Kervégan, un breton, un type froid comme pas un, reste au beau milieu de la chaussée, et quand nous pouvons distinguer l'ombre, de sa voix la plus tranquille, il demande : "Halte-là ! Qui vive ?" Personne ne répond. Le type marche toujours ! "Halte-là ! Qui vive ?" reprend Kervégan sur un diapason plus élevé. Pas de réponse ! On marche encore ! "Halte-là ! Qui vive ?" reprend encore une fois notre chef. J'ai placé mon fusil-mitrailleur à l'épaule et je tends les jarrets... Si le type ne répond pas cette fois, je lui lâche mon chargeur dans le ventre... Il n'est plus qu'à vingt mètres... Mais, il a, enfin, entendu, car il répond : "France." et s'approche. La conversation s'entame. Nous apprenons que nous avons affaire à un sergent de la sixième compagnie, qui commande deux petits postes de F.M., installés en avant du pays... Du coup, nous nous demandons lesquels sont fous ! Est-ce nous ? Est-ce lui ?... En effet, il y a de quoi être épaté, car le cas est plutôt bizarre !... En avant du pays, du coté boche, se tien un poste français, et en arrière, du coté français, se tient un poste boche !... Afin d'en acquérir la certitude, nous suivons le sergent qui nous fait traverser le pays, et nous mène à l'endroit où il est installé... Il n'y a pas de doute : le pays est à nous, sans y être, tout en étant aux boches, malgré qu'il soit à nous ! C'est très simple ! Le tout est de ne pas chercher à comprendre, car on embrouillerait trop les choses !... Nous rejoignons notre position, très contents de notre promenade !... Vers trois heures du matin du samedi 31 août, nous voyons arriver des poilus : c'est le troisième bataillon qui vient nous relever, et qui doit chercher à réoccuper le pays au petit jour. Le sergent passe les consignes et, comme nous tenons à ne pas être là lorsque ça se fera, nous en jetons un coup pour redescendre la route qui doit nous conduire au canal. ...En bas, surprise ! Qu'est-ce que nous voyons ?... Le restant du bataillon, tranquillement assis le long de la route, dans le fossé... Exclamations !... Explications !... et tout s'éclaire !... Pendant que, ne voulant pas trop nous éloigner, nous contournions tranquillement le réseau, le restant de la compagnie, emmené par Jayet filait vers la gauche, à travers la plaine... Eux, ils sont allés au ravitaillement, mais il est bien restreint, et, au lieu d'une demi-boule de pain chacun, nous n'avons qu'un quart; de même pour le vin et le café : crise de bidons ! On fait l'appel : il y a un manquant : Lepot, de la classe 17, qui était parti voir le commandant, juste comme les boches entraient dans le pays. Il est tombé en plein dans leurs pattes. Quand au commandant, il a été averti juste à temps par un cabot de la section franche, et on peut dire qu'il s'est sauvé, ayant les boches au cul ! Une fois le rassemblement terminé, nous nous mettons en route et allons occuper les berges du canal du Nord... Canal dans lequel nous ne risquons guère de nous noyer ! Dans la journée, j'apprends un tuyau concernant les effectifs de la compagnie. Nous restons exactement trente-et-un combattants, tous les gradés compris, et en ajoutant tous les embusqués du T.C. nous nous trouvons à soixante-huit, au lieu de cent quatre-vingt-dix, effectif normal ! Quant à la section, telle qu'elle était avant de monter dans la somme, je reste seul avec l'adjudant... Je repense malgré moi, à tous les poilus qui étaient là, à ce moment : Neveu, Meslet, Blin, Mulé, Roland, tués, puis Paillard, Giacobetti, Verdier, Garnier, Lebras, Biet évacués pour les gaz, et enfin Dubois, Maumont, Moutardier, Gonnord, Després, Verdy, Breton, Cadiot blessés plus ou moins grièvement, Brisse, Ronteix, Noël et Lepot prisonniers, et d'autres encore, dont le nom m'échappe à présent !... La Grande Faucheuse a passé !... La section a bien diminué depuis le 26 avril. Il n'y a plus que moi d'ancien ! L'adjudant, lui n'est arrivé que le 16 mars à la section et les autres sont là depuis les attaques... La journée se passe paisiblement... Quelques obus viennent tomber dans le canal, blessant encore quelques poilus, parmi lesquels Carré, le nouveau Cabot et tuant un type du 154 qui passait à ce moment. Décidément, la position ne vaut pas grand chose... Aussi, le soir même nous déménageons pour aller un peu plus en arrière occuper des trous individuels, creusés le long d'une route parallèle au canal, qui va vers Ecuvilly. Nous ne sommes pas mal, les boches ne tirent pas par ici, et de plus, le ravitaillement, la nuit, se fait sur la route, juste devant nos trous. Pour une fois, le ravitaillement est un filon, et tout le monde ne demande qu'à y aller ! Nous passons là deux bonnes journées de quiétude : le dimanche 1er septembre et le lundi 2. Dans la nuit, vers deux heures du matin, le 3 septembre, nous nous reportons au canal. Le 154 et le 287 doivent attaquer au jour, et, s'ils réussissent nous devons, naturellement, les suivre. Mais rien ne se passe, et nous apprenons rapidement par des blessés qui passent, qu'ils ont été arrêtés, à deux cents mètres, à peine de leur point de départ, par des feux de mitrailleuses. Dans la journée, on nous fait passer un ordre du jour du général Nudant, commandant le 34e corps, nous disant qu'il faut s'attendre à un repli prochain des boches... Il n'y a qu'à demander l'avis des types du 154 et du 287. Ils en savent quelque chose ! La nuit se passe calme, mais au petit jour, nous sommes réveillés par un tir de barrage à tout casser : le 154 et le 287 remettent ça !... Cette fois, ça réussit. Ces messieurs reculent. Vers huit heures, l'ordre arrive pour nous d'aller de l'avant. Nous marchons de concert avec les 75... Une pièce, par suite d'une fausse manoeuvre, fout le camp dans le fossé du chemin. Mais elle est maintenue par le caisson et ne va pas trop loin... Illico les servants mettent pied à terre, décrochent la pièce et en moins de trois minutes, la remettent d'aplomb sur le chemin... Les voilà prêts à repartir !... En selle et au galop, ils rattrapent le temps perdu ! Tout le monde se dirige sur Chevilly, que nous dépassons sur la droite et nous longeons le fameux boyau qu'occupait le 55e chasseurs... En passant, nous avons l'occasion de voir un sale spectacle : nous voyons dans le fond de la tranchée, le haut d'un corps adossé d'un coté et le bas des jambes, de l'autre coté. Du milieu du corps, il n'en reste rien. Un obus est tombé en plein sur le poilu et l'a réduit en miettes ! Nous poursuivons notre chemin en plaignant mentalement ce pauvre type !... Nous passons à droite du bois du Chapitre, et suivons une piste, copieusement arrosée d'entonnoirs de toutes sortes : l'artillerie française l'a bien sonnée ! Probablement que le ravitaillement boche passait par là ! Nous marchons tranquillement, malgré de fréquents arrêts jusqu'à trois heures de l'après-midi... A ce moment nous arrivons en vue du village de Quesmy que les boches sont en train d'arroser, de même que la plaine. Ils trouvent sans doute qu'ils ont assez reculé pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons sous des arbres, en attendant des ordres. L'adjudant veut envoyer une patrouille reconnaître les emplacements du 404 qui est à notre gauche. Nous y allons à quatre avec un sergent et Meunier, comme cabot... Nous sommes arrosés en cours de route, aussi Meunier, se cache-t-il dans un fossé, pendant que nous continuons à marcher de sorte qu'en arrivant aux premiers postes du 404, sommes-nous abandonnés par notre caporal !... Mais nous commençons à en prendre l'habitude et nous n'en sommes pas étonnés ! Pour comble de bonheur, nous arrivons juste au moment où les poilus vont démarrer pour avancer. Aussi, nous sommes obligés de courir d'un officier à un autre, avant d'avoir les renseignements demandés... Comme nous nous disposons à partir, nous voyons arriver Meunier qui a été faire un tour considérable, afin d'éviter le barrage boche. Nous regagnons notre point de départ au moment où la compagne se dispose à aller occuper un fossé, pour y passer la nuit. Au jour, nous nous disposons à partir de l'avant, lorsqu'un ordre arrive : "Demi-tour, et en route !" Nous voilà tout plein heureux, car nous nous figurons que nous repartons vers l'arrière. Mais macache, nous regagnons la grand-route de Ham à Guiscard et nous nous y engageons en passant vers la droite... Nous arrivons à Guiscard, dans lequel nous entrons... En arrivant presqu'à la sortie du pays, nous prenons un chemin vers la droite. Nous faisons ainsi deux cent mètres et nous nous arrêtons dans un chemin creux. Comme nous croyons y rester un bon moment, nous sortons nos outils portatifs et nous entaillons le talus pour nous faire un petit abri... Dans l'après-midi, les boches canardent le coin assez sérieusement. Le colonel du 154 qui s'est installé dans le fond, dans une sorte de sape, est blessé par un éclat d'obus à la cuisse... Vers quatre heures, nous voyons arriver une auto, dans laquelle se trouve le colonel Goybet. L'auto s'arrête dans le chemin creux et Goybet va voir le commandant qui fait fonction de colonel... Il ne revient qu'au bout d'une demi-heure et rouspète après son chauffeur qui a disparu : le pôvre, il a été se mettre à l'abri dans une cave, parce qu'il n'a pas l'habitude de ces sortes d'orage... Il a bien fait... Pendant ce temps, nous avons empli nos briquets avec sa réserve d'essence !... Nous voyons défiler une chiée de poilus du 154 blessés ou pris par les gaz, ainsi que quelques civières portant des morts. Ils prennent une sacrée purge, en première ligne !... D'après le lieutenant de la mitraille, notre avance se chiffre à quarante kilomètres... Dans la soirée, nous apprenons la nomination de Jayet au grade de sous-lieutenant et celle de Kervégan comme adjudant. Lorsque la nuit est tombée, on nous fait entrer dans le pays pour loger dans des caves... La section est installée dans une jolie cave et nous nous préparons tous à roupiller, lorsqu'un mitrailleur, dont la section est logée dans une cave à côté, arrive et nous fait part de la découverte d'une mine faite dans leur cagna... Voilà aussitôt, tous les poilus, en train de sonder les murs, le plafond et la terre, sans oublier, naturellement, les tas de saletés qui sont dans les coins... A un moment, émotion. Un poilu, en fouillant dans un tas de saletés a enfoncé sa main dans un trou... Nous retournons tout... mais ce n'est qu'un trou dû à la vétusté ! Il n'y a rien. Nous nous couchons tranquillement et nous roupillons du sommeil du juste... Vers cinq heures, on nous rassemble et nous retournons dans le chemin creux, où nous étions hier au soir... Mais les boches doivent avoir fait du chemin depuis hier, car il n'y a plus un obus qui tombe. Comme le jour n'est pas encore tout à fait venu, nous avons l'occasion de remarquer l'horizon en feu, et d'après les centres des foyers, nous constations que ce sont quatre villages qui brûlent. Nous reprenons, comme la veille, notre progression lente, mais continue. En arrivant à gauche du village de Bemmes, nous nous établissons le long d'un fossé dont le fond est garni d'eau. Nous y plongeons jusqu'au dessus de la cheville, mais qu'importe ! Nous sommes à l'abri des éclats et ça, c'est l'important, car les boches recommencent leur marmitage. Un éclat blesse au bras Sarrazin, le dernier des brancardiers. On en désigne un autre au petit bonheur : Raux, un petit vieux, très gentil. Il laisse tomber son fusil et saute sur le brancard. Vers sept heures du soir, nous repartons de l'avant, mais au moment de nous engager sous bois, on nous fait faire demi-tour. C'est assez avancé pour aujourd'hui, aussi nous regagnons le jardin de la ferme du château de Bemmes. C'est là que nous montons nos tentes, pour y passer la nuit... Elle se passe le plus tranquillement du monde, et au jour vers six heures trente, nous remettons ça ! Toute la matinée, nous marchons... A onze heures, nous faisons une longue pause sous un bois, puis en route. Nous traversons des vergers, dont les arbres sont sciés au pied, mais il y a déjà longtemps que ce travail a été fait, puis, nous passons à coté de ce qui fut une ferme. Il n'en reste pas lourd... les boches... (ou nous !) ont bombardé ce coin furieusement, et les murs n'ont pas plus de cinquante centimètres de haut, de plus, le tout est couvert d'herbe, car cet esquintement date au moins de trois ans, et ça n'a pas été reconstruit depuis, naturellement !... Un avion boche vient au-dessus de nous, afin de se rendre compte si nous avançons toujours. Nous nous planquons sous des arbustes, puis, sitôt qu'il a fait demi-tour, nous reprenons notre marche. Nous nous engageons dans un bois dont les boches bombardent la lisière opposée. Nous le traversons dans toute sa longueur, puis nous nous arrêtons à une cinquantaine de mètres de la sortie. Comme on nous avertit que nous devons passer la nuit ici, nous nous enroulons dans nos couvertures et notre toile de tente, et essayons de roupiller... Mais, un bruit de pioche, peu éloigné, se fait entendre, et, couchés, comme nous le sommes, à même la terre, le bruit se répercute dans notre tête et nous empêche de dormir. ...En causant, nous apprenons que c'est Meunier, qui est parti à cinquante mètres au moins de nous, et est en train de se faire un trou pour se planquer pendant la nuit, parce qu'il a toujours peur... peur plus que jamais ! Pendant deux heures, il nous empêche de roupiller, puis enfin, le bruit cesse : il doit avoir fini et se dispose à dormir du sommeil de l'innocence... persécutée ! Pauvre vieux ! ce qu'il me dégoûte !... Un peu plus tard, Jayet appelle Kervégan et l'envoie avec six poilus, faire une patrouille, afin d'explorer l'avant... Ils reviennent, au bout d'une grande heure et nous racontent qu'ils ont été jusque près du canal Crozat, où ils ont vu des poilus du 287, qui leur ont dit que les boches étaient loin... La nuit se passe tranquille... Nous voici au dimanche 8 septembre... Que nous réserve-t-il ?... Vers quatre heures du matin, on nous rassemble sur la lisière du bois. Au moment de partir, on s'aperçoit que Meunier, l'intolérable Meunier n'est pas là... Kervégan l'appelle... Personne ne répond... Je lui explique que Meunier a dû s'écarter de nous et qu'il doit dormir encore... L'adjudant m'envoie le chercher... Je pénètre dans le bois, en gueulant de toutes mes forces : "Meunier ! Meunier ! Bougre de c... ! Où es-tu ?" Enfin, une voix qui semble sortir de terre, me répond : "Qui m'appelle ? - C'est l'adjudant Kervégan. Tout le monde est rassemblé et nous t'attendons. Au lieu de te planquer comme tu le fais, tu ferais mieux de rester avec nous ! - Vous n'aviez qu'à me prévenir ! - Il aurait fallu savoir où tu étais, espèce d'andouille !" Nous discutons dans la nuit. Puis, comme j'en ai assez de parlementer avec ce foireux-là, je rejoins la section pour avertir que Meunier va arriver... La compagnie attend patiemment le bon plaisir du monsieur, que nous voyons enfin arriver, au bout de dix grandes minutes, toujours avec sa grande pelle boche qu'il transporte éternellement avec lui ! Mais il est bien accueilli par Kervégan et l'engueulade qu'il reçoit nous venge tous d'un seul coup : "Enfin, vous voilà ! Espèce de fainéant ! Toujours planqué !... Comme gradé, vous m'avez l'air d'un drôle de ouistiti !"... Et un tas d'autres amabilités du même genre ! Maintenant, tout le monde est là, nous pouvons partir. Nous suivons une route en colonne par un... En cours de route, une pause pour recevoir quelques grenades... J'ai toujours mon fusil-mitrailleur, mais j'en prends deux quand même et les mets dans mes poches. Nous arrivons à la voie ferrée qui forme un déblai assez profond. Il y a là cinq ou six lignes et la voie est assez large. Nous remontons l'autre versant en nous cramponnant tant bien que mal... En haut nous avons la surprise de voir notre colon, en personne qui nous fait : "Allons, allons, dépêchons! Un peu plus vite ! Allons, pressons !" Nous nous engageons dans un petit chemin qui, en biaisant, va rejoindre la berge du canal Crozat... Comme nous comptons relever le 287, personne n'est prêt. Les fusils-mitrailleurs sont dans leur gaine, les revolvers dans leurs étuis, les grenades dans les poches... ...Nous commençons à bien distinguer le canal... lorsque... brutalement... une mitrailleuse claque, là, à notre nez... ...Instinctivement, nous nous couchons... Quelques poilus, croyant qu'il y a erreur, et que nous avons affaire au 287, gueulent : "Ne tirez pas !... Nom de dieu ! ne tirez pas !..." ...Un poilu s'abat à coté de moi... Mais le tir ne s'arrête pas... Ce sont bien les boches qui tirent... et ils ne sont pas loin... à trente-cinq ou quarante mètres, à peine... A trois mètres de moi, Meunier, à genoux, gueule... gueule... à en perdre le souffle : "Oh, aie, aie !... Oh, aie, aie... Oh, mon bras !... Faites-moi mon pansement !... Oh, bandes de vaches !... Vous voulez me laisser crever là !..." ...Il gueule à lui tout seul plus fort que tous les autres blessés réunis... A la fin, un poilu impatienté, lui crie : "Tu nous fais chier !... On ne va pas se faire casser la tête pour ta sale gueule !... Sauve-toi donc et nous emmerde plus !" Et celui-là a raison... Nous ne pouvons pas lever la tête, sous peine de recevoir une balle en plein dedans !... C'est qu'ils tapent juste, les cochons !... C'est même un hasard extraordinaire que Meunier, qui reste à genoux ne soit pas encore tué !...  ...Quant à moi, je tremble... je tremble, nerveusement, effroyablement !... Pour la première fois, j'ai peur... terriblement peur... Il me semble que, tant que j'aurai la tête tournée du coté des Fritz, je puis être tué... ...Aussi, en m'aplatissant le plus possible, je tourne le... dos aux boches... je pousse, alors un fameux soupir de soulagement, et, en moi-même une idée passe, saugrenue : "Maintenant, je les emmerde !... si une balle arrive, je la recevrai dans le cul... je ne serai toujours pas tué, aussi vite qu'en la recevant dans la tête !..." ...Mais un tuyau passe : "Tâchez de vous replier, en rampant... Il y a un fossé de l'autre coté du chemin..." Cet ordre passe, formulé à voix basse... Nous nous y conformons, du mieux possible... et j'arrive près du fossé... Mais, il s'agit de faire un bond, car des tas de pierres bordent le chemin et il faut bondir par-dessus... Je souffle une minute... puis, prenant mon élan, je saute par-dessus le tas de pierres... les balles sifflent... Un autre a exécuté le même mouvement que moi... Mais au moment de m'allonger, je lève la tête, et je vois mon type, encore à genoux. Je reconnais Guerb, un cabot : "Baisse-toi, lui dis-je, tu vas te faire buter !" En causant, je me baisse, car les balles continuent à rappliquer, et que vois-je ?... Une flaque de sang, grande comme la paume de la main, qui s'étale à terre, entre ses genoux... Je relève la tête, et faisant alors attention, je remarque un petit trou noir à la tempe droite... Le pauvre type n'a plus besoin de conseils... Il est mort, et bien mort... Un de plus à ajouter à la liste... Mais dans le fossé, devant moi, je vois les poilus qui commencent à avancer, en rampant... Derrière moi, ça gueule : "Avance... Cambounet !... - Merde !... J'peux pas !... Y a un macchabé devant moi !..." Mais comme ça rouscaille, je prends mon élan... je saute par-dessus son épaule, et je reviens m'aplatir de l'autre coté... Je commence à ramper... Mais je suis emmouscaillé par mon sac, qui gêne mes mouvements et par mes musettes... Le fossé a, à peine cinquante centimètres de large et autant de profondeur... Il n'est pas question de se mettre à genoux pour avancer... Nous recevrions une balle dans les flancs... il faut se traîner sur le ventre, en s'aidant des coudes... A la fin, mon sac m'enquiquinant de plus en plus, je réussis à le dégrafer et je le colle sur le parapet... Je peux ainsi, faire quelques mètres, mais le mouvement en avant, s'arrête... Les poilus sont arrêtés par un barrage de mitrailleuse que les Fritz font, à l'endroit où le fossé s'interrompt... Alors, nous restons sur place, à croquer le marmot... Les boches, voyant qu'ils ne peuvent plus nous avoir avec leurs mitrailleuses, se mettent à nous envoyer des grenades à fusil... Il y a encore quelques blessés, parmi lesquels : Parison, Léglise, le caporal-fourrier, et l'adjudant Kervégan... ...Puis nous entendons un long geignement... C'est un poilu de la classe 18, Grazilliers, qui a reçu une balle dans la cuisse... Il a la jambe cassée, et ne peut se sauver... Il gémit et demande qu'on ne le laisse pas là... Un sergent, Bréjean se décide, et après s'être déséquipé, sort en rampant... Il réussit à arriver sans encombre, jusqu'au poilu... puis se mettant sur le ventre, il le hisse sur son dos, et commence à se traîner ainsi... Mais ils n'ont pas fait dix mètres, que les boches leur tirent dessus à coups de fusil... Bréjean reçoit une balle explosive en pleine tête... elle entre par le haut du crâne... et vient éclater derrière la tempe droite... Grazilliers, lui reçoit encore deux balles... une qui lui casse l'épaule et l'autre qui lui traverse le bras... On l'entend alors pleurer : "Ne me laissez pas là !...Bréjean est tué !... Venez me chercher !..." Alors, Raux, faisant preuve d'un sang-froid extraordinaire, sort... debout, avec son brancard... qu'il étend, le plus tranquillement possible... au milieu du chemin... ...Les boches ne tirent plus... ça doit leur en imposer... un deuxième poilu sort, déséquipé, et vient aider Raux... à eux deux, ils prennent Grazilliers, et le placent sur la civière... ...Les blessés, qui se sont déséquipés, voyant que les boches ne tirent pas, sortent également... et c'est un vrai cortège d'éclopés, qui suit le chemin... s'en allant vers l'arrière... Les Fritz les laissent filer tranquillement, et, dans la journée, il n'y a plus d'autre incident, que quelques fusants, qui éclatent assez haut, et ne font aucun mal... ...Petit à petit, nous connaissons les noms des tués, qui sont restés sur le carreau, ce matin. Ce sont : Ménard, un tireur de fusil-mitrailleur, tué d'une balle au ventre... Chevallier, le cabot de la douzième escouade, une balle dans la poitrine... Guerb et Bréjean, dont j'ai parlé... Nicolas, un type de la classe 18, qui a reçu un éclat de grenade dans la tête... La Camarde a choisi ses victimes !...  Dans l'après-midi, un agent de liaison du commandant, réussit à se glisser jusqu'au lieutenant Jayet, pour lui porter un papier... Jayet répond que ses poilus sont démoralisés, et qu'il n'y a plus rien à espérer d'eux !... A la nuit, le mouvement en avant recommence... Comme il fait assez sombre, je réussis à aller reprendre mon sac, ça ça me ferait trop mal au coeur de l'abandonner : j'ai eu tant de mal à l'apporter jusqu'ici !... Nous nous glissons en rampant, sur le talus, à droite du fossé, avec l'intention de traverser le champ qui est là... Mais, nous nous heurtons à un réseau de barbelé qu'il faut traverser. Heureusement qu'avant de partir, j'ai pris soin d'échanger mon fusil-mitrailleur et ma musette de chargeurs contre un mousqueton et un coupe-chou. Aussi suis-je bien moins emprunté pour traverser le réseau. J'y laisse un bout de capote, et je réduis mes bandes molletières en loques, mais peu importe !... Je passe ! Nous poussons un soupir de soulagement formidable en descendant sur la voie... Enfin, nous sommes à l'abri !... Nous ne craignons plus la mitrailleuse !... Nous nous appelons et nous rassemblons... Mais nous restons cois en ne nous voyant plus que... onze, à la compagnie, y compris tout le monde, gradés et bureau. Je vais avec un autre poilu au ravitaillement : nous sommes assez de deux, pour rapporter les vivres de la compagnie ! En arrivant au lieu de distribution, nous ne disons rien d'abord et prenons tout ce que les cuistots nous donnent... Les trois quarts des poilus possèdent deux bidons. Pour ma part, j'en ai trois, dont deux que j'ai ramassés aujourd'hui même et que j'ai vidés étant dans le fossé... J'avais si soif !... Lorsque nous avons tout touché, nous causons avec les cuistots, étonnés de ne nous voir que deux à la corvée... Nous leur racontons notre journée et ils en restent éberlués... Ils reconnaissent enfin, qu'ils ont plus le filon que nous ! Nous rentrons à la compagnie et nous partageons les vivres. Nous avons chacun un litre de vin, un saucisson entier, quatre ou cinq morceaux de viande, une boule de pain et deux boites de conserves chacun... Cela va... Ce n'est toujours pas de faim qu'on mourra demain ! Nous nous étalons contre le talus de la voie en nous arrangeant un peu, et nous roupillons... Vers six heures, nous nous réveillons transis, nous demandant ce que nous allons faire. Nous apprenons que le bataillon est parti de l'avant parce que les Fritz ont déménagé vers trois heures trente... Le lieutenant Jayet nous rassemble en nous disant que nous allons essayer de rejoindre le commandant. Il nous faut d'abord appuyer sur la droite pour traverser le canal sur l'écluse. En arrivant là, nous voyons la septième compagnie qui est en réserve. Le lieutenant nous fait arrêter là, un instant, le temps pour lui, d'aller se tuyauter près du commandant de la septième compagnie. Il revient et nous traversons le canal. Nous marchons tête basse, songeant à nos tués que nous avons revus au passage. Nous marchons ainsi, pendant près d'un quart d'heure, faisant environ douze cents mètres... Nous arrivons alors dans une sorte de bassin naturel formé par le terrain. C'est dans ce trou que nous rejoignons le commandant... Il nous regarde défiler, l'air sombre... Un de ses agents de liaison ne peut s'empêcher de nous crier : "C'est ça la première compagnie ?... Il n'en reste pas lourd !" Nous faisons encore quatre ou cinq cents mètres en avant et arrivons dans un deuxième trou, semblable au premier, aussi grand que lui, dans lequel était installé un P.C. de brigade, en 1915. Il y a des cagnas et des sapes fort bien faites. Le lieutenant nous fait entrer dans l'une d'elles, afin de nous laisser le temps de casser la croûte. Il profitera de cette pause pour aller causer avec le commandant. Il s'éloigne et nous en profitons pour discuter. Un cabot donne son avis : "Savez-vous, les gars ? Eh bien on est tous des c... ! Depuis le temps qu'on marche, on a droit au repos ! S'ils veulent nous faire avancer, il n'y a qu'à s'entendre et refuser carrément !" Ma foi, il a résumé l'opinion générale. Nous donnons tous notre approbation et attendons le lieutenant de pied ferme. Lorsqu'il revient, le même cabot qui avait déjà pris la parole, lui cause en face : "Vous savez, mon Lieutenant, on en a marre, et plus que marre. Nous ne voulons plus rien savoir. Nous ne sommes plus assez nombreux pour faire quelque chose !" Le lieutenant, comme tel est son devoir, veut insister : "Non, non, il n'y a rien à faire, je vous dis !" Le voyant bien entêté, et nous, tout aussi résolus, le lieutenant fait demi-tour et retourne voir le commandant. Dix minutes après il est de retour, avec un ordre, qui nous comble de contentement : "Nous restons là, jusqu'à nouvel ordre !" Peu après, nous apprenons, par un agent de liaison, que le commandant Lantuéjoul a fait passer un ordre écrit aux deuxième et troisième compagnies, de n'avoir pas à bouger, avant un nouvel ordre donné par lui-même. ...Enfin, cette fois, nous espérons que nos tracas sont terminés, et que nous allons être relevés avant peu... Nous restons là, quatre jours, mais si tranquilles, si calmes que nous ne demandons pas même à bouger !... Nous nous trouvons bien : les boches sont loin et personne ne s'occupe de nous. C'est le bonheur complet ! ...Aujourd'hui, vendredi 13 septembre, on nous fait passer un ordre du jour du général Nudant, dont voici le texte : 34e corps d'armée. Ordre général n°97, aux divisions du groupe Nudant. "Partis, le 10 août de la ligne Ferme Porte-Saint-Maur-Belloy, vous avez enlevé dans une poussée irrésistible Ressons-sur-Matz, Lassigny, Chevilly, Guiscard, Ugny-le-Gay, Frières, et vous venez d'atteindre le canal Crozat, après soixante kilomètres parcourus en vingt-huit jours de combats rudes et ininterrompus. Seules, des troupes d'élite étaient capables de fournir un tel effort. Vous avez consacré cotre réputation. Cet effort, je vous l'ai demandé et vous me l'avez donné de plein coeur. Il n'en était pas un seul parmi vous, qui ne sentit profondément, intensément, la gravité de l'heure. Tout l'honneur de cette avance revient à vos chefs directs et à vous-mêmes. Votre vaillance, votre ténacité ont trouvé leur récompense : l'ennemi est battu, désorganisé ! Le succès vous paie de vos fatigues; vous êtes victorieux. Fier d'avoir été placé à votre tête pendant ces journées de bataille, je dis à tous : merci ! Signé : le général de division Nudant, commandant le 34e corps." ...D'autre part, nous apprenons une autre chose qui nous fait encore plus plaisir que l'ordre du jour de Nudant... C'est l'annonce de la relève pour demain. J'ai un journal entre les mains, relatant la mort d'un capitaine du 20e chasseurs à cheval : le comte Bertrand de Lesseps, tué devant Ecuvilly, alors qu'il commandait la reconnaissance qui marchait devant nous. Le lendemain matin, nous faisons nos préparatifs de départ. Nous sommes relevés par le 411, ce soir. A midi, on m'apprend que je vais partir avec le sergent Rous préparer le cantonnement aux Sézettes, un petit hameau, dans lequel nous passerons la nuit, en attendant l'embarquement en camions pour l'arrière, pour le grand repos ! J'effectue, à ce moment, la marche la plus pénible de tout mon service militaire... Mes pieds, non soignés, me font un mal de galère, et, après quatre jours de repos, mes pieds ne sont plus échauffés comme pendant les attaques... J'arrive quand même au bout de notre course de vingt kilomètres environ, mais avec quel mal ! Les Sézettes, est un hameau de quatre maisons, placées à cent mètres les unes des autres... Je vais à la rencontre de la compagnie, à l'heure approximative de son arrivée, je loge ma section, et, bonne nuit, il n'y a plus personne pour causer !... A sept heures du matin, le lendemain 15 septembre, Roux me réveille, et me dit de me préparer au départ. Nous embarquons en camions à huit heures. Nous roulons jusqu'à trois heures de l'après-midi et après avoir traversé de nombreux pays, parmi lesquels Noyon et Compiègne, nous arrivons à Monceaux, un petit patelin situé près de Pont-Sainte-Maxence. Le pays a l'air triste. Quelques rares habitants viennent assister au débarquement de la troupe et aussitôt la répartition du logement commence. Il nous faut trois chambres : une pour le capitaine Troutot, qui doit rentrer de permission, une pour le lieutenant Jayet, et la troisième, pour... la troupe ! En effet, nous n'avons pas besoin de beaucoup de place, pour loger la douzaine de poilus qui constituent la compagnie... Vers dix-huit heures, nous voyons apparaître les camions transportant le bataillon. Nous allons sur la place, où ils doivent s'arrêter et sitôt que les poilus sont descendus, je les conduis à leur logement... Le capitaine est là. Lorsque j'ai placé les types, je m'en vais accompagner le piston à sa chambre. Tout en marchant, nous causons : "Alors, mon vieux Cambounet, me dit-il, tu t'en es tiré, encore cette fois ! - Mais oui, mon Capitaine ! malheureusement, il en est resté beaucoup sur le carreau ! - Oh, oui ! Cela m'a fait de la peine de voir ma compagnie aussi clairsemée. Il n'y a plus d'anciens !" Là, il avait raison. Comme combattants, il restait en tout, cinq poilus de la classe 18, arrivés au mois de juin, un récupéré de la classe 17, arrivé au mois d'octobre, l'an passé, et, je suis, moi le plus jeune, le plus ancien au front !... "Heureusement, repris-je, que les permissions vont reprendre ! - Ah ! tu es dans les premiers à partir ? - Oh oui ! le premier ou le deuxième ! - Eh bien cette fois, tu vas pouvoir coudre tes galons de caporal pour aller voir tes parents ! Nous allons te proposer aujourd'hui même. - Oh, pardon, mon Capitaine ! Si les nominations reviennent avant que je suis parti, certes oui, je mettrai les galons, mais si ma permission arrive avant, ma foi, je prierai Roquepli ou le Chef de me l'écrire, je les placerai chez moi. Je ne veux pas porter un grade indûment ! - Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais, ne désespère pas. Tu seras peut-être nommé avant." Tout en causant, nous sommes arrivés, et il se retire dans sa chambre... Quant à moi, je rentre en songeant aux galons qui m'attendent. Je préfèrerais être nommé avant mon départ, afin d'en offrir la surprise à mes parents... Je passe une bonne nuit, car je suis mort de fatigue, et c'est la première fois que nous passons une nuit loin du front, depuis déjà un long moment. Le lendemain matin, je vais voir le toubib. L'infirmerie est installée dans la même maison que nous, de l'autre coté de la cour... Le major regarde mes pieds, puis me demande : "Espèce de couillon ! Pourquoi n'es-tu pas venu me voir, en ligne ?" Monsieur Bernier, le médecin, est un type gentil, avec qui on peut causer, aussi je ne me gêne pas : "Pensez-vous ! J'en avais assez, le soir venu avec le chemin que nous avions fait dans la journée, sans encore faire quinze cents ou deux mille mètres, pour vous rendre visite ! - Oh, je n'étais jamais si loin de vous ! - Avec ça, je le sais bien ! C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu ! Mais maintenant, je m'en fous ! Je me soignerai chez moi, ça guérira vite ! - Chez toi ? Tu dois bientôt partir en permission ? - Mais, je crois bien ! Je suis le premier ou le deuxième ! - Oui, eh bien tu iras sur mes pieds ! Les tiens sont en marmelade ! Que veux-tu faire chez toi, dans cet état ? Tu passeras une trop mauvaise permission ! - Oh, ça ! je m'en fiche ! il y a près de sept mois que je n'en ai pas eu, vous comprenez que j'ai hâte que mon tour arrive !" Mais j'ai beau discuter. Rien à faire. Il va porter lui-même, au sergent-major, un bout de papier, sur lequel il a écrit que je ne devais pas avoir de permission pour raison médicale ! Je suis bec de gaz !... et combien ! Je vais au poste de secours deux fois par jour, et je souhaite, ardemment de guérir vite !... On ne parle pas encore de départs de permissionnaires, mais ça pourrait venir !... ...Le 16 septembre, le général Caron vient nous voir... Il entre dans notre cagna et nous cause aux uns et aux autres... Puis s'adressant à Gouguet, qui a tenu le coup, lui aussi : "Et toi, mon vieux, dis-moi ce que vous attendez tous, maintenant ? - Des citations, mon Général !!" répond Gouguet, sans se troubler. "Oui, des citations, vous en aurez ! Mais, n'y a-t-il pas autre chose ?" Je ne peux pas retenir ma langue, et, comme tel est mon voeu, j'en fais le voeu de tout le monde : "Des permissions ! mon Général ! - Ah, voilà ! Des permissions ! C'est le mot que j'attendais ! Eh bien ne désespérez pas. Je vais tâcher d'en faire sortir le plus possible !" Il cause encore une minute ou deux, nous promet la fourragère aux couleurs de la médaille militaire, et le voilà qui file ! ...Les jours passent dans le calme et le repos... Le 18 septembre, un mercredi, nous préparons toutes nos affaires, car nous embarquons demain matin, à Pont-Sainte-Maxence. A quatre heures trente, le lendemain matin, nous quittons Monceaux pour Pont où nous embarquons à six heures. Mais le départ n'a lieu qu'à dix heures... Nous roulons toute la nuit. Nous passons successivement à Creil, au Bourget, à Noisy-le-Sec, Meaux, Revigny, Toul, Nancy que nous dépassons pour aller débarquer, au matin, à Jarville, un pays à trois kilomètres. Un moment de pause, puis rassemblement et en route. Nous allons rentrer à Nancy, pour loger à la caserne Molitor... Bâtiments assez neufs, la caserne ne datant que de 1905... A peine arrivés, on nous annonce le départ prochain d'un fort contingent de permissionnaires. Le chef me dit que si je veux partir, il me faut aller voir le toubib ! J'y saute aussitôt. Il n'est pas même déséquipé, mais peu m'importe ! "Monsieur le Major, je viens vous voir, pour vous demander l'autorisation d'aller en permission. - Mais, mon pauvre vieux, tu ne peux pas marcher ! - J'ai bien pu marcher, pendant les attaques !" Je discute tant et si bien, qu'il me laisse partir et me donne un mot en conséquence. Me voilà heureux au possible, car si j'ai souhaité une permission, c'est bien celle-là... Elle m'est d'autant plus chère que j'ai eu plus de mal à la gagner ! Dans l'après-midi, les nominations reviennent. Deux cabots de la compagnie sont nommés sergents et je suis nommé caporal. Croyant partir en permission, le soir même, j'installe aussitôt mes galons. Mais il y a contre-ordre, nous ne partons qu'après-demain. La journée du samedi se passe au nettoyage des chambres, et ce n'est pas sans impatience que je la vois s'écouler !... Enfin, le dimanche tant espéré arrive. A midi, je suis déjà prêt à partir pour huit heures du soir, et je ne suis pas l'un des derniers à arriver à la gare... ...C'est que c'est la première fois qu'il m'arrive de partir en permission après une période aussi mouvementée que celle-là, ni aussi dure !... Je débarque à Paris, le lendemain matin, plein d'espoir sur la prompte fin de la guerre... C'est que nous avons bien marché et ceux qui y sont encore en ce moment, marchent rudement bien, eux aussi, et il se pourrait fort bien, que, comme conséquence, nous ayons du nouveau, d'ici peu !... L'armistice. Le 28 septembre, je débarque à Paris, le coeur léger et l'esprit content. Je passe mes douze jours dans un contentement perpétuel. Les boches foutent le camp. Ils ont déménagé leurs Berthas, et les Gothas nous oublient... ça va très bien ! ...Et ce qui va encore mieux, c'est la nouvelle, le 6 octobre, d'une demande d'armistice, formulée par la Bulgarie et par l'Autriche, suivie le lendemain, de la demande de la Turquie... Je suis maintenant convaincu que la guerre ne va plus durer bien longtemps, et, le 9 octobre, je reprends mon train à la gare de l'Est, sans le moindre cafard... Les fatigues, les privations, le danger... tout est oublié ! Je quitte Paris, à neuf heures du matin, et j'arrive à quatorze heures à Favresse, où je reste jusqu'à vingt heures, à attendre le train de Nancy. Je roule toute la nuit, je passe à Frouard à deux heures, et j'arrive enfin, à Faulx-Saint-Pierre, à dix heures du matin, le 10 octobre. Le régiment a pris les lignes pendant mon absence, à droite de Noméhy. C'est donc à peu près le même secteur que l'an passé. Je passe au magasin où sont les sacs des permissionnaires puis, à pied, je rejoins la première compagnie qui est en réserve à Jeandelincourt. ...Toute la journée, nous sommes visités par les avions boches qui, en guise de bombes, nous envoient des journaux, notamment la gazette des Ardennes, de Charleville. Le lendemain, nous apprenons que le régiment est décoré de la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Le général Caron a tenu sa promesse. Les journées se passent tranquillement ici. A vol d'oiseau, nous ne sommes qu'à deux kilomètres des lignes, mais c'est toujours calme, et nous pourrions nous croire au grand repos. Le 12, nous nous préparons à monter en ligne. Le départ est donné à vingt heures, et à vingt-et-une heures trente, tout est terminé. La relève s'est effectuée sans incident d'aucune sorte. Comme caporal, je ne prends plus la garde, mais le quart, les heures sont partagées entre les gradés de la section. Nous sommes dans le village de Arraye-et-Han et nous nous trouvons installés dans une maison aménagée, toutes ouvertures bien bouchées. L'électricité fonctionne. C'est un plaisir, un secteur comme celui-là ! Le lendemain, dimanche, je vais avec un poilu en avant, lestés quelques grenades... Nous les balançons dans la Seille, et nous obtenons ainsi une bonne friture : au moins deux kilos de poissons minuscules que nous mangeons à midi, avec plaisir...  Mais nous ne restons ici que deux jours. Le 14, au soir, le deuxième bataillon vient nous relever, et nous allons à Bratte, le remplacer en réserve de régiment. Ici, c'est considéré comme repos. Nous ne touchons même pas l'indemnité de combat... Les journées se passent dans le calme, le plus absolu. L'artillerie est toujours aussi silencieuse, l'infanterie la boucle... En un mot, c'est le filon ! Les 16 octobre, nous recevons un renfort, composé en grande partie, de récupérés de la classe 18 et d'anciens poilus de la compagnie, qui ont été blessés et qui viennent nous retrouver après leur convalescence. La section est maintenant remontée; nous sommes trente-cinq à l'effectif. Les trois journées suivantes se passent en entraînement pour le tir au fusil-mitrailleur. Nous devons faire un concours de tir, et nous brûlons des cartouches à tire-larigot, dans une butte, derrière Bratte. Le concours a lieu le samedi 19 octobre, dans l'après-midi. Il comprend des tirs de fusil-mitrailleur et de grenades à fusil. c'est la troisième compagnie qui remporte la palme. En rentrant, on nous distribue de fourragères jaunes, et le soir, on voit tous les poilus, arborer fièrement leur cordon à sonnettes à leur épaule. Le lendemain, dimanche, prise d'armes, à midi, pour une remise de décorations... J'apprends que je suis cité à l'ordre de l'infanterie divisionnaire, dont on me remet l'étoile. Voici le texte de cette troisième citation : "Soldat dévoué et plein d'allant. A eu une belle conduite au feu, au cours des combats du 28 août au 10 septembre 1918." La cérémonie ne dure pas trop longtemps, et à quatorze heures nous pouvons nous rendre à une matinée récréative qui a lieu dans la grange d'une ferme. On y chante, on y déclame. Le capitaine-adjudant-major Montagnier fait même un petit discours. Enfin, ce n'est pas trop mal, et nous nous séparons, contents de notre après-midi. Le lendemain 21 octobre, nous préparons notre déménagement. Nous montons en ligne, ce soir, relever la sixième compagnie. La section est en réserve sur la route Nomény-Nancy, dans une cagna à peu près potable. La seule chose embêtante, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Mais nous coulons quand même nos journées, tout aussi tranquillement qu'à l'arrière. Les poilus prennent la garde, devant la porte sur la route. Ils n'ont donc pas beaucoup de chemin à faire. Quant à moi, je partage le quart avec les autres gradés. Dans la soirée du 25, nous nous disposons ainsi que d'habitude à prendre la garde sur la route, lorsque le lieutenant Thiébault, notre nouveau chef de section, vient nous chercher. Nous allons en avant, à Arraye remplacer la première section, qui s'en va faire une patrouille d'embuscade. Vers neuf heures, le lieutenant se ramène. Il a besoin de deux sergents, deux caporaux et onze poilus. Cela nous embête, car nous étions en train de jouer aux cartes, mais faisant contre mauvaise fortune, bon coeur, nous partons sans rechigner. Nous rejoignons la route Nomény-Nancy, nous passons devant notre cagna, mais sans s'y arrêter et poursuivons notre route. Nous faisons ainsi au moins quatre kilomètres; pendant ce temps, le lieutenant nous explique que nous allons en soutien d'artillerie... Un coup de main sur Fossieux se prépare et une batterie de 75 doit s'installer dans la plaine. Elle doit être gardée par l'infanterie, et c'est nous qui sommes désignés pour la circonstance. Fossieux est un pays occupé par les boches, et il se trouve assez loin de l'autre coté de la Seille. Mais nous devons passer la nuit près des pièces, et n'ayant pas prévu ça, nous n'avons pas de couverture. Il faut rester là, jusqu'à cinq heures du matin, gelés, transis et sans dormir. Enfin, à six heures, nous avons regagné notre cagna et nous nous couchons, tout heureux de nous retrouver au chaud. Dans la matinée, nous sommes réveillés par des explosions d'obus. Les boches se sont réveillés et tirent derrière Ajoncourt, pays qui se trouve légèrement à notre gauche.  A vingt heures, toute la section démarre et va prendre position à coté des pièces de la 24e batterie du 235e régiment d'artillerie de campagne... Le coup de main est fixé à une heure du matin. Mais à onze heures, surprise : Caron téléphone une défense de tirer. La section franche ne veut pas faire son coup de main si l'artillerie s'en même et comme on veut des prisonniers, Caron préfère interdire le tir du 235e. De sorte que les artilleurs qui ont perdu une nuit à s'installer, n'ont plus que la peine de se préparer à ficher le camp. A trois heures, ils s'en vont et nous en faisons autant. Comme nous rentrons dans notre cagna, un agent de liaison nous apprend qu'il y a huit prisonniers de fait. Cela s'est passé en douce. A peine avons-nous entendu quelques coups de mitrailleuse. Il est arrivé quelques vêtements neufs que le chef nous distribue dans la matinée... Le soir, nous reprenons notre garde à notre cagna et je profite de mes trois heures de quart pour orner ma veste des galons et de décorations. Le 30, nous sommes relevés, à huit heures, pas la dixième compagnie. Nous partons en réserve à Juryboid.  Là encore, pas beaucoup de fatigue. Les poilus qui prennent la garde, un par un, se réveillent l'un l'autre et nous n'avons donc pas besoin de prendre le quart. Le 3 novembre, comme c'est dimanche, je vais avec Tripier et Schmitt, un cabot et un poilu de la section, jusqu'à Moivron, boire un litre de bière... Chemin faisant, nous causons de la guerre, et surtout de sa terminaison : "Oh, moi, leur dis-je, je suis bien convaincu qu'il n'y en a plus pour longtemps, maintenant? - Penses-tu, ça va nous emmener jusqu'à l'année prochaine. - Mais non, vous allez voir que lorsque les boches vont se voir tout seuls, qu'ils vont bien s'abaisser, eux aussi. - Oui, et les préparatifs d'attaque que l'on fait dans le secteur ? Tu verras, tu verras. On va remettre ça !" Ils faisaient allusion aux emplacements d'artillerie lourde que l'on préparait dans le bois, pour une prochaine attaque : "Eh bien, on n'attaquera pas, et voilà tout ! - T'en fais pas, dans huit jours, il y en aura encore quelques-uns qui sécheront dans la plaine ! - Dans huit jours, l'armistice sera signé ! - Je te parie bien que non ! - Et, moi, je te parie que si ! - Eh bien, parions deux bouteilles de vin bouché, que ce ne sera pas fini dans huit jours ! - Je le tiens, ce pari, et je suis sûr de le gagner !" Nous nous entendons, et il en résulte, que si l'armistice n'est pas signé dimanche prochain, à minuit, j'aurais à payer deux bouteilles de vin bouché... Je suis tranquille... Je vois tout en rose et je suis presque certain de gagner mon pari ! ...Le 5 novembre, nouveau déménagement. Je suis détaché, avec mon escouade, près du cimetière de Jeandelincourt, nous sommes dans une belle petite sape et nous y sommes tranquilles. Personne ne vient nous voir. Des manilles, toute la journée pour tuer le temps, en attendant de tuer autre chose... Des tuyaux courent que l'artillerie lourde est arrivée à Faulx, ainsi que trois cents tanks de toutes sortes... Mais je suis optimiste, et convaincu, toujours aussi fermement, que nous n'attaquerons pas ! Les poilus deviennent de plus en plus nerveux. Certainement qu'il va se passer quelque chose d'ici peu : tout le monde en a la vague impression... Les boches deviennent nerveux, eux aussi, et ils le manifestent en tiraillant à tort et à travers. Dans la nuit, ils font un coup de main sur le troisième bataillon. Ils ne font pas de prisonnier, mais il y en a un tué. Le 7 novembre, je me vois sur le point de triompher dans mon pari... Des bruis courent que des parlementaires boches auraient traversé les lignes, hier soir, pour se rendre au G.Q.G., discuter des conditions d'armistice... Le soir, nous retournons loger à la tuilerie de Jeandelincourt. Toute la section est installée dans le séchoir à briques. ...Le lendemain 8, nouveau tuyau confirmant celui d'hier : les boches seraient bien venus et auraient bel et bien discuté avec Foch, qui leur auraient donné soixante-douze heures, c'est-à-dire jusqu'à lundi midi, pour réfléchir et donner une réponse. Les bruits d'attaque circulent de plus en plus. On dit qu'il y a des régiments de tirailleurs et de zouaves qui sont à l'arrière. On parle même d'une date : le 12 novembre, comme étant le jour fixé pour le grand saut sur la Seille ! Mais d'autre part, dans la journée, on nous fait passer un ordre d'avoir à arrêter tout parlementaire ennemi qui se présenterait et de le conduire au P.C. du bataillon... La journée du 9 s'écoule dans le calme le plus absolu. Dans la soirée, on nous apporte des journaux : nous avons alors, confirmation des tuyaux et, de plus nous apprenons une bonne nouvelle : la révolution boche a éclaté. Les marins se sont mutinés. Triomphant, je montre le journal à Tripier : "Attends, attends, ce n'est pas encore signé ! Ils ont jusqu'à lundi, onze heures, mais ce n'est pas sûr qu'il accepteront ! - Mais si, tu verras qu'ils n'attendront pas onze heures pour signer. Ils en ont assez, eux aussi !" Le lendemain, dimanche 10 novembre, nous avons une forte émotion. Vers trois heures trente, l'agent de liaison arrive dans la cagna et nous alerte. Ordre de monter immédiatement les sacs et de se tenir prêts au départ. Nous nous préparons donc, sans savoir ce qui se passe, et nous attendons... Au jour, nous entendons un bruit de mitrailleuse, et les boches se mettent à tirer quelques coups de canon. Les obus tombent en avant de Arraye-et-Han... Cela dure comme ça jusqu'à midi... Puis, tout bruit cesse. Ce n'est que dans la soirée que nous avons l'explication de ce qui nous tracasse tant. Hier soir, la section franche a été faire une patrouille, et en rentrant, le sergent qui la commandait, a rendu compte, qu'ils avaient pénétré à quatre ou cinq kilomètres dans les lignes boches, sans rencontrer personne. Aussitôt, le colon décide de s'assurer de la véracité de ces dires, et ce matin au jour, il a fait sortir, les deuxième et troisième bataillons. Ils ont commencé à avancer en colonne par quatre, sur la route d'Aulnoy et de Fossieux. Mais les boches qui ne sont pas partis du tout, les reçoivent à coups de mitrailleuses et déclenchent le barrage. Les poilus sont en pagaille. Ils font demi-tour et cherchent à rentrer dans nos lignes. Il leur faut bien deux heures pour exécuter ce mouvement et ils laissent des plumes sur le carreau. Il y a un tué et quelques blessés. ...Le soir, nous étions couchés, lorsqu'un poilu, sorti pour aller pisser, nous appelle : "Eh, les gars ! Venez donc voir, ce feu d'artifice !" Nous sortons sur la route et nous pouvons admirer un joli spectacle. Les boches envoient des fusées de toutes sortes : des vertes, des jaunes, des blanches... C'est à croire qu'ils usent tout leur stock... Les jeunes poilus émettent leur opinion : "Certainement, ils ont les jetons, ils veulent éclairer le terrain, dit l'un des nouveaux. - Oh oui, ils se méfient que le coup de ce matin ne recommence pas ! - Eh bien, je ne suis pas de votre avis, dis-je, si les boches voulaient simplement éclairer le terrain, ils ne gaspilleraient pas autant de munitions que ça; ils n'enverraient pas des fusées de toutes les couleurs comme ils le font. Ils enverraient simplement des fusées éclairantes... A mon point de vue, ils sont saouls ou fous !... Ils doivent savoir quelque chose, et je ne serai pas étonné d'apprendre que l'armistice est signé !" Nous admirons encore un peu ce spectacle et nous nous couchons... ...Soudain... nous sommes réveillés par un poilu... haletant... qui gueule comme un damné : "Eh, les gars !... Eh, levez-vous !... ça y est... l'armistice est signé !... grouillez-vous !..." Nous nous levons en vitesse et l'interrogeons : "Oui, dit-il, c'est un lieutenant du génie qui vient d'en recevoir la nouvelle par radio... L'armistice est signé, depuis ce matin, à cinq heures." Je crois, ma parole, que pour un peu, nous nous embrasserions tous !... Je regarde ma montre : il est cinq heures quarante... La nouvelle n'a pas été longue à se répandre... Mais, je veux en avoir le coeur net... Je demande à un poilu de la classe 18, Rochard, s'il veut venir avec moi jusqu'à Jeandelincourt. Certainement, là-bas, nous aurons confirmation de la nouvelle... Puisse-t-elle être vraie ! Nous démarrons. Chemin faisant, nous passons devant des ouvriers du génie, qui réparent la voie ferrée, mais ils ne sont guère au travail... Appuyés sur leurs outils, ils discutent dur ! Comme nous, ils viennent d'apprendre le tuyau et le commentent. ...J'arrive enfin, à Jeandelincourt, avec Rochard, et, de suite, je m'aperçois que le lieutenant nous a dit vrai : la gendarmerie est pavoisée et il y a deux de ces militaires devant la porte... chose que je n'avais pas encore vue, depuis que nous étions dans le secteur... ! Nous remarquons dans la rue, de nombreux groupes de poilus, qui discutent fortement... La mairie est pavoisée également... Nous nous approchons, et derrière le grillage des affiches administratives, nous remarquons un carré de papier que nous lisons. Il contient une dépêche relatant la signature de l'armistice, en ces termes : "Armistice signé ce matin, cinq heures. Entrée en effet, onze heures. Signé : Erzberger et Foch."  ...Voyant alors que c'est bien vrai, que les paroles mettant fin à la guerre, ont bien été échangées... je suis agité de mille sentiments divers... ...J'ai envie de rire... de pleurer... de chanter... je ne sais ce que j'éprouve, mais j'ai envie d'embrasser tout le monde... Dans la rue, des poilus gesticulent, en criant : "Eh vieux, c'est fini... ce coup-ci... ! - Pas trop tôt... Maintenant, on s'en fout !..." La coopérative a déjà ouvert ses portes et il y a une queue formidable. Je repars avec Rochard, mais nous n'avons pas fait deux cents mètres que nous croisons Tripier et Schmitt, à qui nous faisons part de la certification de la nouvelle annoncée ce matin. Aussitôt, mon Tripier qui ne perd pas le nord, me fait remarquer : "Eh bien, tu as perdu ton pari ! - Hein ! comment ça ! - Ben ! t'avais parié qu'hier à minuit, l'armistice serait signé, or, il ne l'a été que ce matin, à cinq heures. Donc, t'as perdu tes deux bouteilles !..." ...C'est pourtant vrai que j'ai perdu mon pari, à cinq heures près; j'en suis de mes deux bouteilles !... Je les paye d'ailleurs bien volontiers !... Je suis si heureux que la guerre soit finie que je paierai tout ce que l'on me demanderait ! Nous faisons donc demi-tour, et au bout d'une heure d'efforts, nous réussissons à avoir nos quatre bouteilles de vin bouché. J'en paye deux, et comme Tripier est très heureux que la guerre soit finie, il s'est mis avec Schmitt, pour en payer deux autres. Ainsi, il n'y a pas de jaloux !... ...En regagnant la tuilerie, nous croisons une civière portée par deux brancardiers, qui ramènent un tué... le dernier tué probable du 155 pour cette guerre... Une fois rentrés, nous buvons nos quatre bouteilles de vin, et nous sommes bien près de les avoir achevées, lorsque passent deux chasseurs à cheval; ils s'arrêtent devant la porte : "Il est onze heures, les gars !... C'est fini !..." Ces paroles, pourtant si simples, nous rappellent à la réalité... nous regardons nos montres... Mais, oui il est onze heures ! et à partir de cette minute, nous ne devons plus tirer... Cela continue pourtant à barder terriblement sur la gauche, du côté des Américains... En voilà qui ne veulent pas se décider à s'arrêter !... Il y a longtemps que nous n'avons pas mangé la soupe aussi tranquillement ! ...Dans l'après-midi, une idée nous vient : il faut que nous répondions aux boches, et que nous fassions ce soir, comme ils ont fait hier ! Nous nous mettons en quête, et trouvons à droite et à gauche des fusées de toutes sortes : rouges, vertes, blanches à un ou plusieurs feux et des fusées éclairantes... Il y en a de tous modèles, depuis la fusée primitive à baguette, jusqu'à la fusée à pistolet, genre boche. ...Dès que la nuit est venue, nous sortons tous sur la route. Nous éprouvons une jouissance bizarre à allumer nos cigarettes dehors, en nous disant que nous ne risquons plus rien... que malgré la lueur, les boches ne tireront pas !... Cela nous semble bien bon, et notre cigarette nous parait deux fois meilleurs !... Enfin, nous nous préparons à expédier nos fusées... Nous avons dégotté deux ou trois pistolets et, bing !... à un signal, partent ensemble, disposées de certaine façon, trois fusées : une verte... (nous n'avons pas de bleue), une blanche et une rouge... ...De loin, ça peut passer pour une illumination, représentant les couleurs nationales... Dès que ces trois fusées sont descendues, nous nous en donnons à coeur joie... Les signaux partent en l'air, dans tous les sens, illuminant la plaine, la route et les gens qui passent... ...Une voiture circule sur la route et passe à notre hauteur... au moment où une fusée s'envole... Le bruit de la détonation et l'éclair qui en résulte fait faire un écart au cheval... Nous croyons déjà la voiture dans le fossé !... Mais le carcan prends le galop et le voilà qui file à toutes brides sur la route ! ...Il peut arriver un accident, mais ça nous laisse froid ! Nous on s'en fout !... La guerre est finie... Le reste nous importe peu !... Mais le lieutenant Thiébault s'amène. Il y a déjà près de deux heures que nous jouons à ce jeu et il trouve qu'il y en a assez comme ça !... Nous l'écoutons et rentrons dans notre cagna... Je me couche, mais je reste un long moment sans dormir... J'allume alors une cigarette, et je réfléchis un peu... J'ai du mal à m'imaginer que c'est fini... que nous n'attaquerons plus... que je ne prendrai plus la garde au petit poste... que je n'aurai plus besoin de me demander, le soir, de quoi le lendemain sera fait et si le lendemain soir, je serai encore en vie... ...Cette existence est finie et bien finie !... ...J'ai la chance de m'en tirer sain et sauf... un vrai bonheur pour moi !... Au lieu de penser, à présent, à la mort, à la guerre, à la tuerie... je n'ai plus à m'emplir le cerveau que de l'idée de la Paix... de la Libération... en un mot, de la Vie !... La paix... La démobilisation. ...On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire... Je ne m'étendrai donc pas longtemps sur la fin de mon service militaire, car elle ne fut pas bien malheureuse !... ...Les boches ayant vingt-quatre heures pour commencer l'évacuation des territoires occupés et rentrer chez eux.  Nous gagnons Bratte, d'où nous prenons notre essor vers l'Allemagne, le 17 novembre... L'entrée en Lorraine est triomphale !... Nous passons la nuit du 17 au 18, à Flaucourt, derrière les lignes boches. Les braves gens paraissent tout heureux de voir les Français. Leur accueil fait plaisir. Le lendemain, nous nous rendons à Remelach (Romilly). En cours de route, le général Lecomte, commandant le 33e corps, nous passe en revue, et en arrivant, nous nous rassemblons sur la place de Romilly, où les autorités du patelin, se sont réunies, pour nous attendre. La musique du régiment joue la Marseillaise, puis quelques airs, et le colon prononce une courte allocution à laquelle répond le maire. ...Les vieux, en chapeau haut de forme, pleurent comme des veaux, et une bonne femme nous crie de sa fenêtre : "Enfin, vous voilà ! mes petits gars !... C'est pas trop tôt, depuis les temps qu'on vous attendait !" ...Nous restons là trois jours, puis nous continuons la poursuite derrière les Fritz. Nous embarquons en camions-autos, le 21 novembre et nous les quittons à Wadgassen où nous passons la nuit. Le lendemain, nous traversions le pont sur la Sarre et entrons à Völklingen, premier pays franchement boche. Nous y restons huit jours à sabler la bière, à pleins verres. Il y a deux ou trois jours que nous sommes là, lorsqu'au rapport on demande les noms des poilus qui ont participé à la contre-attaque du 11 juin et qui n'y ont pas obtenu de citation. Comme tel est mon cas, je me fais inscrire... Le 1er décembre, nous reprenons la route, et alors c'est un voyage ininterrompu de plusieurs jours. Nous passons successivement à Wemmetsweiler, Nittelkirchen, Friedelhausen, Dörmschel, Münsterappel, Eichloch, Oberolm et Mombach. Nous arrivons dans ce dernier pays, qui est un faubourg de Mayence, le 11 décembre. Deux jours de repos, car nous devons défiler en traversant Mayence, et le 13, nous repartons. Nous traversons la ville dans toute sa longueur, et, fait historique, nous traversons le Rhin, sur le Strassenbrucke !... ...Au milieu du pont se tiennent les généraux Lecomte, commandant le 33e corps et Caron, commandant la 165e division, et le colonel Goybet, commandant l'infanterie divisionnaire... Musique en tête et drapeau déployé nous défilons en colonne par huit, devant ces messieurs, qui nous regardent passer bien tranquillement... Ce soir-là, nous couchons à Weilbach, d'où nous repartons le lendemain pour gagner Höchst, pays où se tiendra le centre du régiment et d'où seront détachés les petits postes nécessaires à la garde de la tête de pont de Mayence... Nous restons huit jours à Höchst, en réserve de régiment, puis le 21 décembre, nous gagnons Goldstein-Bahnhof (gare de Goldstein) à trois kilomètres devant Francfort. Nous sommes en poste avancé, nous visitons sauf-conduits, passeports et autres papiers et nous laissons passer qui nous plait... La gare se trouve au milieu de la superbe forêt de Schwannheim, dans laquelle foisonnent lapins et chevreuils... Les poilus se livrent à une chasse effrenée, et nous avons assez souvent de quoi allonger l'ordinaire. Le 24 décembre, jour de réveillon, je m'offre avec deux copains, la promenade de Francfort. Nous n'avons pas le droit d'y aller, mais ça ne fait rien. La curiosité l'emporte sur la prudence car j'ai envie de voir cette ville... Je ne suis pas déçu, car elle est superbe. Je rentre enchanté de ma visite... Le 28, j'apprends la nouvelle de ma quatrième citation ainsi conçue : "Bon gradé. A fait vaillamment son devoir pendant la période du 9 juin et jours suivants." Il est à remarquer que je n'étais pas gradé, le 9 juin, mais comme c'est un rappel, on m'a inscrit et donné la citation comme caporal. Je suis employé au bureau, comme fonctionnaire-fourrier, pour me mettre un peu au courant, car le fourrier doit bientôt partir en permission... Le capitaine Troutot m'annonce qu'il m'a proposé pour suivre un cours d'élèves-chefs de section... ...Le 31 décembre au soir, j'étais en train d'écrire dans le bureau, lorsque Gayet, le caporal, chef de liaison bu bataillon, entre, apportant la décision. En ouvrant la porte, il fait : "Cambounet et Bastide ! mes félicitations pour vos nominations de sergent et caporal !" Je fais un bond. Je ne veux, tout d'abord, pas le croire, mais il me montre la décision et je me rends à l'évidence... Je suis nommé sergent à la date du 1er janvier. ...J'en suis très heureux. Comme cadeau du jour de l'an, le Capitaine n'aurait pu m'en choisir un meilleur. Voulant faire partager mon contentement à quelqu'un, j'écris immédiatement à mes parents, pour leur annoncer la bonne nouvelle. ...Nous quittons Schwannheim, le 12 janvier, relevés par le 92e régiment d'infanterie. Je pars en avant, préparer le cantonnement, car malgré mon nouveau grade, je suis resté au bureau. Chemin faisant, l'adjudant Marcelier, qui commande le détachement du premier bataillon, m'annonce que je suis désigné pour aller suivre le cours d'élèves-chefs de section, qui se tiendra à Bitche, en Alsace. Je commence donc les marches du retour avec le régiment. Nous passons par Hochheim, Nieder-Ingelheim, où nous apprenons la dissolution de la 165e division, Badenheim et Munsterappel. C'est de ce dernier pays que je quitte la compagnie, le 18 janvier 1919... J'arrive le lendemain à Bitche... Je loge dans le fort, perché en nid d'aigle, au-dessus du pays... ...Pendant trois mois, c'est une série ininterrompue d'exercices, manoeuvres, études théoriques et pratiques... Mon cours est marqué par un abcès d'origine dentaire qui me colle, pendant huit jours, à l'hôpital, mais sans me faire perdre le fruit de mon labeur. Au début d'avril, ont lieu les examens théoriques et pratiques, qui doivent nous assurer la possession du brevet de chef de section... ...Le samedi 5 avril, nous étions, vers midi, dans nos chambres, lorsque nous entendons le bruit d'un moteur d'un avion, volant bas... Nous nous précipitons à la fenêtre, juste à temps pour voir l'avion s'abattre et tomber derrière le mur de la caserne Jouart, où nous sommes descendus loger depuis quelques jours... Nous sautons par la fenêtre et courons sur le lieu de l'accident... L'avion brûle et, avec lui, les deux passagers; ce sont un lieutenant du 2e d'artillerie et un sergent de chasseurs... Il n'y a rien à faire : pas moyen de les dégager... Dès que le brasier est un peu apaisé, on place les restes des deux malheureux sur des brancards et ils sont transportés à l'hôpital. Les obsèques ont lieu deux jours après. Les fourgons sont suivis par une foule nombreuse de civils et de poilus. Cela nous fait de la peine, car, avoir fait la guerre, et mourir, maintenant, dans un stupide accident d'aviation, c'est bien triste !... ...Enfin, le 12 avril, nous connaissons le résultat des examens. Je suis reconnu apte à remplir les fonctions de chef de section, et en conséquence, on me remet le brevet... Je quitte Bitche, le 15 avril, pour gagner Verdun, où se trouve actuellement le 155e R.I.... En regagnant ma compagnie, j'y trouve quelques changements : il y a des nouveaux de la classe 19 arrivés, et il y a des vieux des classes 98 ou 99 qui sont partis. Mais je ne m'attarde pas. Voilà six mois que je n'ai pas été en permission, je me débrouille à toute vitesse, pour avoir mon premier tour de vingt jours, auquel j'ai droit. ...J'ai vingt-quatre jours, en y comprenant quatre jours pour mes deux dernières citations. J'en profite du 19 avril au 14 mai. En rejoignant, je me fais reporter sur le tour de départ, comme si je n'avais pas été au cours, et que j'ai eu ma première permission, à son tour normal. Je suis alors dans les premiers, et dois y retourner dans une huitaine de jours. Pour passer le temps, on m'envoie à Landrecourt, à quinze kilomètres de Verdun, avec le lieutenant Jayet, pour commander un détachement de travailleurs auxiliaires... Ce sont des types qui travaillaient en usines d'où ils ont été renvoyés pour indiscipline, paresse ou ivresse. J'y passe neuf jours, dans la plus parfaite tranquillité, et le 26, je retourne à Verdun, car je suis prêt à avoir mon deuxième tour de permission. Je pars en effet, le 28 mai, et je reste dans ma famille, pendant vingt bonnes journées, jusqu'au 19 juin. Je quitte mes parents avec l'espoir que cette permission est la dernière de mon service militaire. ...A partir de cette date, les journées s'écoulent monotones, juste marquées par quelques incidents de quartier, notamment quelques-uns suscités par des prisonniers russes que la compagnie avait à garder... Parmi eux se trouvent quelques pirates qui nous causent des ennuis, surtout un nommé Souslaparof, qu'il faut arrêter, revolver au poing; mais on les met rapidement à la raison. D'ailleurs, le 7 août, nous sommes relevés, comme troupes de garnison à Verdun, par le 132e, car nous rentrons à notre dépôt de Commercy. Je fais à ce moment fonction de sergent-fourrier, et ne vais pas tarder à faire celle de sergent-major, car la démobilisation bat son plein, et les poilus, les ex-camarades de combat, fichent tous leur camp, les uns après les autres... ...Un jour viendra... comme dit la réclame !... Je ne m'en fais pas. Je compte les jours tranquillement, et vois le moment libérateur approcher !... Je partage mon temps entre le travail du bureau, la pause, les bains dans la Meuse et la promenade... Vers la fin août, je me trouve être le grand manitou à la compagnie. Je reste seul, comme sous-officier; il n'y a presque plus de poilus et le lieutenant Tomasi, l'actuel commandant de compagnie, me répond, quand je lui demande quelque chose : "Mon vieux, je m'en fous ! C'est du quatre ou du cinq demain matin !" Mais je me suis rendu compte d'une combinaison que je vais mettre à profit... Le troisième tour de permission est commencé depuis le 1er août. Vingt poilus sont partis de suite, et on doit en envoyer au fur et à mesure des rentrées. Mais, vers le 24 août, j'envoie quelques titres à la signature du colon, accompagnés d'un papillon : "En remplacement de X, maintenu en dépôt démobilisateur." Je suis dans les trente premiers. A force de faire ce petit truc-là, mon tour approche rapidement, et, le 1er septembre, j'ai la joie... l'immense bonheur, de compter du zéro, et de pouvoir, le soir même, au moment de prendre mon train pour Paris, payer une bouteille de vin mousseux aux deux sous-officiers de la première compagnie de mitrailleuses avec qui j'ai fait papote jusqu'à ce jour !... ...C'est la dernière fois que je franchis la grille de la caserne Oudinot... C'est la dernière fois que je vois le poste de police !... C'est la dernière fois que je vois la sentinelle et sa guérite !... Quel soupir de soulagement je pousse au moment où je monte dans le train !... J'ai encore vingt-cinq jours à attendre ma démobilisation, mais vingt-cinq jours dans sa famille, ce n'est rien... que le commencement du bonheur !... Je profite de ma dernière permission militaire pour m'offrir un petit voyage de huit jours dans le midi, et je reviens, à temps, le 24 septembre, pour me présenter au fort de Rosny-sous-Bois, au quatrième zouaves, dont le bureau démobilisateur va me désarmer... ...Je ne peux pas passer, le jour même. J'y retourne le lendemain matin, vendredi 25 septembre, à huit heures... ...Je passe devant une quinzaine de scribouillards... pauvres bleus !... Je donne une douzaine de signatures... On me remet, petit à petit, des papiers, que j'échange, les uns après les autres, contre de l'argent comptant... ...Je passe, en dernier, au magasin d'habillement où contre ma défroque militaire on me remet l'uniforme Abrami, à cinquante-deux francs... et, à onze heures, je franchis, citoyen libre, la grille du fort de Rosny... ...Je suis, maintenant, civil et n'appartient plus à l'armée qu'au titre de la réserve ! ... Deux ans ont passé... Nous sommes au 25 novembre 1921... Il est midi... Je suis occupé à travailler, dans la salle à manger. Mon père rentre de son travail... : "Ah, bien, tiens !... Il y a une lettre recommandée pour toi ! Elle vient de Commercy ! - Qu'est-ce qu'ils peuvent bien me vouloir ?" Enfin, le meilleur moyen de savoir, est de lire... Aussi, dès que mon père a sorti cette lettre de sa boite, je me précipite, l'ouvre et jette un coup d'oeil... Un seul me suffit !... C'est un imprimé, portant en titre : médaille militaire... Je prends connaissance rapidement, du texte... et je me jette au cou de mon père, en chantant : "J'ai la médaille militaire ! J'ai la médaille militaire ! !..." ...Je n'ai éprouvé une émotion semblable que le jour de l'armistice... Une fois revenu un peu à moi, je relis plus froidement... On m'annonce que, d'après un arrêté ministériel, en date du 4 décembre 1920, la médaille militaire m'est attribuée... avec effet du 16 juin 1920... Depuis un an et demi, j'avais donc droit au port de cet insigne... tant désiré... Voilà une belle occasion, pour ma mère, de mettre les petits plats dans les grands, et, de plus, comme la médaille me sera remise aux Invalides, une nouvelle occasion de remettre les petits plats dans les grands... sans parler du chapeau obligatoire !... Mais, comme dit mon père... tous les prétextes vous sont bons !... Ah, les femmes !... ...Tout est bien qui finit bien !... Terminer la guerre, après deux ans de front, intact, sergent, médaille militaire, croix de guerre avec quatre étoiles et une palme... il y a de quoi satisfaire les plus orgueilleux !... FIN |